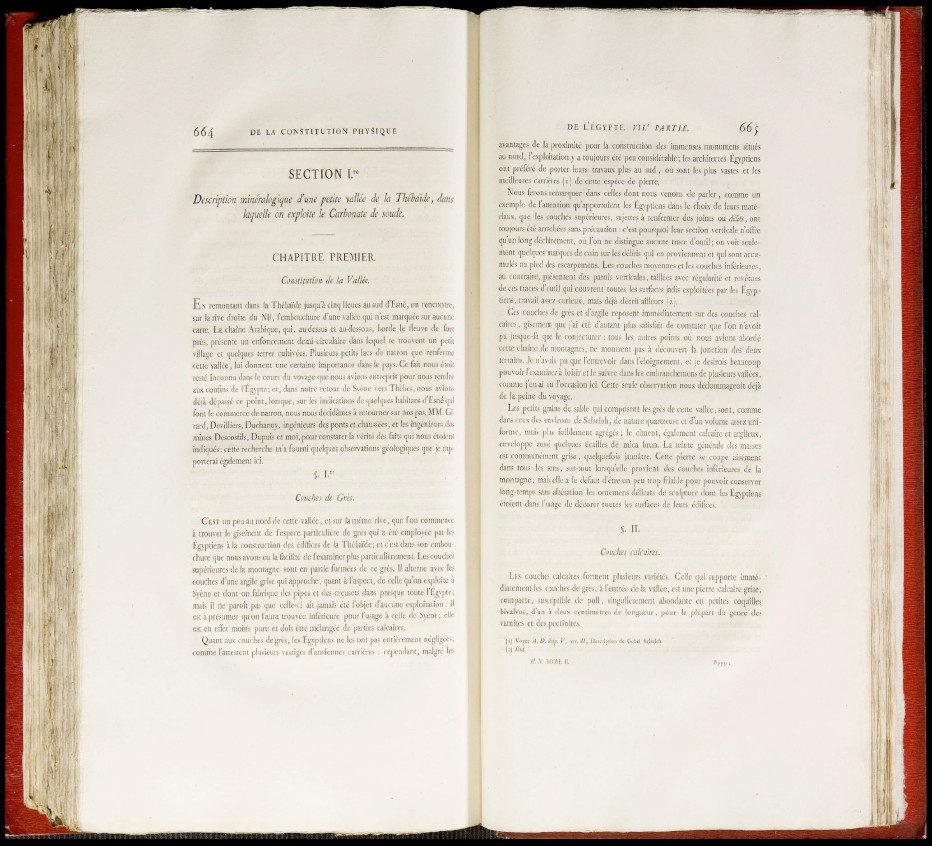
m
6 6 4 DE LA C O N S T I T U T I O N P H Y S I Q U E
S E C T I O N IDescription
minéraÎogique d'une petite vallée de la Théba'ide, dans
laquelle on exploite le Carbonate de soude.
J
C H A P I T R E P R E M I E R .
Constitution de la Vallée.
E N remontant dans la Thcbaïcle jusqu'à cinq iieues au sud d'Esnc, on rencontre,
sur la rive droite du Ni l , l'embouchure d'une vallée qui n'est marquée sur aucune
carte. La chaîne Arabique, qui, au-dessus et au-dessous, borde le Heuve de fort
près, présente un enfoncement demi-circulaire clans lequel se trouvent un petit
village et quelques terres cultivées. Plusieurs petits lacs de natron que renferme
cette vallée, lui donnent une certaine importance dans le pays. Ce fait nous etoit
resté inconnu dans le cours du voyage que nous avions entrepris pour nous rendre
aux confins de i'Ég}pte; et , dans notre retour de Syène vers Thèbes, nous avions
déjà dépassé ce point , lorsque, sur les indications de quelques habitans d'Esné qui
font le commerce de natron, nous nous décidâmes à retourner sur nos pas, MM. Girard,
Devillîers, Duchanoy, ingénieurs des ponts et chaussées, et les ingénieurs des
mines Descostiis, Dupuis et moi , pour constater la vérité des faits qui nous étoient
indiqués : cette recherche m'a fourni quelques observations géologiques que je rapporterai
également ici.
§. i . "
Couches de Grès.
C'EST un peu au nord de cette vallée, et sur la même rive, que l'on commence
à trouver le gisement de l'espèce particulière de grès qui a été employée par les
Égyptiens à la construction des édifices de la Thébaïde; et c'est dans son embou
chure que nous avons eu la facilité de l'examiner plus particulièrement. Les couches
supérieures de la montagne sont en partie formées de ce grès. Il alterne avec les
couches d'une argile grise qui approche, quant à l'aspect, de celle qu'on e.xploite à
Syène et dont on fabrique des pipes et des creusets dans presque toute l'Egypte;
mais il ne paroît pas que celle-ci ait jamais été l'objet d'aucune exj)loitation : il
est à présumer qu'on l'aura trouvée inférieure pour l'usage à celle de Syène ; elle
est en effet moins pure et doit être mélangée de parties calcaires.
Quant aux couches de grès, les Égyptiens ne les ont |)as entièrement négligées,
comme l'attestent plusieurs vestiges d'anciennes carrières : cependant, malgré les
D E L ' É G Y P T E . V U . " P A R T I E . 6 6 ^
avantages de la proximité pour la construction des immenses montimens situés
au nord, l'exploitation y a toujours été peu considérable; les architectes Égyptiens
ont préféré de porter leurs travaux plus au sud , où sont les plus vastes et les
meilleures carrières ( i ) de cette espèce de pierre.
Nous ferons remarquer dans celles dont nous venons de parler , comme un
exemple de l'attention qu'apportoient les Égyptiens dans le choix de leurs matériaux,
que les couches supérieures, sujettes à renfermer des joints ou délits, ont
toujours été arrachées sans précaution : c'est pourquoi leur section verticale n'offre
qu un long déchirement, où l'on ne distingue aucune trace d'outil ; on voit seulement
quelques marques de coin sur les débris qui en proviennent et qui sont accumulés
au pied des escarpemens. Les couches mo)'ennes et les couches inférieures,
au contraire, présentent des parois verticales, taillées avec régularité et revêtues
de ces traces d'ouiil qui couvrent toutes les surfaces jadis exploitées par les Égyptiens,
travail assez curieux, mais déjà décrit ailleurs (2).
Ces couches de grès et d'argile reposent immédiatement sur des couches calcaires,
gisement que j'ai été d'autant plus satisfait de constater que l'on n'avoit
pu jusque-là que le conjecturer : tous les autres points où nous avions abordé
cette chaîne de montagnes, ne montrent pas à découvert la jonction des deux
terrains. Je n'avois pu que l'entrevoir dans l'éloignement, et je desirois beaucoup
pouvoir l'examiner à loisir et le suivre dans les embranchemens de plusieurs vallées,
comme j'en ai eu l'occasion ici. Cette seule observation nous dédommageoi t déjà
de la peine du voyage.
Les petits grains de sable qui composent les grès de cette vallée, sont , comme
dans ceux des environs de Selseieh, de nature quartzeuse et d'un volume assez uniforme,
mais plus foiblement agrégés; le ciment, également calcaire et argileux,
enveloppe aussi quelques écailles de mica brun. La teinte générale des masses
est communément grise , quelquefois jaunâtre. Cette pierre se coupe aisément
dans tous les sens, sur-tout lorsqu'elle provient des couches inférieures de la
montagne; mais elle a le défaut d'être un peu trop friable pour pouvoir conserver
long-temps sans altération les ornemens délicats de sculpture dont les Égyptiens
étoient dans l'usage de décorer toutes les surfaces de leurs édifices.
Couches calcaires.
LF.S couches calcaires forment plusieurs variétés. Cel le qui supporte immédiatement
les couches de grès, à l'entrée de la vallée, est une pierre calcaire grise,
compacte, susceptible de pol i , singulièrement abondante en petites coquilles
bivalves, d'un à deux centimètres de longueur, pour la plupart du genre des
camites et des pectinites.
(1) Voyez A. D. chap. V, si
(a) ll'id.
Il N. TO.MK II.
'. ¡ I , Di'scripiioii de Gtbel Selseieh.