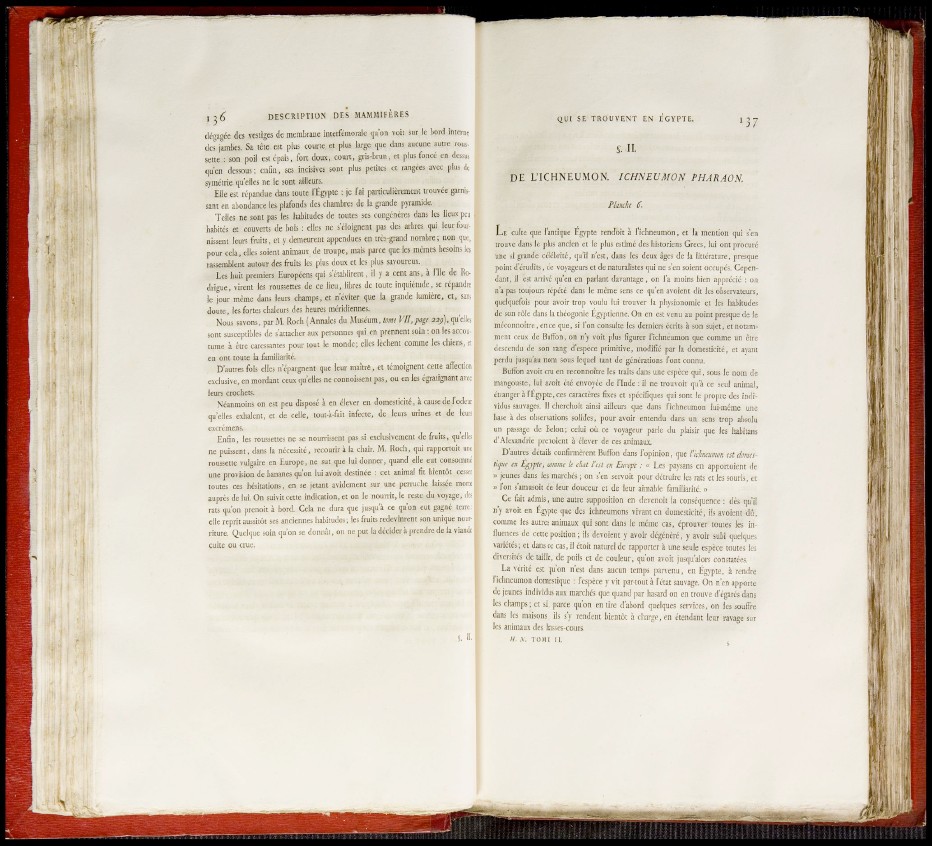
•d
' . Î
D E S C R I P T I O N DE S MAMMI FÈRES
dégagée des vestiges de membr ane imerfémorale qu'on voit sur le Lord interne
des jambes. Sa tête est plus courte et plus large tjue dans aucune autre roussette
: son poil est épais, fort doux, c o u r t , gris-brun, et plus foncé en dessus
qu'en dessous ; e n f i n , ses incisives sont plus petites et rangées avec plus de
symétrie qu'elles ne le sont ailleurs.
Elle est r épandue dans toute l'Egypte : je l'ai particulièrement trouvée garnis
sant en abondanc e les plafonds des chambres de la grande pyramide.
Telles ne sont pas les habitudes de toutes ses congénères dans les lieux peu
habités et couverts de bois : elles ne s'éloignent pas des arbres qui leur four,
nissent leurs f rui t s , et y demeur ent appendues en très-grand nombr e ; n o n que,
pour cela, elles soient animaux de u o u p e , mais parce que les même s besoins les
rassemblent autour des fruits les plus doux et les plus savoureux.
Les huit premiers Europé ens qui s'établirent, il y a c ent ans, à l'Ile de Rodrigue,
virent les roussettes de ce lieu, libres de toute inqui é tude , se répandre
le jour même dans leurs c h amp s , et n'éviter que la grande lumi è r e , e t , sans
d o u t e , les fortes chaleurs des heures méridiennes.
Nous savons, par M. Roch (Annales du Mu s é um, »me VII,page qu'elles
sont susceptibles de s'attacher aux personnes qui en pr ennent soin : o n les accou
tume à être caressantes p o i n tout le mo n d e ; elles lèchent c omme les chiens, et
en o n t toute la familiarité.
D'autres fois elles n'épargnent que leur ma î t r e , et témoignent cette affection
exclusive, en mo r d a n t ceux qu'elles ne connoissent pa s , ou en les égratignant avec
leurs crochets.
Néanmoins on est peu disposé à en élever en dome s t i c i t é, à cause de l'odeur
qu'elles exhalent, et de celle, tout-à-fait infecte, de leurs urines et de leurs
excrémens.
Enfin, les roussettes ne se nourrissent pas si exclusivement de fruits, qu'elles
ne pui s s ent , dans la nécessité, recourir à la chair. M. Ro c h , qui rapportoit une
roussette vulgaire en Eu r o p e , ne sut que lui d o n n e r , quand elle eut consommt
une provision de bananes qu'on lui avoit destinée : cet animal fit bientôt cesser
toutes ces hésitations, en se jetant avidement sur une perruche laissée mone
auprès de lui. O n suivit cette indication, et on le nour r i t , le reste du voyage, des
rats qu'on prenoi t à bord. Cela ne dura que jusqu'à ce qu'on eut gagné terre;
elle reprit aussitôt ses anciennes habitudes; les fruits redevinrent son unique nom
riture. Que lque soin qu'on se d o n n â t , on ne put la décider à pr endr e de la viands
cuite ou crue.
S. 11.
QUI SE T R O U V E N T EN EGYP T E . i ^ y
§. II.
DE L ' ICHNEUMON. ICHNEUMON PHARAON.
Planche iT.
L E culte ([ue l'antique Égypte rendoit à l ' i chneumon, et la me n t i on qui s'en
trouve dans ie plus ancien et le plus estimé des historiens Gr e c s , lui ont procuvé
une si grande célébrité, qu'il n'est, dans les deux âges de la littérature, presque
point d'érudits, de voyageurs et de naturalistes qui ne s'en soient occupés. Ce p e n -
dant, il est arrivé qu'en en parlant davantage , on l'a moins bien apprécié : on
n'a pas toujours répété dans le même sens ce qu'en avoient dit les observateurs,
quelquefois pour avoir t rop voulu lui trouver la physionomie et les habitudes
de son rôle dans la théogonie Égyptienne. On en est venu au point presque de le
méconnoîtrc, en ce que, si l'on consulte les derniers écrits à son suj e t , et not amment
ceux de BufFon, on n'y voit plus figurer l'ichneumon que c omme un être
descendu de son rang d'espèce primitive, modi f ié par la domesticité, et ayant
perdu jusqu'au n om sous lequel tant de générations l'ont connu.
BuiFon avoit cru en reconnoitre les traits dans une espèce qui, sous le n om de
mangouste, lui avoit été envoyée de l'Inde : il ne trouvoit qu'à ce seul animai,
étranger à l'Egypte, ces caractères iixes et spécifiques qui sont le propr e des individus
sauvages. Il cherchoit ainsi ailleurs que dans l'ichneumon lui-même une
Lase à des observations solides, p o u r avoir ent endu dans un sens t rop absolu
un passage de Be lon; celui où ce voyageur parle du plaisir que les habitans
d'Alexandrie prenoient à élever de ces animaux.
D'autres détails confirmèrent Buffon dans 1 o p i n i o n , que t'ichieiaiion est domestique
en Egypte, coimne le chat l'est en Europe : « Les paj'sans en appor toi ent de
» jeunes dans les mai-chcs ; on s'en servoit pour détruire les rats et les souris, et
» l'on s'amusoit de leur douceur et de leur aimable familiarité, n
Ce fait admi s , une autre supposition en devenoit la conséquence : dès qu'il
n'y avoit en Égypte que des i chneumons vivant en domesticité, ils avoient d û ,
comme ies autres animaux qui sont dans le même cas, éprouver toutes les influences
de cette position ; ils dévoient y avoir dégéné r é , y avoir subi quelques
vai-iétés; et dans ce cas, il étoit naturel de rapporte r à une seule espèce toutes les
diversités dé t a i l l é , de poils et de coul eur , qu'on avoit jusqu'alors constatées.
La vérité est qu'on n'est dans aucun temps p a r \ e n u , en Égypte, à rendre
I ichneumon domestique : l'espèce y vit par-tout à l'état sauvage. On n'en appor t e
de jeunes individus aux marchés que quand par hasard on en trouve d'égarés dans
les champs ; et si, parce qu'on e n t i r e d'abord quelques services, on les souffre
dans les maisons, ils s'y r endent bientôt à charge, en étendant leur ravage sur
les animaux dos basscs-cours.
H. N. TOMF, II. .
I
' s i
i
m V' il
H