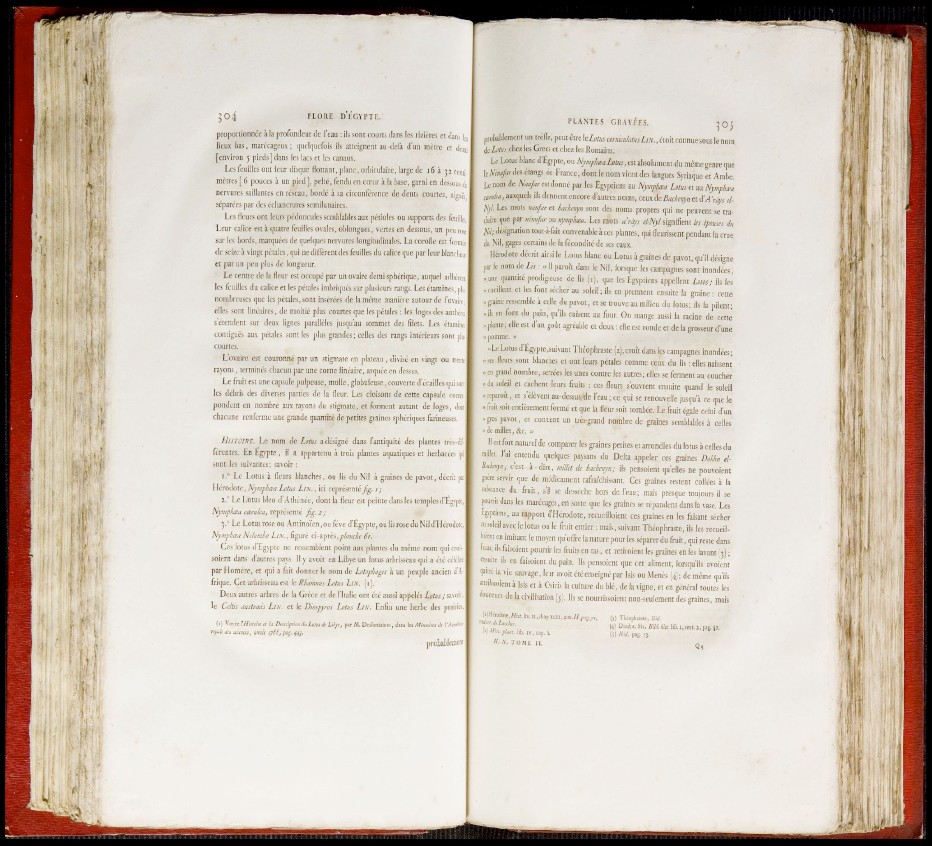
t E ï ' î f •J'
• ï 3 .
3 0 4 F L O R E D' l ÍGYP T n .
p r o p o r t i o n n ée à la p r o f o n d e u r de l'eau ; ils sont cour t s dans les rizières et dans les
lieux b a s , ma r é c a g e u x ; quelquefois ils a t t e ignent au-de l à d'un mè t r e et demi
[ e n v i r o n 5 p i e d s ] dans les lacs et les canaux.
Les feuilles o n t IcuT di sque flottant, p l a n e , orbiculaire , large de 16 à ^ i cciiij
mètres [ 6 p o u c e s à un p i e d ] , p e l t é , f e n d u en coeu r à la base, garni en dessous île
nervures saillantes en r e s e au, b o r d é à sa c i r conf é r enc c de dent s cour t e s , aigu¡;¿
séparées par des é chanc rur e s semilunaires.
Les fleurs o n t leurs p é d o n c u l e s semblables aux pétioles ou suppor t s des feuilles
Leur calice e s t à quatre feuilles ovales, o b l o n g u e s , vertes en dessous, un peu rose
sur los bords , ma rqué e s de quelques ne rvur e s longitudinales. La corol l e est fontitc
d e seize à vingt pé t a l e s , qui ne di f f e r ent de s feuilles du calice que par leur bianche
e t par un peu plus de longueur .
L e c ent r e de la fleur est o c c u p é pa r un ovaire demi - sphé r ique , auquel adluTc;
les feuilles du calice et les pétales imbriqué s sur plusieurs rangs. Le s étamines, plus
nombreuses que les pétales, sont insérées de la même mani è r e autour de l'ovaire
elles sont l iné a i r e s , de mo i t i é plus cour t e s que les pétales : les loges des antlièrej
s'étendent sur deux lignes parallèles jusqu'au s omme t des filets. Le s étaminc,
contiguës aux pétales sont les plus g r a n d e s ; celles des rangs intérieurs sont plui
courtes.
L'ovaire est c o u r o n n é par un stigmate en plateau , divisé en vingt ou treme
rayons, t e rminé s cha cun pa r u n e c o r n e linéaire, arquée en dessus.
L e fruit est u n e capsule p u l p e u s e , mo l l e , globuleus e, couve r t e d'écailles qui som
les débris des diverses parties de la fleur. Le s cloisons de cette capsule corresp
o n d e n t en n omb r e aux rayons du s t igma t e , et f o n n e n t aut ant de loge s , dont
chacune r e n f e rme u n e g r a n d e quant i t é de petites graines sphér iques farineuse?.
HISTOIRE. Le n om de Lotus a désigné dans l'anti<juité des plantes très-différentes.
En Egypt e , il a a p p a r t e n u à trois plantes at[iiatìqties et lieritacces (]iii
sont les suivantes; savoir :
1." Le Lo t u s à (leurs bl anche s , ou lis du Nil à graines de p a v o t , décrit par
H é r o d o t e , Nymphéa Lotus LIN. , ici représentée?^, i ;
2." L e Lo t u s bleu d 'At h é n é e , d o n t la fleur est p e i n t e dans les t empl e s d'Égjpie,
Nymphoe.1 coerulea, r epr é s ent e fig. 2;
3." L e Lo t u s rose ou An t i n o ï e n , o u f éve d 'Ég y p t e , o u lis rose du Ni l d'Hérodote,
Nympiioeu Nilnmbo Llt^., figuré ci-après,/í/í7hc//í' il.
Ces lotus d'Egypt e ne r es s emblent p o i n t aux plantes du même n om (¡ui croiisoient
dans d'autres pays. Il y avoit en Libye un lotus arbrisseau qui a été céfâiï
par H omè r e , et qui a fait d o n n e r le n om de Lotoplutges à un p e u p l e ancien <1.4-
frique. Ce t arbrisseau est le Rhamnus Lotus LIN. (I).
Deux autres arbres de la Gr è c e et de l'Italie o n t été aussi appelés Lotus; savoir
le Cckls (lustrmis Lis et le Dwspyros Lotus LIN. Enf in u n e he rbe des pi-airÎL^.
(1) VovM ÌHÌitoire el h Dtsmpùon du Lotos de Lïbys, par AI. Deifoniaiii», dans les Mèmolree tie l'Acaáí^ '
rojfJedee sciejicee, eiiwe'e ^ j .
probabiemeni
P L A N T E S GRAVE E S . 5 0 ;
protablement un trèfle, peut-être icLotus comkuUtusLiN., étoit c o n n u e sous le n
de Lotus chez les Gr e c s et chez les Komains.
Le Lotus blanc d'Egypt e , ou Nymj,/„ia Lotus, est absolument du même g e n r e que
\eNimfarAa étangs de Fr a n c e , d o n t le n om vient des langues Syriaque et Ar a b e .
Le nom de Nuufiirein d o n n é par les Égyptiens au Nymphoea Lotus et au Nymp/ma
muka, auxquels ils d o n n e n t e n c o r e d'autres n oms , ceux de Bachenyn et d'A 're^s ettiyl.
Les mot s niiufur et bachmyn sont des n oms p r o p r e s qui ne p e u v e n t se traduire
que par mimfai-ou nymp/mu. Le s mo t s aniys el-Nyl signifient Us épouses du
K l ; désignation tout-à-fait convenabl e à ces plantes , qui fleurissent p e n d a n t la c rue
du Nil, gages certains de la f é condi t é de ses eaux.
Hérodote décrit ainsi le Lo t u s blanc ou Lo t u s à graines de p a v o t , qu'il désigne
par le n om de Lis: « Il paroît dans le Ni l , lorsque les c ampagne s sont i n o n d é e s ,
. u n e quantité proiligieuse de lis ( i ) , que les Égyptiens appe l l ent Lotos; ils les'
„ cueillent et les f o n t sécher au soleil; ils en p r e n n e n t ensuite la gr a ine : c e t t e
» graine ressemble à celle du p a v o t , et se t rouve au milieu du lotos ; ils la pi l ent ;
• ils en f o n t du p a i n, qu'ils cuisent au four . On ma n g e aussi la racine de c e t t e
• plante ; elle est d'un goiit agréable et doux : elle est r o n d e et de la grosseur d ' u n e
B pomme. »
..Le Lotus d 'Ég y p t e , s u i v a n t Th c o p h r a s t e (2), croît dans les c ampagne s i n o n d é e s ;
» ses fleurs sont blanches et o n t leurs pétales c omme ceux du lis : elles naissent
• en grand n omb r e , serrées les unes c o n t r e les autres; elles se f e rme n t au c o u c h e r
.. du soleil et c a chent leurs fruits : ces fleurs s 'ouvr ent ensuite quand le soleil
. reparoît, et s'élèvent au-dessus, de l'eau ; ce qui se r enouve l l e jusqu'à ce que le
• fnik soit e n t i è r eme n t f o rmé cl que la fleur soit tombé e . Le f rui t égale celui d ' u n
. gros p a v o t , et c o n t i e n t un très-grand n omb r e de graines semblables à celles
»de millet, &c. »
Il est fort naturel de c omp a r e r les graines petites e t a r r o n d i e s du lotus à celles du
millet. J'ai e n t e n d u quelques paysans du De l t a appe l e r ces graines Doi/m d-
Budayu, c ' e s t - à - d i r e , millet de iacheuya; ils pensoi ent qu'elles ne p o u v o i e n t
guère servir que de mé d i c ame n t rafraîchissant. Ce s graines r e s t ent collées à la
sutsiance du f r u i t , s'il se dessèche hor s de l'eau; mais pr e sque toujour s il se
jjourrit dans les ma r é c age s , en sorte que les graines se r é p a n d e n t dans la vase. Le s
Egyptiens, au r a p p o r t d 'Hé r o d o t e , recuei l loient ces graines en les faisant sécher
au soleil avec le lotus ou le f rui t ent i e r : ma i s , suivant Th é o p h r a s t e , ils les recueilloient
en imitant le mo y e n qu'offi-e la na tur e p o u r les séparer du f r u i t , qui reste dans
I eau; ils faisoient p o u r r i r les fruits en t a s , et r e t i roi ent les graines en les lavant ,'3) ;
ensuite ils en faisoient du pain. Ils pensoi ent que cet a l iment , lorsqu'ils avoi ent
lulttéla vie sauvage, leur avoit été enseigné par Isis ou Me n é s (4); de même qu'ils
aiiribuoient à Isis et à Osiris la culture du Wé, de la vigne , et en général toutes les
douceurs de la civilisation (5). Ils se nour r i s soi ent n o n - s e u l eme nt des graines, mais
{i}HSra(Iote,/:/iir,jiv
icliap.xcii ,rûm //.;>,1^.7/, (j) Thi-ophrasie, itid.
fodm-deUi^lier.
(î) Itm.plani, lib. iv, c
tt.N. TOME I
(4) DLodor.Sic.
(î) It¡d. pag. 13.
Q ,
fI
.1 g
s a