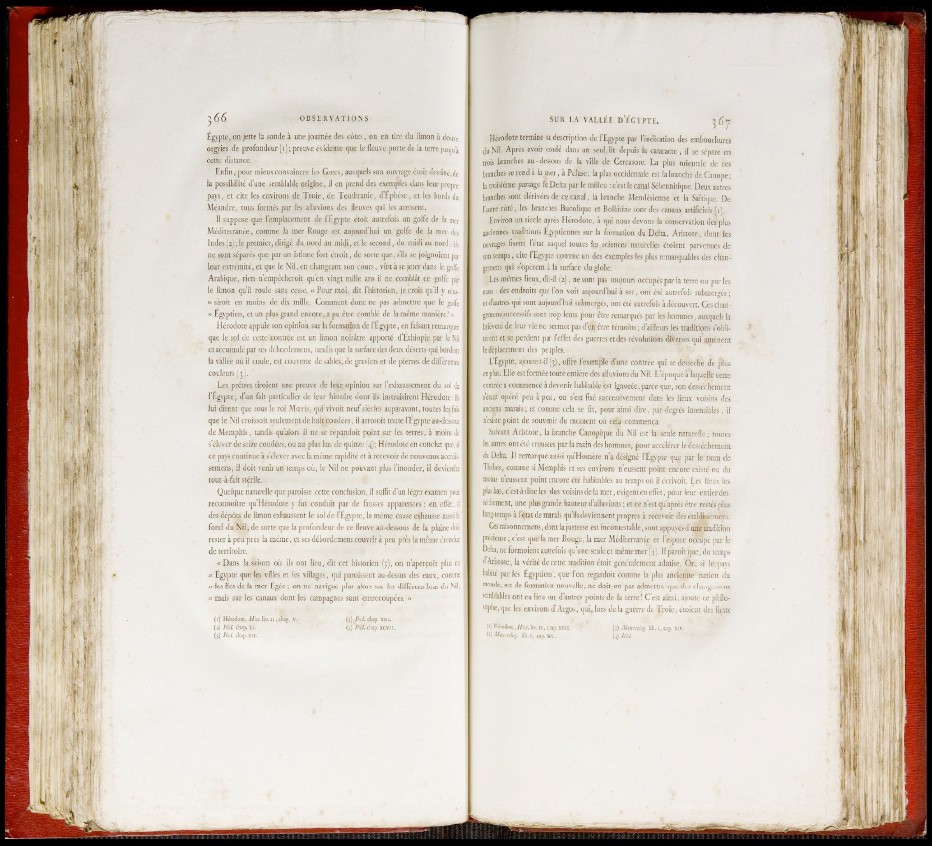
li-i
m
•^66 O B S E R V A T I O N S
Egypte, on jette la sonde à une journée des côt e s , on en tire du limon à douze
orgyies de profondeu r ( i ) ; preuve évidente que le fleuve por t e de la terre jusqu'à
cette distance.
Enfin, pour mieux convaincre les Grecs, auxquels son ouvrage étoit desdné, de
la possiJiilitc d'une semblable origine , i) en prend des exemples dans leur propre
pays, et cite les environs de T r o i e , de Tc u i h r a n i e , d'Epiièse , et les bords du
Méandre, tous formes par les alluvions des Hcuves qui les arrosent.
Il suppose que l'emplacement de l'Egypte étoit autrefois un golfe de la mer
Méditerranée, c omme la me r Rouge est aujourd'hui un golfe de la mer dos
Indes (2) ; le premier, dirigé du nord au mi d i , et le s e c o n d , du midi au nord : ils
ne sont séparés que par un isthme fort é t roi t , de sorte que, s'ils se joignoient par
leur extrémité, et que le Nil, en changeant son cour s , vint à se jeter dans le golfe
Arabique, rien n'empccheroi t qu'en vingt mille ans il ne comblât ce golfe par
le limon qu'il roule sans cesse. « Pour mo i , dit l'historien, je crois qu'il y rcus-
M siroit en moins de dix mille. Comme n t donc ne pas admettre que le golfe
« Égyptien, et un plus grand e n c o r e , a pu être comblé de la même manièreî »
Hérodote appuie son opinion sur la formation de l'Egypte, en faisant remar<|uer
que le soi de cette contrée est un limon noirâtre appor té d'Ethiopie par le Ni!
et accumulé par ses débordcmens , tandis que la surface des deux déserts qui bordent
la N'allée où il coule, est couverte de sables, de graviers et de pierres de différentes
couleurs (3).
Les prêtres tiroient une pr euve de leur opinion sur l'exhaussement du sol de
l'Égypte, d'un fait particulier de leur histoire dont ils instruisirent Hé rodot e : ils
lui dirent que sous le roi Moer i s , qui vivoit neuf siècles auparavant, toutes les fois
que le Nil croissoit seulement de huit coudé e s , il arrosoit toute rEg)'pte au-dessous
de Memp h i s , tandis qu'alors il ne se r épandoi t point sur les terres, à moins d«
s'élever de seize coudées, ou au plus bas de quinze (4); Hé r o d o t e en conclut que,si
ce pays continue à s'élever avec la même rapidité et à recevoir de nouveaux accroi--
semens, il doit venir un temps o ù , le Nil ne pouvant plus l'inonder, il deviendra
tout-à-fait stérile.
Quelque naturelle que paroisse cette conclusion, il suffit d'un léger examen pour
reconnoitre qu'Hé rodot e y fut conduit par de fausses appa r enc e s : en effet, si
des dépôts de limon exhaussent le sol de l'Egypte, la même cause exhausse aussi le
fond du Ni l , de sorte que la profondeu r de ce fleuve au-dessous de la plaine doit
rester à peu près la même , et ses débordemens couvrir à peu près la même étendue
de t emtoi r c .
«Dans la saison où ils ont lieu, dit cet historien (5), on n'aperçoit plus en
» Egypte que les villes et les villages, qui paroissent au-dessus des eaux, comme
3> les îles de la me r Égéc ; on ne navigue plus alors sur les tlilTérens bras du Nil,
» mais sur les canaux dont les campagnes sont entrecoupées. »
(1) Hérodofe, Hisc.Viv.
(2) Jbld. chsp. XI.
{3) JbiJ. chap. XII.
Jbid. chap. xill.
{5) ll<id. chap, xcvt:
SUR LA VALLÉE D' ÉGYP T E . ^ ( j y
Hérodote termine sa description de l'Egypte par l'indication des emboucimres
du Nil. Après avoir coule dans un seul lit depuis la cataracte , il se sépare en
trois branches au-de s sous de la ville de Cercasore. La plus orientale de ces
branches se rend à la me r , à Péluse ; la plus occidentale est la branche de Canope ;
la troisième partage le Delta par le milieu : c'est le canal Sébennitique. Deux autres
bratiches sont dérivées de ce canal, la branche Mendé s ienne et la Saïtique. De
l'autre côt é , les branches Bucolique et Bolbitine sont des canaux artificiels (i).
Environ un siècle après Hé r o d o t e , à qui nous devons la conservation des plus
anciennes traditions Égyptiennes sur la formation du De l t a , Ar i s tot e , dont les
ouvrages fixent l'état auquel toutes les sciences naturelles étoient parvenues de
son temps, cite l'Egypte c omme un des exemples les plus remarquables des cliangemcns
qui s'opèrent à la surface du globe.
Les mêmes lieux, dit-il {2), ne sont pas toujours occupés par la terre ou par les
eaux ; des endroits que l'on voit aujourd'hui à sec, ont été autrefois submergés ;
et d'autres qui sont aujourd'hui submergés, ont été autrefois à découvert. Ces changemens
successifs sont trop lents pour être remarqués j)ar les h omme s , auxquels la
brièveté de leur vie ne permet pas d'en être témoins ; d'ailleurs les traditions s'oblitèrent
et se pe rdent par l'effet des guerres et des révolutions diverses qui amènent
le déplacement des peuples.
L'Egypte, ajoute-t-il {3), offre l'exemple d'une contrée qui se dessèche de plus
en plus. Elle est formé e toute entière des alluvions du Nil. L' époque à laquelle cette
contrée a commenc é à devenir habitable est ignorée, parce <[ue, son dessèchement
s'étant opéré peu à p e u , on s'est fixé successivement dans les lieux voisins des
anciens marais ; et c omme cela se fit, pour ainsi dire, par degrés insensibles, il
n'existe point de souvenir du mome n t où cela coanmença.
Suivant Ar i s tot e , la branche Canopique du Nil est la seule naturelle ; toutes
les autres ont été creusées par la main des homme s , pour accélérer le dessèchementdu
Delta. Il remarque aussi qu'Homè r e n'a désigné i'Ég)pte que par le n om de
Tlièbes, c omme si Memphis et ses environs n'eussent point encore existé ou du
moins n'eussent point encor e été habitables au temps où il écrivoit. Les lieux les
plus bas. c'est-à-dire les plus voisins de la me r , exigent en effet, pour leur entier dessccliement,
une plus grande hauteur d'alluvions ; et ce n'est qu'après être restés plus
long-temps à l'état de marais qu'ils deviennent j)ropres à recevoir des établissemens.
Cesraisonnemens, dont la justesse est incontestable, sont appuyés d'une tradition
précieuse; c'est que la mer Rouge, la mer Méditerranée et l'espace occupé par le
Delta, ne formoi ent autrefois qu'une seule et même me r (4). Il paroît que, du temps
d Aristote, la vérité de cette tradition étoit généralement admise. O r , si le pa}s
iiabité par les Égyptiens, que l'on regardoit c omme la plus ancienne nation du
monde, est de formation nouvelle, ne doi t -on pas admettre que des changi.-racns
semblables ont eu lieu sur d'autres points de la terre! C'est ainsi, ajoute ce philosophe,
que les environs d'Argos, qui, lors de la guerre do Tr o i e , étoient des lieux
(1) Hérodote, iiv. Il, chap. S
{i] Meicoyoloi;. lib. i , cap. XIV.
{3) AltteçTolog. lU). 1, cap. s
(.,) nu.
,t 'i'
: fi
' ' ¿ M 1 1 i' ii u F f i ' ^ ^ H