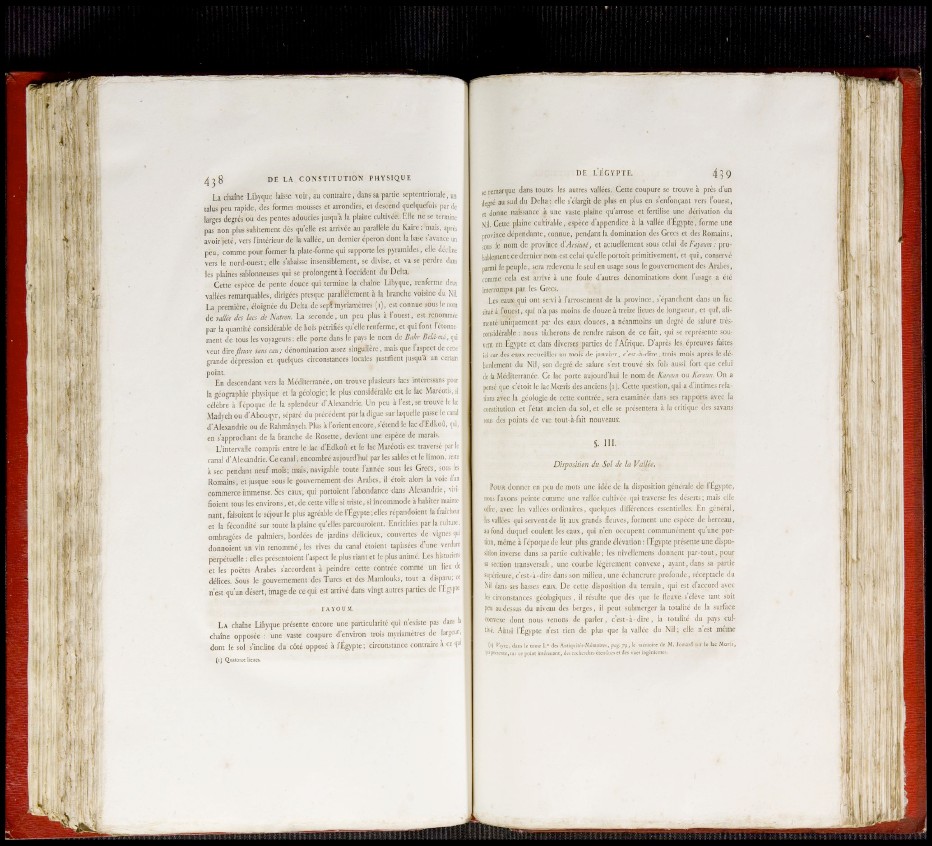
• I ' L - S .
D E LA C O N S T I T U T I O N P H Y S I Q U E
La chaîne Libyquc laisse v o i r , au contraire, dans sa partie septentrionale, ini
talus peu rapide, des formes mousses et arrondies, et descend quelquefois par de
larges degrés ou des pentes adoucies jusqu'à la plaine cultivée. Elle ne se termine
pas non plus subitement dès qu'elle est arrivée au parallèle du Kaire : mais, après
avoir jeté, vers l'intérieur de la vallée, un dernier épe ron dont la base s'avance un
peu, c omme pour former la plate-forme qui supporte les pyramides, elle dccllnc
vers le nord-oue s t ; elle s'abaisse insensiblement, se divise, et va se perdre dans
les plaines sablonneuses qui se prolongent à l'occident du Delta.
Cette espèce de pente douc e qui termine la chaîne Libyque, renferme deux
vallées remarquables, dirigées presque parallèlement à la branche voisine du Nil,
La pr emi è r e , éloignée du De l t a de sept myriamètres ( i ) , est connue sous le nom
de vallée des lacs de Natron. La s e c o n d e , un peu plus à l'ouest, est renommie
par la quantité considérable de bois pétrifiés qu'elle r enf e rme , et qui font l'étonnément
de tous les vo) ageurs: elle porte dans le pays le n om de Bahr Belû-mâ, qui
veut dire fleuve sans cm; dénominat ion assez singulière , mais que l'aspect de cetie
grande dépression et quelques circonstances locales justifient jusqu'à un certain
point.
En descendant vers la Médi t e r rané e , on trouve plusieurs lacs intéressans pour
la géographie physique et la g é o l o g i e ; le plus considérable est le lac Maréotis.si
célèbre à l'époque de la splendeur d'Alexandrie. Un peu à l'est, se trouve le iac
Madyeh ou d'Abouq\ r , séparé du précédent par la digue siu- laquelle passe le canal
d'Alexandrie ou de Ralimànyeh. Plus à l'orient enc o r e , s'étend le lac d'Edkoù, qui,
en s'approchant de la Branche de Ros e t t e , devient une espèc e de marais.
L'intervalle compri s entre le lac d'Edkoù et le lac Maréotis est traversé par ie
canal d'Alexandrie. Ce canal, encombré aujourd'hui par les sables et le limon, reste
à sec pendant neuf moi s ; mais, navigable toute l'année sous les Grecs, sous les
Romains, et jusque sous le g ouv e rnement des Arabes, il étoit alors la voie d'un
commerce immens e . Ses eaux, qui portoient l'abondance dans Al exandr i e, vi\ifioient
tous les envi rons , et, de cette ville si triste, si i n c ommo d e à habiter maintenant,
faisoient le séjour le plus agréable de l'Egypte ;elies répandoient la fraîcheur
et la f é condi t é sur t o u t e la plaine qu'elles parcouroient. Enrichies par la culture,
ombragées de palmiers, bordées de jardins délicieux, couvertes de vignes qui
donnoient un vin r e n ommé , les rives du canal é toi ent tapissées d'une verdme •
perpétuelle : elles présentoient l'aspect le plus riant et le plus animé. Les historiens
et les poe t e s Arabes s'accordent à peindre cette contrée c omme un lieu de
délices. Sous le gouve rnement des Tur c s et des Mamlouks , tout a disparu; ce
n'est qu'un désert, image de ce qui est arrivé dans vingt autres parties de l'Egvpie-
FAYOUM,
LA chaîne Libyque présente encor e une particularité qui n'existe pas dans la
chaîne opp o s é e : une vaste coupure d'environ trois myriamètres de largeur,
dont le sol s'incline du côté oppo s é à l'Égypte ; circonstance contraire à ce qm
(i) Quaiorie lieues.
(') dans le ti
pri,'si:iiie,sur ce point ir
DE L' ÉGYPTE. 4 ^ 9
se remarque dans toutes les autres vallées. Cette coupure se trouve à près d'un
Jcgré au sud du De l t a : elle s'élargit de plus en plus en s'enfonçant vers l'ouest,
et doJine naissance à une vaste plaine qu'arrose et fertilise une dérivation du
Nil. Cette plaine cultivable, espèc e d'appendice à la vallée d'Egypte, forme une
province dépendant e , c onnue , pendant la dominat ion des Grecs et des Romains ,
sous le n om de provinc e (XArshioé, et actuellement sous celui de Fayoum : prol)
al>lemcnt ce dernier n om est celui qu'elle portoit primitivement, et qui , conservé
parmi le peupl e , sera redevenu le seul en usage sous le gouve rnement des Arabes,
comme cela est arrivé à une foule d'autres dénoininations dont l'usage a été
interrompu par les Grecs.
Les eaux qui ont servi à i'arrosement de la provinc e , s'épanchent dans un lac
situé à l'ouest, qui n'a pas moins de douz e à treize lieues de longueur , et quî, alimente
uniquement par des eaux douc e s , a néanmoins un degré de salure trèsconsidérable
: nous tâcherons de rendre raison de ce fait, qui se représente souvent
en Égyi)te et dans diverses parties de l'Afrique. D'après les épreuves faites
ici sur des eaux recueillies au mois de janvier, c'est-à-dire, trois mois après le déj)
orclement du Ni l . son degré de salure s'est trouvé six fois aussi fort que celui
de la Méditerranée. Ce iac porte aujourd'hui le n om de Karoun ou Keroun. On a
pensé que c'étoit le iac Moer i s des anciens (i). Cette question, qui a d'intimes relations
avec la géologi e de cette c ont r é e , sera exatninée dans ses rapports avec la
constitution et l'état ancien du sol , et elle se présentera à la critique des savans
sous des points de vue tout-à-fait nouveaux.
§. I I I .
Disposition du Sol de la Vallée.
POUR donne r en peu de mot s une idée de la disposition générale de l'Egypte,
UOUJ l'avons peinte c omme une vallée cultivée qui traverse les déserts; mais elle
offre, avec les vallées ordinaires, quelques différences essentielles. En général,
les vallées (|ui servent de lit aux grands fieuves, forment une espèce de berceau,
au fond duquel coulent les eaux, qui n'en oc cupent c ommu n éme n t q u u n e portion,
même à l'époque de leur plus grande élévation : l'Égypte présente une di sposition
inverse clans sa partie cultivable; les nivellemens donnent pa r - t out , pour
sa section transversale, une courbe légèrement convexe , ayant, dans sa partie
supérieure, c'est-à-dire dans son mi l i eu, une éciiancrure pr o f onde , réceptacle du
Nil dans ses basses eaux. De cette disposition du terrain. qui est d'accord avec
les circonstances g é o l o g ique s . il résulte que dès que le Heuve s'élève tant soit
peu au-dessus du niveau des berges , il peut submerger la totalité de la surface
convexe dont nous venons de par l e r , c ' e s t - à - d i r e , la totalité du pays cultivé.
Ainsi l'Égypte n'est rien de plus que la vallée du Ni! ; elle n'est même
•' des Ainiqiiili's-iMénioires, pag. 79, !e
it, des rL(.lii.Tclics éleiKliu's et des vm
V .5
' I L