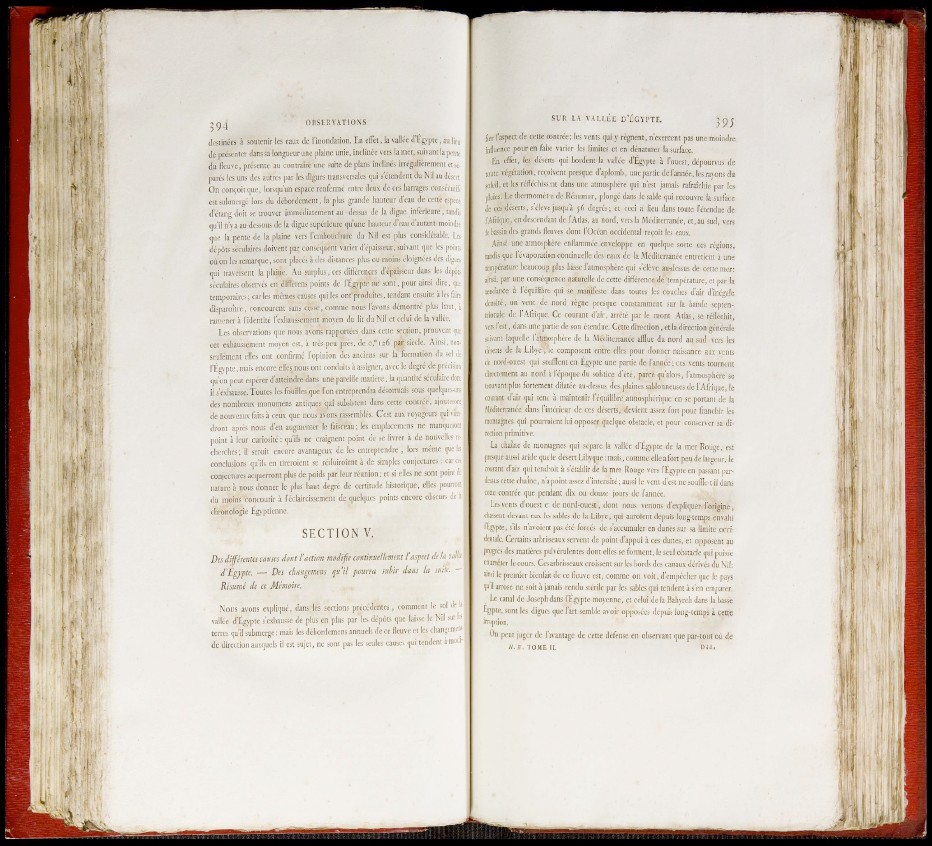
iTfRti.
j ! ' v:
Ç O B S E R V A T I O N S
destinées à soutenir les eaux de l'inondation. En effet, la vallée d'Égypte, au lieu
de présenter dans sa longueur une plaine unie, inclinée vers lamer, suivant la pente
du Heuve, présente au contraire une suite de |)lans inclinés irrégulièrement et séparés
les uns des autres par les digues transversales qui s'étendent du Nil au désert.
On conçoit que, lorsqu'un espace renfermé entre deux de ces barrages consécutirs
est submergé lors du débordement, la plus grande hauteur d'eau de cette espcce
d'étang doit se trouver immédiatement au-dessus de la digue inférieure, taïuli,
qu'il n'y a au-dessous de la digue supérieure qu'une hauteur d'eau d'autant moindre
que la pente de la plaine vers l'embouciiure du Nil est plus considérable. Les
dépôts séculaires doivent par conséquent varier d'épaisseur, suivant <[ue les points
où on les remarque, sont placés à des distances plus ou moins éloignées des digues
qui traversent la plaine. Au surplus, ces diirércnces d'épaisseur dans les dépôa
séculaires observes en difl'érens i)oints de l'Egypte ne sont , pour ainsi dire, (¡ue
temporaires; caries mêmes causes qui les ont produites, tendant ensuite à les faire
disparoîire, concourent sans cesse, comme nous l'avons démontré ])lus haut, à
ramener à l'identité l'exhaussement moyen du lit du Nil et celui de la vallée.
Les observations que nous avons rapportées dans cette section, j)rouvcnt que
cet exhaussement moyen est, à très-peu près, de o^ - i zô par siècle. Ainsi, nonseulement
elles ont confirmé l'opinion des anciens sur la formation du sol de
l'Ég) pte, mais encore elles nous ont conduits à assigner, avec le degré de préci.qon
qu'on peut espérer d'atteindre dans une pareille matière, la quantité séculaire dont
il s'exhausse. Tout e s les fouilles que l'on entreprendra désormais sous ([uelqucs-uns
des nombreux monumens antiques qui subsistent dans cette contrée, ajoiiterom
de nouveaux faits à ceux que nous avons rassemblés. C'est aux voyageurs (]ui viendront
après nous d'en augmenter le faisceau ; les emplacemens ne i-nanqucront
point à leur curiosité : qu'ils ne craignent point de se livrer à de nouvelles recherches;
il seroit encore avantageux de les entreprendre , lors même que les
conclusions qu'ils en tireroient se réduiroient à de simples conjectures : car CCJ
conjectures acqueiTont plus de poids par leur réunion ; et si elles ne sont poiiu de
nature à nous donner le plus haut degré de certitude historique, elles pourront
du moins concourir à l'éclaircissement de quelques points encore obscurs de la
chronologie Égyptienne.
S E C T I O N V.
Des différentes causes dont l'action modifie continue llcinent l'aspect delà rallêc
d'Ègjpte. —- Des chan^emens qu'il pourra subir dans la suite. —
Résumé de ce Mémoire.
Nous avons expliqué, dans les sections précédentes , comment le sol cicla
vallée d'Égypte s'exhausse de plus en plus par les dépôts (|ue laisse le Nil sur les
terres qu'il submerge : mais les débordemens annuels de ce fleuve et les clianpmen»
de direction auxquels il est sujet, ne sont pas les seules causes qui tendent à modi-
SUR LA VALLÉE D'LCYPTE.
ftcr l'aspect de cette contrée; les vents qui y régnent, n'exercent pas une moindre
induence pour en faire varier les limites et en dénaturer la surface.
En effet, les déserts (¡ui bordent la vallée d'Égypte à l'ouest, dépourvus de
toute végétation, reçoivent presque d'aplomb, une partie de l'année, les rayons du
soleil, et les réfféchissent dans une atmosphère qui n'est jamais rafraîchie par les
pluies. Le thermomètre de Reaumur, plongé dans le sable qui recouvre la surface
de ces déserts, s'élève jus<[u'à 56 degrés; et ceci a lieu dans toute l'étendue de
l'Afrique, en descendant de l'Atlas, au nord, vers la Méditerranée, et, au sud, vers
le bassin des grands fleuves dont l'Océan occidental reçoit les eaux.
Ainsi une atinosphère cnlîamjuée enveloppe en quelque sorte ces régions,
tandis que l'évaporation continuelle des eaux de la Méditerranée entretient à une
température beaucoup plus basse l'atmosphère qui s'élève au-dessus de cette mer:
ainsi, par une conséquence naturelle de cette difference de température, et par la
tendance à l'équilibre qui se manifeste dans toutes les couches d'air d'inégale
densité, un vent de nord règne presque constamment sur la bande septentrionale
de l'Afi-ique. Ce courant d'air, arrêté par le mont Atlas, se réfiécliit,
vers l'est, dans une partie de son étendue. Cette direction, et la direction générale
suivant laijuelle l'atmosphère de la Méditerranée afïïue du nord au sud vers les
déserts de la Libye , se composent entre elles pour donner naissance aux vents
de nord-ouest qui soufflent en Egypte une partie de l'année ; ces vents tournent
directement au nord à l'époque du solstice d'été, parce qu'alors, l'atmosphère se
trouvant plus fortement dilatée au-dessus des plaines sablonneuses de l'Afrique, le
courant d'air qui tend à maintenir l'équilibre atmosphérique en se portant de la
Méditerranée dans l'intérieur de ces déserts, devient assez fort pour franchir les
montagnes qui pourroient lui opposer quelque obstacle, et pour conserver sa direction
primitive.
La chaîne de montagnes qui sépare la vallée d'Égypte de la mer Rouge, est
presque aussi aride que le désert Libyque: mais, comme elle a fort peu de largeur, le
courant d'air qui ten droit à s'établir de la mer Rouge vers l'Egypte en passant pardessus
cette chaîne, n'a point assez d'intensité; aussi le vent d'est ne souiile-t-il dans
cette contrée que pendant dix ou douze jours de l'année.
Les vents d'ouest et de nord-ouest, dont nous venons d'expliquer l'origine ,
chassent devant eux les sables de la Libye, qui auroient depuis long-temps envahi
rEg}pte, s'ils n'avoient pas été forcés de s'accumuler en dunes sur sa limite occidentale.
Certains arbrisseaux servent de point d'appui à ces dunes, et opposent au
progrès des matières pulvérulentes dont elles se forment, le seul obstacle qui puisse
en arrêter le cours. Ces arbrisseaux croissent sur les bords des canaux dérivés du \ i l :
ainsi le premier bienfait de ce ffeuve est, comme on voit, d'empêcher que le pays
qu'il arrose ne soit à jamais rendu stérile par les sables qui tendent à s'en emparer.
Le canal de Joseph dans l'Egypte moyenne, et celui delà Bahyreh dans la basse
Egypte, sont les digues que l'art semble avoir opposées depuis long-temps à cette
irruption.
On ])cut juger de l'avantage de cette défense en observant que par-tout où de
II. N. TOME II. Oddi
SI