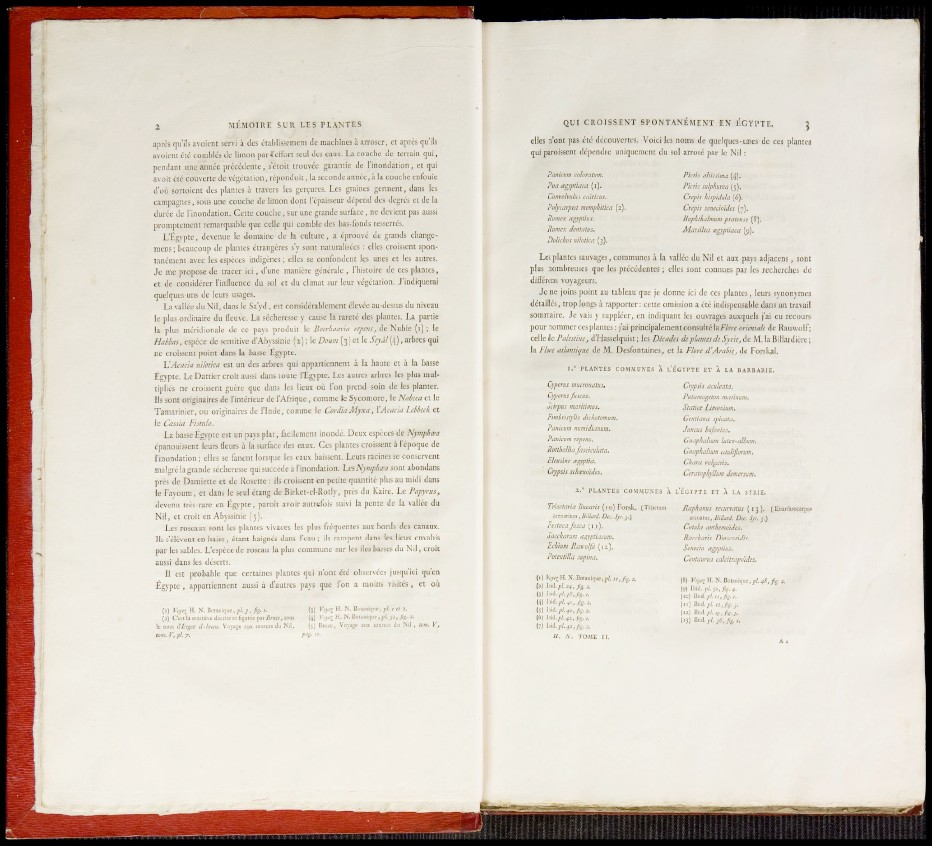
2 MÉMO I R E S D R L E S P L A N T E S
après qu'ils avoicnt servi à des ctablisscmens de raaciiînes à arroser, et après qu'ils
avoient ctc coiubiés de limon par 4 effort seul des eaux. La couche de terrain qui ,
pendant une année p r é c é d e n t e , s c t o i t trouvée garantie de l ' inonda t ion, et qui
avoit été couverte de végétation, r é p o n d o i t , la seconde anné e , à la couclie enfouie
d'où sortoient des plantes à travers les gerçures. Les graines g e rme n t , dans les
campagnes, sous une couche de limon d o n t 1 "épaisseur dépend des degrés et de la
durée de l'inondation. Ce t t e c o u c h e , sur une grande surface, ne devient pas aussi
promptement remarquable que celle qui combl e des bas-fonds resserrés.
L'Egypte, devenue le doma ine de h c u l t u r e , a éprouvé de grands changemens;
be aucoup de plantes étrangères s'y sont naturalisées : elles croissent spontanément
avec les espèces indigènes ; elles se c o n f o n d e n t les unes et les autres.
J e me propos e de tracer ici , d'une manière générale , l'histoire de ces pl ant e s,
e t de considérer l'influence du sol et du climat sur leur végétation. J'indiquerai
quelques-uns de leurs usages.
La vallée du Ni l, dans le Sa'yd , est considérablement élevée au-dessus du niveau
le plus ordinaire du fleuve. La sécheresse y cause la rareté des plantes. La partie
la plus méridionale de ce pays produi t le Bocrhaavia repcns, ¿e. Nubi e (i) ; le
Habbas, espèce de sensitive d'Abyssinie (2); \ c. Down (3) et le Seyâl (4), arbres qui
ne croissent point dans la Lasse Egypte.
Acacia nilotica est un des ai'brcs qui appa r t i ennent à la haute et à la basse
Egypte. Le Da t t i e r croît aussi dans t o u t e rÉg ) p t e . Les autres arbres les plus multipliés
ne croissent guère que dans les lieux où l'on pr end soin de les planter.
Ils sont originaires de l'intérieur de l'Afrique > c omme le Sy c omo r e , ie i^abcca et le
Tamarinier, ou originaires de l ' Inde , c omme le Cordia Aiyxa, \ Acacia Lcòbeck et
l e Cassia Fi sitila.
La basse Ég)'pte est un pays p l a t , facilement inondé. De u x espèces de Nymphoea
épanouissent leurs fleurs à la surface «les eaux. Ce s plantes croissent à l'époque de
l'inondation; elles se f anent lorsque les eaux baissent. Leurs racines se conservent
malgré la gr ande séclieresse qui succède à l'inondation. 'LesNympJioea sont abondans
près de Dami e t t e et de Ros e t te : ils croissent en petite quantité plus au midi dans
ie F a v o um, et dans le seul étang de Birket-el-Rotly, près du Kaire. Le Papyrus,
devenu très-rare en Ég v p t e , paroît avoir autrefois suivi la pent e de la vallée du
N i l , et croît en Abyssin ie (5).
Les roseaux sont les plantes vivaces les plus fréquentes aux bords des canaux.
Ils s'élèvent en haies , étant baignes dans l'eau ; ils r ampent dans les lieux envahis
par les sables. L'espèce de roseau la plus c ommu n e sur les iles basses du Ni l , croît
aussi dans les déserts.
II est probabl e que certaines plantes qui n'ont été observées jusqu'ici qu'en
Egypte , appa r t i ennent aussi a d'autres pays que l'on a moins visités, et où
(1) yo}fz H. N. Botanique, /•
(3) C' t s i la sensitive décrue et figurée par Bruce, sous
le nom d'£rgeti el-hrone. Voyage aux sources du Ni l ,
wm. Kpl.7.
(3) Voyei H. N. Botanique, pl. , et 2.
(4) N- Botanique , ;;/, p.fia. 2.
(5) Orucc , Voyage aux sourcw du Nii ,
pas- 10.
QUi C R O I S S E N T S P O N T A N ÉME N T EN E G Y P T E . ^
elles n'ont pas été découvertes. Voici les noms de quelques-unes de ces plantes
qui paroissent dépendre uniquement du sol arrosé par le Nil :
Pauicum cûÎoraium.
Poa agypthicn (i).
Convolvulus cdiricus.
Polycarpen mempbitica ( 2 ) .
Runiex isgyptius.
Rumex dcntatus.
DoHchos miotica (3).
Pkr'is altissima ( 4 ) .
Pi cris sulphurea (5).
Crépis hispidula (ó).
Crépis senecioides ( 7 ) ,
Buphthalmum pratense ( 8 ) .
Marsilea cegyptiaca ( 9 ) .
Les plantes sauvages, commune s à la vallée du Nil et aux pays a d j a c e n s , sont
plus nombreuses que les précédentes ; elles sont connues par les re cherches de
différens voyageurs.
J e ne joins point au tableau que je donne ici de ces pl ant e s , leurs synonymes
détaillés, trop longs ¿ r a p p o r t e r : cette omission a été indispensable dans un travail
sommaire. Je vais y suppléer, en indiquant les ouvrages auxquels j'ai eu recours
pour n omme r ces plantes : j'ai jn-incipalement consulté l a i ^ r r orientale de Rauwol f ;
c e l l e d e Palestine, d ' H a s s e l q u i s t ; l e s Décades de plantes de Syrie, de M . la B i l i a r d i è r e ;
l a Flore mUm tique de A I . D e s f o n t a i n e s , et la Flore d'Arabie, de F o r s k a l .
I . " P L A N T E S C O M M U N E S À L ' É C Y P T E ET À LA B A R B A I U E .
Cyperus tnucronatus.
Cyperus fuscus.
Scirpus maritimus.
Fimbristylis dichotomuni.
Pcniicum numiJianum.
Panicum repens.
Rotthollia fasciculata.
Eleusine amplia.
Crypsis schoenoïdes.
Crypsis aculeata.
Potamogeton marinum.
Statice Limonium.
Gentiana spicata.
Juncus bufouius.
Gnaphalium luteo-alhum.
Guapkalium caulifiorum.
Chara vulgaris.
Ccratophyllum demersum.
2." P L A N T E S C O M M U N E S À L E G ï P T E ET À LA SYR I E .
Trisctaria linearis ( 1 0 ) F o r s k . (Tr i s e tum
arenarium, BiUard. Dcc. Syr. j. )
Festuca fisca (11).
Saccharum tisyptiacum.
Ecliium Rawolfii (i 2 ) ,
Poteutilla supina.
(1) VoyeiW. N. Bot anique ,p/ . 10, f ^. 2.
(2)
(3) WM.pl.jS.Jig.,.
(4) \ h \ à . p l . ^ , , f , s . 2 .
(5) \ h \ A. pl. , fi^. z.
(6)
(7) ìh\<ì.pl.^,fig.2.
n . N. T O M E H.
Raphanus recurvatus { 1 3 ) . ( Enarthrocarpus
arcuatus, BUlard. Dec. Syr.
Cottila anthemoides.
Baccharis Dioscoridis.
Senecio agyptius.
Centdurea calcitrapoides.
(8) Voyei H. N. Botanique, fg. 2.
(9) Ibid.
(10) \ h \ à. pl. „, Jig. ¡.
( n ) ihxd.pi,2,jis.^.
(12) Ibid.;./. tp.fig.j.
(>3) Ihxà. pl. j6, fig.