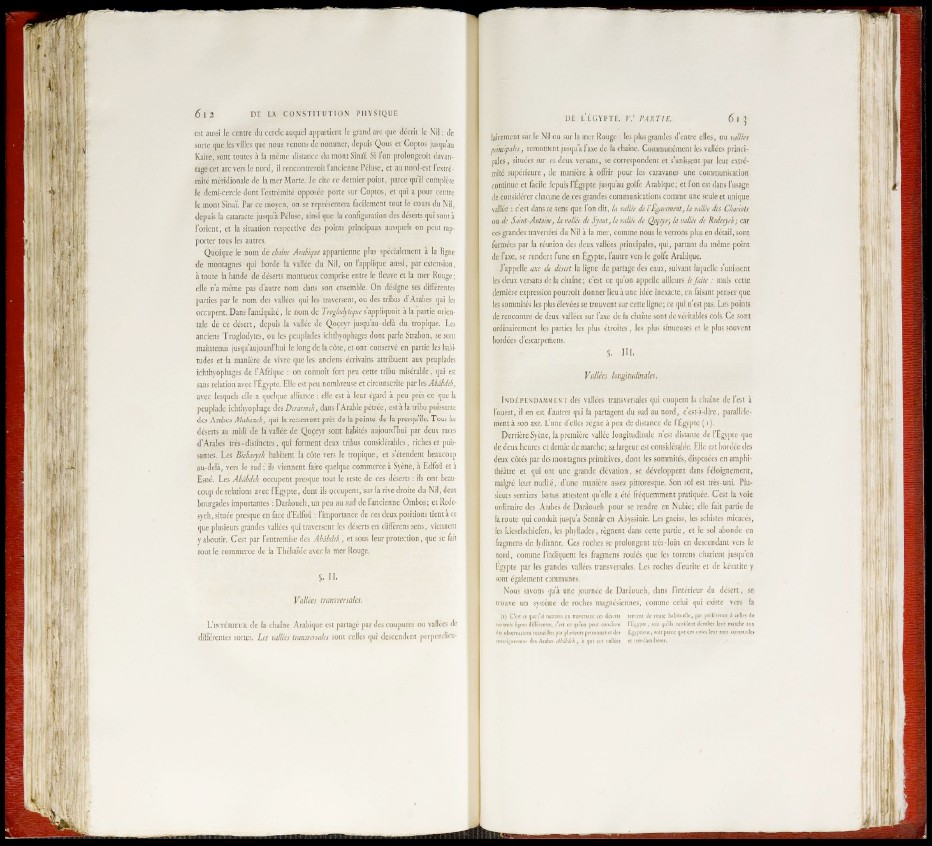
iii^
6 1 2 Dr. L\ C O N S T I T U T I O N P t I V S l Q U E
est aussi le c ent r e du c e r c l e auquel appar t ient le grand arc ( |ue déc r i t le Ni l : de
sor te que les villes que nous venons de n omme r , depui s Qo u s et Co p t e s jusqu'au
Ka i r e , sont toutes à la même di s tance du mo n t Sinaï. Si l 'on pr o l onge o i t davan
tage cet ar c vers le no rd, il r c n c o n t r e r o i t l 'anc ienne Pc lus e , et au nord-es t l'cxtrcmi
t é mé r idi ona l e de la me r Mo r t e . J e c i te c e de rni e r po i n t , par ce qu'il compl è t e
le demi - c e r c l e donc l 'ext rémi té oppo s é e po r t e sur C o p t o s , et qui a pour cent re
le mo n t Sinaï . Pa r c e mo y e n , on se r epr é s ent e r a f a c i l ement tout le cour s du Ni l ,
dej )uis la catarac te jusqu'à Pc lus e , ainsi que la conf igurat ion des déserts qui sont à
l ' o r i e n t , e t la si tuat ion r e spe c t ive des point s pr inc ipaux auxquels on peut rappo
r t e r tous les aut res.
Qu o i q u e le n om de c/iaine Arabique appa r t i enne plus spé c i a l ement à la ligne
d e mont a gne s qui borde la vallée du Ni l , on l'applique aussi , par ext ens ion,
à tout e la bande de déser ts montueux c ompr i s e ent r e le fleuve et la me r Rouge ;
el le n'a même pas d'aut re n om dans s on ens embl e . O n dés igne ses difFérentes
parties pai- le n om des vallées qui les t raver sent , ou des tribus d'Ar abe s qui les
o c cupent . Da n s l 'ant iqui t é , le n om de Troglodytlque s'appl iquoi t à la par t ie orientale
de c e dé s e r t , depui s la vallée de Qo ç e y r jusqu' au-de là du t ropique . Les
anc i ens Tr o g l o d y t e s , ou les peuplades icht l iyophages dont par le S t r abon, se sont
ma int enus jusqu'aujourd'hui le long de la c ô t e , et ont cons e rvé en par t ie les habitudes
et la mani è r e de vivre que les anc i ens écr ivains at t r ibuent aux peuplades
i chthyophage s de l 'Af r ique : o n c o n n o î t for t peu c e t t e t r ibu mi s é r a b l e , qui est
sans relat ion ave c l 'Egypte. El l e est peu nomb r eus e e t c i r cons c r i t e par les Abâbdé,
a v e c lesquels el le a quelque al l iance : elle est à leur égard à peu près c e que la
peuplade i chthyophage des Dcmnnch, dans l 'Ar abi e pé t r é e , est à la tribu puissante
de s Ar a b e s Mahazeh, qui la res ser rent près de la point e de la presqu'île. T o u s les
déser t s au midi de la vallée de Qo ç e y r sont habi tés aujourd'hui par deux races
d'Ar a b e s très - di s t inc t e s , qui f o rme n t deux tribus cons idé r abl e s , r i ches e t puissantes.
L e s Bicharyeh habi t ent la c ô t e vers le t r opi que , e t s ' é t endent beaucoup
au-de l à , vers le sud ils vi ennent faire quelque c omme r c e à S y è n e , à Edfoi l et à
Esné . L e s Abâbdch o c c u p e n t presque tout le res te de ces déserts : ils ont beauc
o u p de r elat ions ave c l 'Egypt e , dont ils o c c u p e n t , sur la r ive droi t e du Ni l , deux
bourgade s impor t ant e s : Da r â o u e h , un peu au sud de l ' anc i enne Omb o s ; e t Redesyeh,
s i tuée presque en face d'Edf oû : l ' impor t anc e de ces deux pos i t ions t ient à ce
que plusieurs grandes vallées qui t raver sent les déserts en di f férens s ens , viennent
y about i r . C' e s t par l ' ent r emi se des Abâbdch , et sous leur p r o t e c t i o n , que se fait
tout le c omme r c e de la T h é b a ï d e ave c la me r Rouge .
§. I I .
Vallées transversales.
L ' i n t é r i e u r de la cha îne Ar a b ique est par tagé par des coupur e s ou vallées de
di f férentes sortes. Les vallées transversales sont celles <jui de s c endent pc rpcndi cul
) E L L G Y I ' T F . . V! PARTIE. 6 \ T
lai icmcnt sur le Ni l ou sur la me r Rouge : les plus grandes d' ent r e e l l e s , ou vallées
principales, r emont ent jusqu'à l'axe de la chaîne. C ommu n éme n t les vallées pr inc i -
| )ales, situées sur les deux ver sans , se c o r r e spondent et s'unissent par leur ext rémité
supér ieur e , de mani è r e à of f r i r pour les caravanes une c ommu n i c a t i o n
cont inue et faci le depui s l 'Égypte jusqu'au gol fe Ar a b ique ; et l'on est dans l'usage
<[e cons idé r e r cha cune de ces grandes c ommuni c a t i ons c omme une seule et unique
vallée : c'est dans c e sens que l'on di t , la vallée de l'Egarement, la radiée des Chariots
ou de Saint-Antoine, la vallée de Syout, la vallée de Qoç^yi", l" vallée de Redesyeli; car
ces grandes traversées du Ni l à la me r , c omme nous le ve r rons plus en détai l , sont
formées par la r éunion des deux vallées pr inc ipales , qui , j )ar tant du même point
de l'axe, se r endent l'une en Eg ypt e , l'autre vers le gol f e Arabique.
J ' appe l l e <ixe du désert la l igne de par tage des eaux, suivant laquel le s'unissent
les deux versans de la cha îne ; c'est c e qu'on appel le ailleurs le faîte : mais c e t t e
dernière expression pour roi t do n n e r lieu à une idée inexa c t e , en faisant penser que
les sommi t é s les plus élevées se t rouvent sur c e t t e l igne ; c e qui n'est pas. L e s point s
de r enc ont r e de deux vallées sur l'axe de la cha îne sont de vér i tables cols. C e sont
ordinai r ement les par t ies les plus é t r o i t e s , les plus sinueuses et le plus souvent
bordées d' es carpemens .
§. l i i .
Vallées longitudinales.
I n d é p e n d a . m m e n t des vallées transversales qui coupent la cha îne de l'est à
l 'ouest , il en est d'autres qui la j jar tagent du sud au n o r d , c'es t -à-di re, paral lèlement
à son axe. L ' u n e d'elles r ègne à peu de di s tance de l 'Egypte ( 1 ).
De r r i è r e S ) è n e , la pr emi è r e vallée longi tudinale n'est di s tante de l ' Ég j p t e que
de deux heures et demi e de ma r c h e ; sa largeur est cons idérable. El l e est bordé e des
deux côt é s par des mont agne s pr imi t ive s , dont les sommi t é s , disposées en amph i -
théâtre et qui o n t une grande é l é v a t i o n , se déve l oppent dans l ' e l o i g n eme n t ,
malgré leur n udi t é , d'une mani è r e assez pi t toresque. S on sol est t r è s -uni . Plusieurs
sent ier s battus at testent qu'elle a été f r é quemment prat iquée. C' es t la vo i e
ordinai re des Ar abe s de Da r â oueh p our se r endr e en Nub i e ; el le fait par t ie de
la rout e qui condui t jusqu'à Sennà r en Abys s inie. Le s gnei s s , les schistes mi c a c é s ,
les ki e s e l s chi e f e r s , les phyl l ade s , r égnent dans c e t t e pa r t i e , et le sol abonde en
fragmens de Ivdienne. Ce s r oche s se pr o l ongent t r è s - loin en de s c endant vers le
nord, c omme l ' indiquent les f ragniens roulés que les tor rens char ient jus quen
Egypte par les grandes vallées transversales. L e s roche s d'eur i te et de kérat i te y
sont éga l ement c ommun e s .
Nous savons qu'à une j ourné e de Da r â o u e h , dans l ' intér ieur du d é s e r t , se
t rouve un système de roches magné s i enne s , c omme celui qui existe vers la
(1) CVsi ce que i'.ii reconnu cr
ii.ibiciielle, par [»rifcrcnce à celles
sur [rois lignes cliffcrciiics; cVst c
qu'on peiil conclii'-e riigypte,
'ils veiiiileiic dérober leur marche a
«les ol)iervaiions n-cueillies p.ir |>li
l'.gypiieiis, soil p.nrce (|i
K-nscignemcn^ des Aralies Al'.ihMi
Cl ués-ramilicres.
3 . ' '
i l ' I