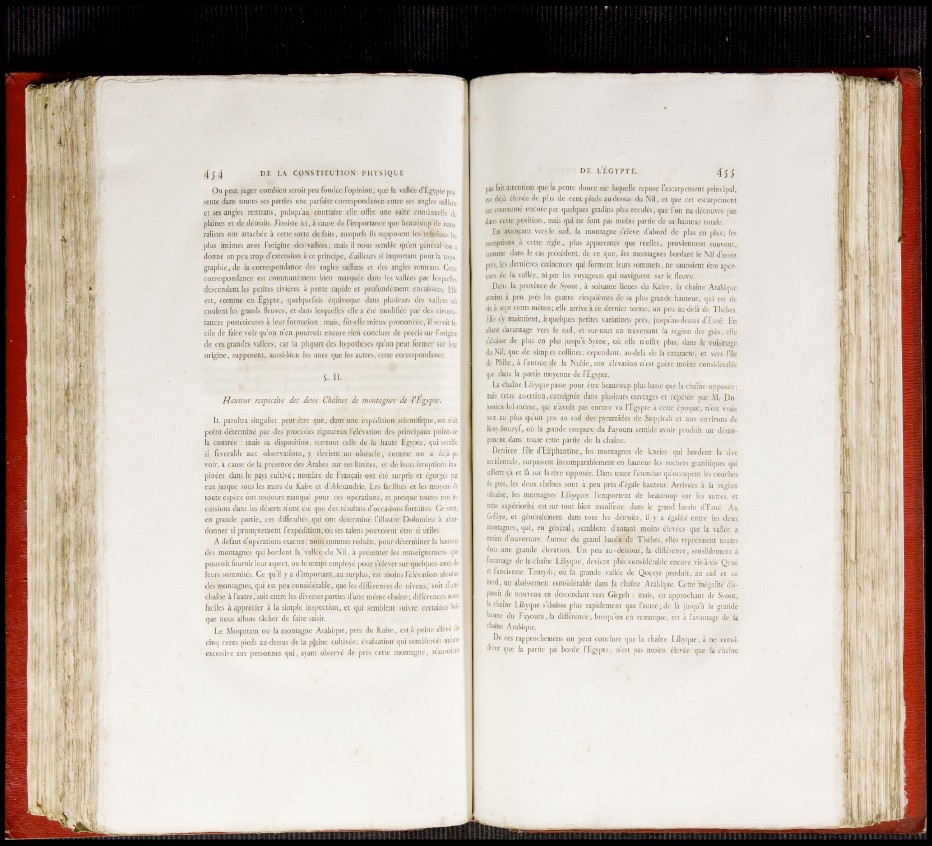
r . i i r i ' i - ' '
s : U
4 j 4 DE LA CONSTITUTION PHYS IQUE
On pent juger combien seroit peu fondée l'opinion, que la vallee d'Égvpic presente
clans toutes ses parties une parfaite correspondance entre ses angles sailians
et ses angles remrans, puiscpiau contraire elle olfre une suite continuelle de
plaines et de détroits. J'insiste ici, à cause de l'importance que beaucoup de naturalistes
ont attachée à cette sorte de faits, auxquels ils supposent les relations les
plus intimes avec l'origine des vallées ; mais il nous semble qu'en général ou a
donné un peu trop d'extension à ce principe, d'ailleurs si important pour la topographie,
de la correspondance des angles sailians et des angles rentrans. Ccuc
correspondance est communément bien marquée dans les vallées par lescjuellcs
descendent les petites rivières à pente rapide et profondément encaissée,-;. Cile
est, comme en Égypte, quelquefois équivoque dans plusieurs des vallées où
coulent les grands fleuves, et dans lesquelles elle a été modifiée par des circonstances
postérieures à leur formation : mais, fùt-elle mieux prononcée, il seroit facile
de faire voir qu'on n'en pourroit encore rien conclure de précis sur l'origine
de ces grandes vallées: car la plupart des hypothèses qu'on peut former sur leur
origine, supposent, aussi-bien les unes que les autres, cette correspondance.
§. H.
Hauteur respective des deux Chaînes de montagnes de VEg)'pte.
IL paroîtra singulier peut-útre que, dans une expédition scientifique, on n'ait
point déterminé par des procédés rigoureux l'élévation des principaux points de
la contrée : mais sa disposition, sur-tout celle de la haute Égypte, qui semble
si favorable aux observations, y devient im obstacle, comme on a déjà pu
voir, à cause de la présence des Arabes sur ses limites, et de leurs irruptions inopinées
dans le pays cultivé ; nombre de Français ont été surpris et égorgés par
eux jusque sous les murs du Kaire et d'Alexandrie. Les facilités et les movensde
toute espèce ont toujours manqué pour ces opérations, et presque toutes nos incursions
dans les déserts n'ont été que des résultats d'occasions fortuites, Ce sont,
en grande partie, ces difficultés qui ont déterminé l'illustre Dolomieu à abandonner
si proinptement l'expédition, où ses talens pouvoient être si utiles.
A défaut d'opérations exactes, nous sommes réduits, pour déterrniner la hauteui
des montagnes qui bordent la vallée du Nil, à présenter les renseignemens <|ue
pouvoit fournir leur aspect, ou le temps employé ]>our s'élever sur quelques-unes de
leurs sommités. Ce qu'il y a d'important, au surplus, est moins l'élévation absolue
des montagnes, qui est peu considérable, que les dilFérences de niveau, soit d'une
chaîne à l'autre, soit entre les diverses parties d'une même chaîne ; différences assez
faciles à apprécier à la simple inspection, et qui semblent suivre certaines loi.-
que nous allons tâcher de faire saisir.
Le Moqattam ou la montagne Arabique, près du Kaire, està peine élevé de
cinq cents pieds au-dessus de la pjaine cultivée; évaluation qui sembleroit nicme
excessive aux personnes qui, ayant observé de près cette montagne, n'auroicni
DE L'ÉGYPTE. 4 j j
pas fait attention que la pente douce sur laquelle repose l'escarpement principal,
est déjà élevée de plus de cent pieds au-dessus du Nil, et que cet escarpement
est couronné encore par quelques gradins plus reculés, que l'on ne découvre pas
dans cette position, mais qui ne font pas moins partie de sa hauteur totale.
En avançant vers le sud, la montagne s'élève d'abord de plus en plus; les
exceptions à cette règle, JJIUS appai-entes que réelles, proviennent souvent,
comme dans le cas précédent, de ce que, les montagnes bordant le Nil d'assez
près, les dernières eminences qui forment leurs sommets, ne sauroient être aperçues
de la vallée, ni par les voyageurs .qui naviguent sur le fleuve.
Dans la province de Syout, à soixante lieues du Kaire, la chaîne Arabique
atteint à peu près les quatre cinijuièmes de sa plus grande hauteur, qui est de
six à sept cents mètres ; elle arrive à ce dernier terme, un peu au-delà de Thèbes.
Elle s'y maintient, à quelques petites variations près, jusqu'au-dessus d'Fsné. En
allant davantage vers le sud, et sur-tout en traversant la région des grès, elle
s'abaisse de plus en plus jusqu'à Syène, où elle n'offre plus, dans le voisinage
du Nil, que de simples collines; cependant, au-delà de la cataracte, et vers l'île
de Phila:, à l'entrée de la Nubie, son élévation n'est guère moins considérable
que dans la partie moyenne de l'Ég)pte.
La chaîne l.ib) que passe pour être beaucoup plus basse que la chaîne opposée ;
mais cette assertion, consignée dans plusieurs ouvrages et répétée par iM. Dolomieu
lui-même, qui n'avoit pas encore vu rÉg)'pte à cette époque, n'est vraie
tout au plus qu'un peu au sud des pyramides de Saqq.îrah et aux environs de
Ben)-Soueyf, où la grande coupure du Fayoum semble avoir produit un dérangement
dans toute cette partie de la chaîne.
Derrière l'île d'Éléphantine, les montagnes de kneiss qui bordent la rive
occidentale, surpassent incomparablement en hauteur les rochers granitiques qui
saillent çà et là sur la rive opposée. Dans toute l'étendue qu'occupent les couches
de grès, les deux chaînes sont à peu près d'égale hauteur. Arrivées à la région
calcaire, les montagnes Libyques l'emportent de beaucoup sur les autres, et
ce«e supériorité est sur-tout bien manifeste dans le grand bassin d'Esné. Au
Qibleyn, et généralement dans tous les détroits, il y a égalité entre les deux
montagnes, qui, en général, semblent d'autant moins élevées que la vallée a
moins d'ouverture. Autour du grand bassin de Thèbes, elles reprennent toutes
deux une grande élévation. Un peu au-dessous, la différence, sensiblement à
l'avantage de la chaîne Lib}que, devient plus considérable encore vis-à-vis Qené
et l'ancienne Tent)ris, où la grande vallée de Qoçeyr produit, au sud et au
nord, un abaissement considérable dans la chaîne Arabique. Cette inégalité disparoît
de nouveau en descendant vers Girgeh : mais, en approchant de S\out,
la chaîne Libyque s'abaisse plus rapidement que l'autre; de là jusqu'à la grande
lacune du Fayoum, la différence, lorsqu'on en remarque, est à i'a\cunage de la
chaîne Arabique.
l^e ces rapprochcmens on peut concliu-e que la chaîne Libyque, à ne consi-
«Icrer que la partie qui borde l'Ég}ptc, n'est pas moins élevée que la chaîne
i " Il
i ü