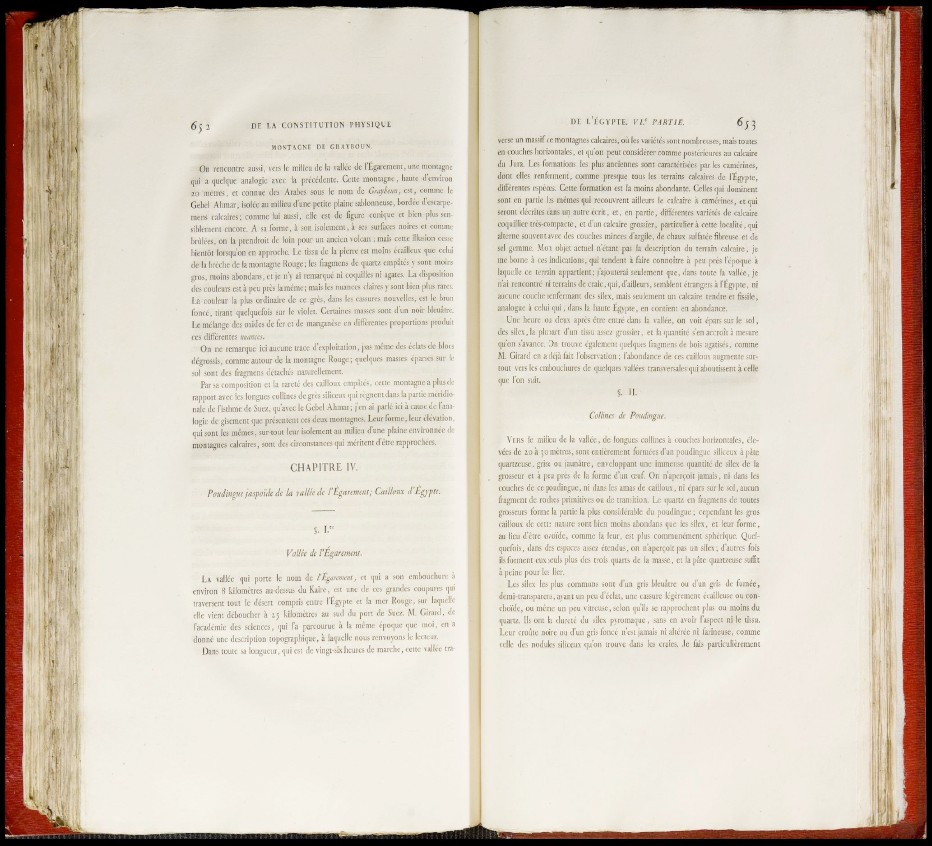
6 5 2 DE LA C O N S T I T U T I O N P H Y S I Q U E
MONTAGNE DE G R A Y B O U N .
On rencontre aussi, vers le milieu Je la vallée de l 'Égaiement , une montagne
qui a quelque analogie avec la précédente. Cet te mont a gne , haute d'environ
20 mèt res , et connue des Arabes sous le n om de Craybmm, es t , comme le
Gebel A hma r , isolée au milieu d'une petite plaine salilonneuse, bordée d'escarpcmens
calcaires; c omme lui aussi, elle est de figure conique et bien plus sensiblement
encore. A sa f o rme , à son i solement , à ses surfaces noires et comme
brûlées, on la prendroi t de loin pour un ancien volcan : mais cette illusion cesse
bientôt lorsqu'on en approche. Le tissu de la pierre est moins écailleux que celui
de la brèche de la montagne Roug e ; les fragmens de quartz empâtés y sont moins
gros, moins abondans, et je n'y ai remarqué ni coquilles ni agates. La disposition
des couleurs est à peu près la même ; mais les nuances claires y sont bien plus rares.
L a couleur la plus ordinaire de ce grès, dans les cassures nouvel les, est le brun
foncé, tirant quelquefois sur le violet . Certaines masses sont d'un noir bleuâtre.
L e mélange des oxides de fer et de manganèse en différentes propor t ions produit
ces différentes nuanccs.
O n ne remarque ici aucune trace d'exploi tat ion, pas même des éclats de blocs
dégrossis, c omme autour de la montagne Ro u g e ; quelques masses éparses sur le
sol sont des fragmens détachés naturellement.
Par sa compos i t ion et la rareté des cailloux empâtés, cette montagne a plus de
rapport avec les longues collines de grès siliceux qui régnent dans la partie méridionale
de l'isthme de Suez, qu'avec le Gebel Ahma r ; j'en ai parlé ici à cause de l'analogie
de gisement que présentent ces deux montagnes. Leur f o rme , lem- élévation,
qui sont les même s , sur-tout leur isolement au milieu d u n e plaine envi ronnée de
montagnes calcaires, sont des circonstances qui méritent d'être rapprochées.
C H A P I T R E I V .
Poudingue jasfoïde de la vallée de l'Égaremeiit; CalUom d'Egypte.
Vallée de l'Egarement.
L A vallée qui porte le nom de l'Égarement, et qui a son embouchure à
environ 8 ki lomètres au-dessus du Ka i r e , est une de ces grandes coupures i|ui
traversent tout le désert compr is entre l'Egypte et la mer Ro u g e , sur laquelle
elle vient déboucher à 25 ki lomètres au sud du por t de Suez. M. Gi r a rd, de
l'académie des sciences , qui l'a parcourue à la même époque que mo i , en a
donné ime description topographique, à laquelle nous renvoyons le lecteur.
Dans toute sa longueur , qui est de vingt-six heures de mar che, cette vallée tram
DH L ' É G V P T E . VI.' PARTIE.
verse un massif de montagnes calcaires, où les variétés sont nombreuses, mais toutes
en couches Iiori/ontales, ei ([u'on peut considérer comme postérieures au calcaire
du Jura. Le s formations les plus anciennes sont caractcrisées par les camér ines,
dont elles renferment , c omme presque tous les terrains calcaires de l 'Egypte,
différentes espèces. Cet te format ion est la moins abondante. Celles (jui dominent
sont en partie les mêmes qui recouvrent ailleurs le calcaire à camér ines, et qui
seront décrites dans un autre écr i t , e t , en part ie, différentes variétés de calcaire
coquillier t rès-compacte, et d'un calcaire grossier, particulier à cette local i té, qui
alterne souvent avec des couches minces d'argile, de chaux sulfatée fibreuse et de
sel gemme. Mo n objet actuel n'étant pas la description du terrain calcai re, je
me borne à ces indicat ions, qui tendent à faire connoî t re à peu près l'époque à
laquelle ce terrain appart ient; j'ajouterai seulement que, dans toute la val lée, je
n'ai rencontré ni terrains de craie, qui, d'ailleurs, semblent étrangers à l 'Egypte, ni
aucune coucl ic renfermant des silex, mais seulement un calcaire tendre et fissile,
analogue à celui qui , dans la haute Egypte, en cont ient en abondance.
Une heure ou deux après être entré dans la vallée, on voi t épars sur le s o l ,
des si lex, la plupart d'un tissu assez grossier, et la quantité s'en accroî t à mesure
qu'on s'avance. On trouve également quelques fragmens de bois agatiscs, c omme
M. Girard en a déjà fait l'observation ; l'abondance de ces cailloux augmente surtout
vers les embouchures de quelques vallées transversales qui aboutissent à cel le
que l'on suit.
s. II.
Collines de Poudingue.
VERS le mi l ieu de la val lée, de longues collines à couches horizontales, élevées
de 2,0 à 30 mèt res, sont ent ièrement formées d'un poudingue siliceux à pâte
quartzeuse, grise ou jaunâtre, enveloppant une immense quantité de silex de la
grosseur et à peu près de la forme d'un oeu f On n'aperçoit jamais, ni dans les
couches de ce poudingue, ni dans les amas de cai l loux, ni épars sur le sol , aucun
fragment de roches j^rimitives ou de transition. Le quartz en fragmens de toutes
grosseurs forme la partie la plus considérable du poudingue ; cependant les gi-os
cailloux de cette nature sont bien moins abondans que les silex, et leur f o rme ,
au lieu d'être o v o ïde , c omme la leur, est i>lus communément sphérique. Quel -
quefois, dans des espaces assez étendus, on n'aperçoit pas un si lex; d'autres fois
ils forment eux seuls plus des trois quarts de la masse, et la pâte quartzeuse suffît
à peine pour les lier.
Les silex les plus communs sont d'un gris bleuâtre ou d'un gris de f umé e ,
demi-transparens, ayant un peu d'éclat, une cassure légèrement ccailleuse ou conchoïde,
ou même un peu vi treuse, scion qu'ils se rapprochent plus ou moins du
quartz. Ils ont la dureté du silex pyromaque , sans en avoir l'aspect ni le tissu.
Leur croûte noire ou <run gris foncé n'est jamais ni altérée ni farineuse, c omme
celle des nodules siliceux qu'on trouve dans les craies. Je fais particulièrement
'lîl