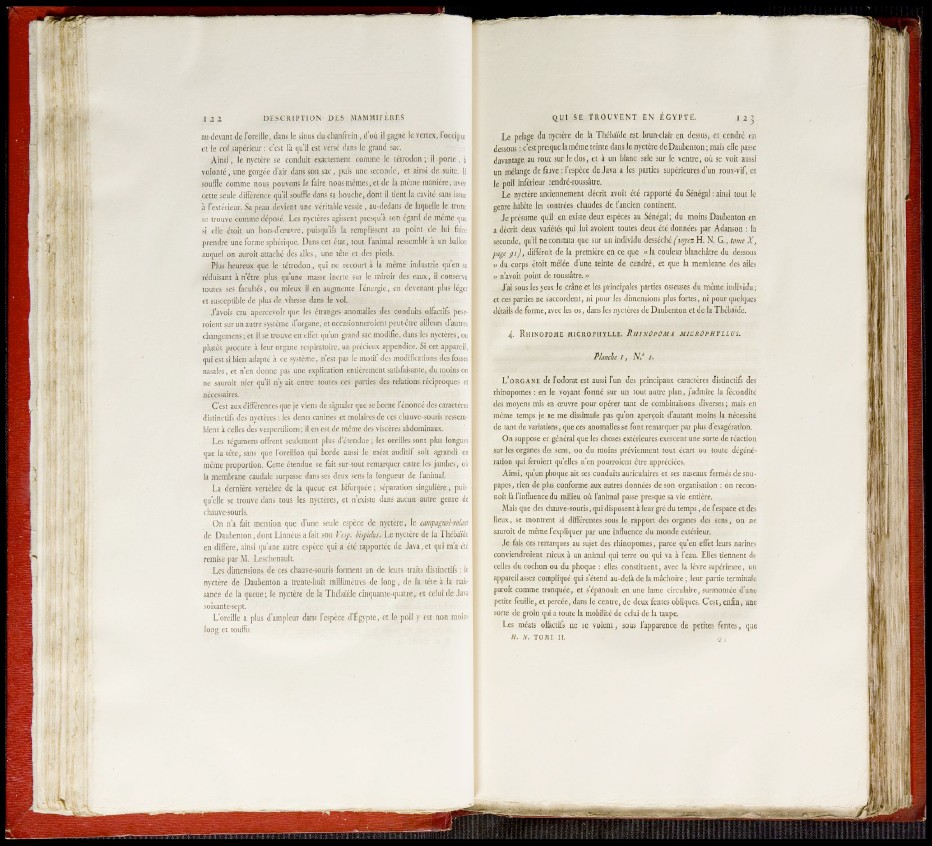
NI'
1 2 2 D E S C R I P T I O N D E S MAMMI F E R E S
au-devant J e l 'oreilie, dans le sinus du cl ianf icin , d'où il g a gne le ver tex, l'occiput
et le col supé r i eur ; c'est là qu'il est verse dans ie gr and sac.
A i n s i , le nyctere se c ondui t exa c t ement c omme le t c t rodon ; il p o r t e , à
v o l o n t é , une g o r g é e d'air dans son s a c , pui s une s e c o n d e , et ainsi de suite. Il
souf l îe c omme nous p o u v o n s le faire nous -même s , et de la même ma n i è r e , avec
cet te seule di f f e renc e qu'ii souille dans sa b o u c h e , dont il tient la cavi té sans issue
à l'extérieur. S a peau devi ent une véritable v e s s i e , au-dedans de laquelle le tronc
se t rouve c omme dépos é . L e s nyctères agissent prcs<[u'à son égard d e même que
si elle étoi t un hor s -d'oeuvr e , puisqu'ils la rempl i s s ent au po int d e lui faire
pr endr e u n e f o rme spliérique. Da n s cet é t a t , tout l'animal res semble à un ballon
auquel on auroi t at t aché des a i l e s , une tête et des pieds .
Plus heureux que le t é t r o d o n , qui ne re cour t à la même indus t r ie qu'en se
rédui sant à n'êt re plus qu'une ma s s e inerte sur le mi roi r des e aux , il conserve
toutes ses f a cul t é s , ou mi eux il en augment e l ' éne rgi e , en devenant plus léger
et suscept ible d e plus d e vitesse dans le vol .
J ' avoi s cru ape r c evoi r que les ét ranges anoma l i e s des condui t s olfactifs pescroient
sur un aut re sys tème d'org ane , et o c c a s i onne ro i eni peut-être ailleurs d'autres
chang emens ; et il se t rouve en eflét qu'un gr and s ac mo di f i e , dans les nyctères , ou
plutôt p r o c u r e à leur or g ane res j ) i ratoi re, un précieux appendi c e . Si cet appareil,
qui est si bien adapt é à c e s y s t ème , n'est pas le mo t i f des modi f i c a t ions des fosses ;
na s a l e s , et n'en d o n n e pa s une expl icat ion ent ièrement satisfaisante, du mo ins on
ne sauroi t nier qu'il n'y ait ent re toutes ces part ies des relat ions r é c iproque s ci
néces sai res.
C' e s t aux di f férences que je viens de signaler que se bo rne l ' énonc é des cai-actère<
di s t inct i f s de s nyctères : les dent s canines et mol a i re s de ces chauve- sour i s ressemblent
à celles des vesper t i l ions ; il en est de même des vi scères abdominaux.
L e s t é gumens of f rent seulement plus d' é t endue ; les oreilles sont plus longues
que la t ê t e , sans que l'oreillon qui b o r de aussi le mé a t audi t i f soi t agrandi en
même propo r t i on. Ce t t e é t endue se fait sur-tout r ema rque r ent re les j ambe s , où
la memb r a n e c auda le surpas se dans ses deux sens la longueur de l'animal.
L a de rni è re ver tèbre de la queue est bi furquée ; séparat ion s ingul i è r e , puisqu'elle
se t rouv e dans tous les nyctères , et n'existe dans aucun autre g enr e de
chauve-souris.
O n n'a fait ment i on que d'une seule e spè c e d e ny c t e r e , le campagnol-voUni
d e Da u b e n t o n , d o n t Linnéu s a fait son Vesp. hispidus. L e nyctère de la ThébaïcK
en di f f è r e , ainsi qu'une aut re e spè c e qui a été r appor t é e de J a v a , et qui m' a cti
r emi s e pa r M. Le s chenaul t .
L e s dimens i ons de ces chauve- souri s f o rment un de leurs traits di s t inct i f s : le
nyctère d e Da u b e n t o n a trente-huit mi l l imèt res d e long , de la tête à la naiss
anc e de la q u e u e ; le nyctère de la Th é b a ï d e cinquante-cjuai re, et celui de Java
soixante-sept.
L'orei l le a plus d' ampl eur dans l 'espèce d'Ég \ 'pt e , et le poi l y est non moir.-
l ong et touffu.
Q U I S E T R O U V E N T E N É G Y P T E . 1 2 3
L e pelage du nyctère d e la Th é b a ï d e est brun-clair en des sus , et c endr é en
dessous : c'est pre sque la même teinte dans le nyctère de Da u b e n t o n ; mai s elle pas se
davantage, au roux sur le d o s , et à un blanc sale sur le v ent r e , où se voi t aussi
un mélange de f auve : l 'espèce de J a v a a les part ies supér ieures d'un roux-vi f , et
le poil inférieur cendré-roussâtre.
L e nyctère anc i ennement décr i t avoi t ét é r appor t é du Sénégal : ainsi tout k
genre habite les cont rées chaudes de l'ancien cont inent .
J e pr é sume qu'il en existe deux espèces au S éné g a l ; du mo ins Da u b ent on en
a décrit deux variétés qui lui avoient toutes deux été donné e s pa r Ad a n s o n : la
s e conde , qu'il ne constata que sur un individu des séché fvoyez H. N. G. , tome X ,
page ^ J ) , di f fcroi t d e la pr emi è r e en c e que « la couleur blanchât re d u des sous
» du corps étoi t mê l é e d'une teinte de c e n d r é , et que la memb r ane des ailes
» n'avoit point de roussâtre. »
J'ai sous les yeux le crâne et les pr incipales part ies os seuses du même indi v idu;
et ces parties ne s ' a c cordent , ni pour les dimens ions plus f o r t e s , ni p ou r quelques
détails de f o rme , ave c les o s , dans les nyctères d e Da u b e n t o n et d e la Thé ba ï de ,
4 . R H I N O P O M E M I C R O P H Y L L E . RHINOPÛMA MICROPHYLLUS.
Planche / ^ N,'
L ' o r g a n e de I 'odorat es t aussi l'un des pr incipaux caractères distinctifs des
rhinopome s : en le voyant f o rmé sur un tout autre p l an, j ' admi re la f é c ondi t é
des moyens mi s en oeu v r e p our opé r e r tant d e combina i sons diverses ; mai s en
même t emps je ne me di s s imule pa s qu'on ape r çoi t d'autant mo ins la néces s i té
de tant de var iat ions , que ces anoma l ies se f ont r ema rque r par plus d'exagérat ion.
O n suppo s e en général que les choses extérieures exercent une sor te de réact ion
sur les organes des sens , ou du mo ins pr évi ennent tout écart ou tout e dégéné -
ration qui feroient qu'elles n'en pour roi ent être appréc iées .
Ai n s i , qu'un pho q u e ait ses condui t s auriculaires et ses naseaux f e rmé s de s oup
a p e s , rien d e plus c onf o rme aux autres donné e s de son organi sat ion : on r e connoît
là l'influence du mi l ieu où l'animal pas se pre sque sa vie entière.
Ma i s que des chauve - sour i s , qui di spos ent à leur gré du t emp s , d e l 'espace et des
l i eux , se mont r ent si di f férentes sous le r a ppo r t des organes des S ens , o n ne
sauroit de même l'expliquer par une inf luence d u mo n d e extérieur.
J e fais ces r ema rque s au sujet des r h i n o p ome s , pa r c e qu'en ef fet leurs nai ines
convi endroi ent mieux à un animal qui terre ou qui va à l'eau. El les t iennent de
celles du c o chon ou du pho q u e : elles c ons t i tuent , ave c la lèvre supé r i eur e , un
appareil assez c ompl iqué qui s 'étend au-del à de la mâ cho i r e ; leur par t ie terminale
paroît c omme t r onqué e , et s 'épanoui t en une l ame ci rculai re, surmont é e d'une
petite feui l le, et p e r c é e , dans le c ent re , d e deux fentes obliques. C' e s t , enf in, u n e
sorte de groin qui a toute la mobi l i té de celui de la taupe.
L e s méa t s olfactifs ne se v o i e n t , sous l ' appa rence de petites f e n t e s , que
H. N. TOMT. II. , , .