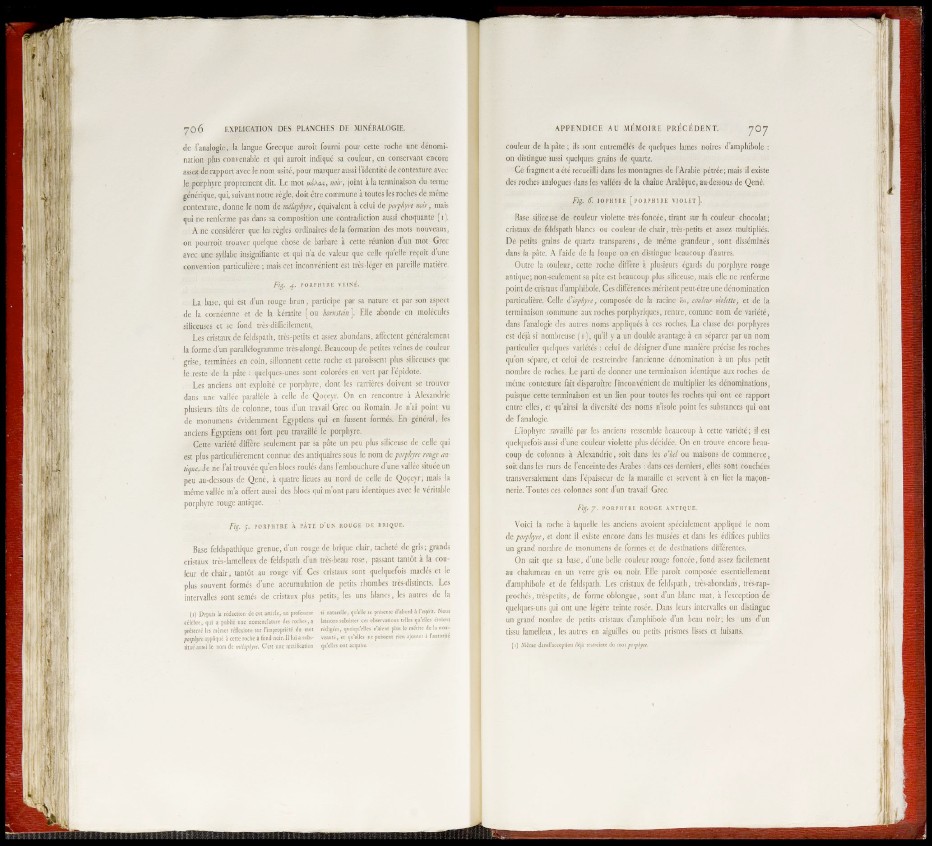
f . :
il W ï '
7 0 6 EXPLICATION DES PLANCHES DE MINÉRALOGIE.
de l'analogie, Ja langue Grecque auvoit fourni pour cette roche une denomi -
nation pJus convenable et »[ui auroit indique sa couleur , en conservant encor e
assez de rappor t avec le nom usité, pour marquer aussi l'identité de contexture avec
le porphyre proprement dit. L e mo t ^¿AO-Î, noir, joint à la terminaison du terme
générique, qui, suivant not re règle, doit êt re commune à toutes les roches de même
cont extur e , donne le n om de mébphyre, équivalent à celui de porphyre twir, mais
qui ne renferme pas dans sa compos i t ion une cont radict ion aussi choquante ( i ).
A ne considérer que les règles ordinaires de la format ion des mots nouveaux,
on pourroit t rouver quelque chose de barbare à cet te réunion d'un mot Gr e c
avec une syllabe insignifiante et qui n'a de valeur que celle qu'elle reçoi t d u n e
convent ion particulière ; mais cet inconvénient est très-léger en pareille matière.
Fig. J f . P O R P H Y U E V E I N É .
L a base, qui est d'un rouge b r un , participe par sa nature et par son aspect
de la corne enne et de la kératite [ o u /m-iish-in]. El le abonde en molécules
siliceuses et se fond très-dlificiiement.
Les cristaux de feldspath, très-petits et assez abondans, affectent généralement
la forme d'un parallélogramme très-alongé. Be aucoup de petites veines de couleur
grise, terminées en coin, sillonnent cet te roche et paroissent plus siliceuses que
le reste de la pâte : quelques-unes sont colorées en vert j)ar l'épidote.
Le s anciens ont exploité ce porphyre, dont les carrières doivent se trouver
dans une vallée parallèle à celle de Qo ç e ) r . On en rencont re à Alexandrie
plusieurs lùts de c o l onne , tous d'un travail Gr e c ou Romain. J e n'ai point vu
de monumens évidemment Egyptiens qui en fussent formés. En général , les
anciens Égyptiens ont for t peu travaillé le porphyre.
Ce t t e variété diffère seulement par sa pâte un peu plus siliceuse de celle qui
est plus par t iculièrement connue des antiquaires sous le n om de porphyre rouge ,m
tique. J e ne lai t rouvée qu'en blocs roulés dans l 'embouchure d'une vallée située un
peu au-dessous de Qe n é , à quatre lieues au nord de cel le de Qo ç e y r ; mais la
même vallée m'a offert aussi des blocs qui m'ont paru identiques avec le véritable
porphyre rouge antique.
Fig. ) . P O R P H Y R E À P A T E D ' U N R O U G E D E R R I Q U E .
Base feldspathique gi-enue, d'un rouge de brique clair, tacheté de gris ; grands
cristaux très-lamelleux de feldspath d'un très-beau ros e , passant tantôt à la couleur
de cha i r , tantôt au rouge vi f Ces cristaux sont quelquefois maclés et le
plus souvent formés d'une accumulat ion de ])etits rhombes très-distincts. Le s
intervalles sont semés de cristaux plus petits, les uns blanc s , les autres de la
A P P E N D I C E AU MÉMO I R E P R É C É D E N T . 7 0 7
(i) Depuis la rédaction de cet article, un professeur
céiebre, qui a publié une nomenclature des roche!, a
présenté les mêmes réflexions sur l'impropriété du mot
porphyre appliqué à cette roche à fond noir. H lui a substitué
aussi le nom du mélaphyre. C'est une reciificaiion
si naturelle, qu'elle se présente d'abord à i'espHt. Nous
laissons subsister ces observations tfllcs qu'elles cioicin
rédigées, quoiqu'elles n'aient plus le mérite de la nouveauté,
et qu'elles ne puissent rien ajouter à l'autorité
qu'elles ont acquise.
couleur de la pâte ; ils sont ent remêlés de quelques lames noires d'amphibole ;
on distingue aussi quelques grains de quartz,
Ce fragment a été recueilli dans les montagnes de l'Arabie pét rée; mais il existe
des roches analogues dans les vallées de la chaîne Arabique, au-dessous de Qené .
Fig. S. L O P H V R E [ P O R P H Y R E V I O L E T ] .
Base siliceuse de couleur violette t rès - foncée, tirant sur la couleur chocolat ;
cristaux de feldspath blancs ou couleur de chai r , très-petits et assez multipliés.
D e petits grains de quartz t ransparens , de même grandeur , sont disséminés
dans la pâte. A l'aide de la loupe on en distingue beaucoup d'autres.
Out r e la couleur , cette roche difìcre à plusieurs égards du porphyre rouge
anti([ue; non- seulement sa pâte est beaucoup plus siliceuse, mais elle ne renferme
point de cristaux d'amphibole. Ce s différences mér i tent peut-ctre une dénominat ion
particulière. Cel le iXiophyrc, composée de la racine ióv, couleur violette, et de la
terminaison c ommun e aux roches porpliyriques, r ent r e, c omme n om de var iété,
dans l'analogie des autres noms appliqués à ces roches. L a classe des porphyres
est déjà si nombreuse ( i ) , qui ! y a un double avantage à en séparer par un n om
particulier quelques variétés : celui de désigner d'une manière précise les roches
qu'on sé])are, et celui de restreindre l'ancienne dénominat ion à un plus petit
nombr e de roches. L e parti de donne r une terminaison identique aux roches de
même contexture fait clisparoître l ' inconvénient de multiplier les dénominat ions ,
puisque cet te terminaison est un lien pour toutes les roches qui ont ce rappor t
entre elles, et qu'ainsi la diversité des noms n'isole point les substances qui ont
de l'analogie.
L' iophyre travaillé par les anciens ressemble beaucoup à cet te variété ; il est
quelquefois aussi d'une couleur violette plus décidée. On en trouve encor e beaucoup
de colonnes à Al exandr i e , soit dans les o'kel ou maisons de c omme r c e ,
soit dans les murs de l 'enceinte des Arabes : dans ces derniers, elles sont couchées
transversalement dans l'épaisseur de la muraille et servent à en lier la ma ç onnerie.
Tout e s ces colonnes sont d'un travail Gr ec .
Fig. y . P O R P H Y R E R O U G E A N T T Q U E .
Voi c i la roche à laquelle les anciens a \ oienf spécialement appliqué le n om
de poiphyre, et dont il existe encor e dans les musées et dans les édifices publics
un grand nombre de monumens de formes et de destinations différentes.
On sait que sa base, d'une belle couleur rouge f o n c é e , fond assez faci lement
au chalumeau en un verre gris ou noir. El le paroit compos é e essentiellement
d'amj)hibole et de feldspath. Les cristaux de feldspath, très-abondans, très-rapj
i roché s , très-petits, de forme oblongue , sont d'un blanc mat , à l'exception de
([uclqucs-uns qui ont une légère teinte rosée. Dans leurs intervalles on distingue
un grand nombre de petits cristaux d'amphibole d'un beau noi r ; les uns d'un
tissu lamel leux, les autres en aiguilles ou petits prismes lisses et luisans.
(1) Même dans l'acception déjà restreinte du mot porphyre.
: sT
i t