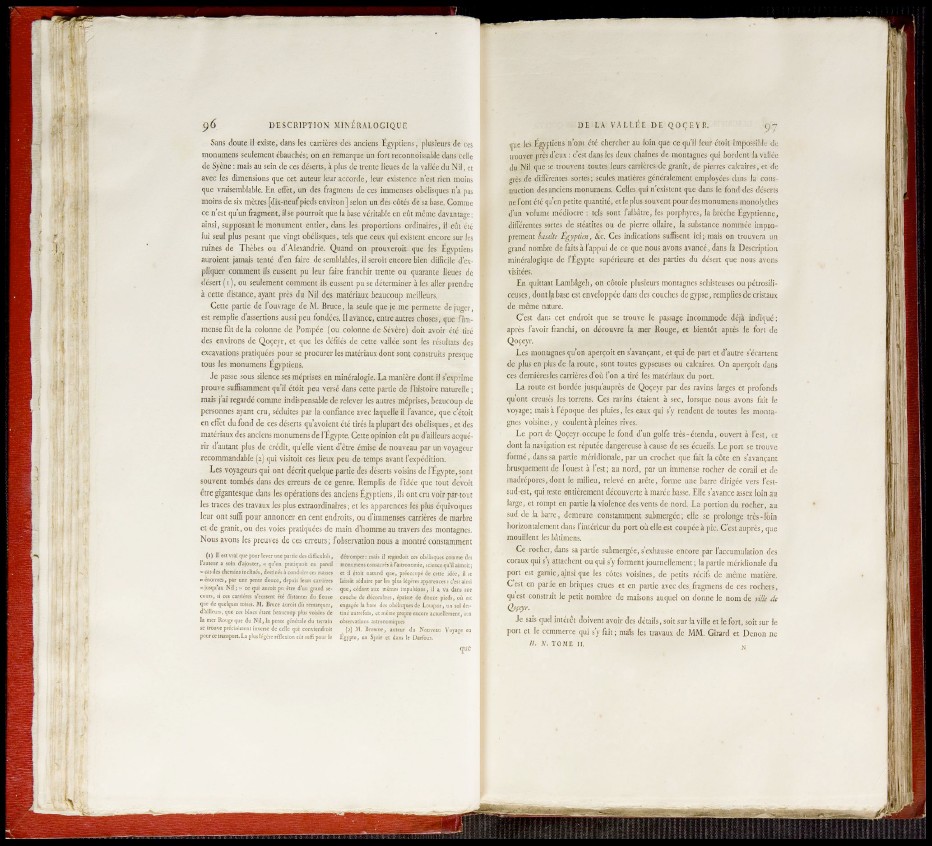
9 6 D E S C R I P T I O N MI N É R A L O C I Q U E D E LA V A L L E E DE Q O Ç E Y R .
9 7
t i
Sans doute ii existe, dans les camères des anciens Égyptiens, piusieurs de ces
monumens seulement ébauchés; on en remarque un fort reconnoissable dans celle
de Syène : mais au sein de ces déserts, à plus de trente lieues de la vallée du Ni l , et
avec les dimensions que cet auteur leur accorde, leur existence n'est rien moins
que vraisemblable. En effet, im des fragmens de ces immenses obélisques n'a pas
moins de six mètres [dix-neuf pieds environ ] selon un des côtés de sa base. Comme
ce n'est qu im fragment, ii se pourroit que la base véritable en eiit même davantage :
ainsi, supposant le monument entier, dans les proportions ordinaires, il eût été
lui seul plus pesant que vingt obélisques, tels que ceux qui existent encore sur les
ruines de Thèbes ou d'Alexandrie. Quand on prouveroit que les Égyptiens
auroient jamais tenté d'en faire de semblables, il seroit encore bien difficile d'expliquer
comment ils eussent pu leur faire franchir trente ou quarante lieues de
<Iésert ( I ), ou seulement comment ils eussent pu se déterminer à les aller prendre
à cette distance, ayant près du Nil des matériaux beaucoup meilleurs.
Cette partie de l'ouvrage de M Bruce, la seule que je me permette de juger,
est remplie d'assertions aussi peu fondées. Il avance, entre autres choses, que l'immense
fût de la colonne de Pompée {ou colonne de Sévère) doit avoir été tiré
des environs de Qoçeyr , et que les défdés de cette vallée sont les résultats des
excavations pratiquées pour se prociu-er les matériaux dont sont construits presque
tous les monumens Égy ptiens.
Je passe sous silence ses méprises en minéralogie. La manière dont il s'exprime
prouve suffisamment qu'il étôit peu versé dans cette partie de l'histoire naturelle ;
mais j'ai regardé comme indispensable de relever les autres méprises, beaucoup de
personnes ayant cru, séduites par la confiance avec laquelle il l'avance, que c'étoit
en effet du fond de ces déserts qu'avoient été tirés la plupart des obélisques, et des
matériaux des anciens monumens de l'Égypte. Cette opinion eût pu d'ailleurs acquérir
d'autant plus de crédit, qu'elle vient d'être émise de nouveau par un voyageur
recommandable (2) qui visitoit ces lieux peu de temps avant l'expédition.
Les voyageurs qui ont décrit quelque partie des déserts voisins de l'Égypte, sont
souvent tombés dans des erreurs de ce genre. Remplis de l'idée que tout devoit
être gigantesque dans les opérations des anciens Ég)'ptiens, ils ont cru voir par-tout
les traces des travaux les plus extraordinaires; et les apparences les plus équivoques
leur ont suffi pour annoncer en cent endroits, ou d'immenses carrières de marbre
et de granit, ou des voies pratiquées de main d'homme au travers des montagnes.
Nous avons les preuves de ces erreurs; l'observation nous a montré constamment
(1) II est vrai que pour lever une partie des difficultés,
l'auteur a soin d'ajouter, « qu'on pratiquoit en pareil
«cas des chemins inclinés, destinés à conduire ces masses
».énormes, par une pente douce, depuis leurs carrières
«jusqu'au Ni l ; » ce qui auroit pu être d'un grand secours,
si ces carrières n'eussent été distantes du fleuve
que de quelques toises. M. Bruce auroit dû remarquer,
d'ailleurs, que ces blocs étant beaucoup plus voisins de
la mer Rouge que du Ni l , la pente générale du terrain
se trouve précisément inverse de celle qui conviendroit
pour ce transport. La plus légère réflexion eiii suffi pour le
détromper: mais il regardoit ces obélisques comme des
monumens consacrés à l'astronomie, science qu'il aimolt;
et il étoit naturel que, préoccupé de cette idée, il se
laissât séduire par les plus légères apparences : c'est ainsi
que, cédant aux mêmes impulsions, il a vu dans une
couche de décombres, épaisse de douze pieds, où est
engagée la base des obélisques de Louqsor, un sol destiné
autrefois, et même propre encore actuellement, aui
observations astronomiques
(a) M, Browne, auteur du Nouveau Voyage en
Egypte, en Syrie et d.-ins le Uarfour.
que
que les Égyptiens n'ont été chercher au loin que ce qu'il leur étoit impossible de
trouver prcs d'eux : c'est dans les deux chaînes de montagnes qui bordent la vallée
du Nil que se trouvent toutes leurs carrières de granit, de pierres calcaires, et de
grès de différentes sortes; seules matières généralement employées dans la consn'uction
des anciens monumens. Celles qui n'existent que dans le fond des déserts
ne l'ont été qu'en petite quantité, et le plus souvent pour des monumens monolythes
d'un volume médiocre : tels sont l'albâtre, les porphyres, la brèche Égyptienne,
différentes sortes de steatites ou de pierre ollaire, la substance nommée improprement
¿asa/te Égyptien, &c. Ces indications suffisent ici; mais on trouvera un
grand nombre de faits à l'appui de ce que nous avons avancé, dans la Description
minéralogique de l'Égypte supérieure et des parties du désert que nous avons
visitées.
En quittant Lambâgeh, on côtoie plusieurs montagnes schisteuses ou pétrosiliceuses,
dont k base est enveloppée dans des couches de gypse, remplies de cristaux
de même nature.
C'est dans cet endroit que se trouve le passage incommode déjà indiqué :
après l'avoir franchi, on découvre la mer Rouge, et bientôt après le fort de
Qoçeyr.
Les montagnes qu'on aperçoit en s'avançant, et qui de part et d'autre s'écartent
de plus en plus de la route, sont toutes gypseuses ou calcaires. On aperçoit dans
ces dernières les carrières d'où l'on a tiré les matériaux du port.
La route est bordée jusqu'auprès de Qoçeyr par des ravins larges et profonds
qu'ont creusés les torrens. Ces ravins étaient à sec, lorsque nous avons fait le
voyage; mais à l'époque des pluies, les eaux qui s'y rendent de toutes les montagnes
voisines, y coulent à pleines rives.
Le port de Qoçeyr occupe le fond d'un golfe t rès-étendu, ouvert à l'est, et
dont la navigation est réputée dangereuse à cause de ses écueils. Le port se trouve
formé, dans sa partie méridionale, par un crochet que fait la côte en s'avançant
brusquement de l'ouest à l'est; au nord, par un immense rocher de corail et de
madrépores, dont le milieu, relevé en arête, forme une barre dirigée vers l'estsud
est, qui reste entièrement découverte à marée basse. Elle s'avance assez loin au
large, et rompt en partie la violence des vents de nord. La portion du rocher, au
sud de la barre, demeure constamment submergée; elle se prolonge très-loin
horizontalement dans l'intérieur du port où elle est coupée à pic. C'est auprès, que
mouillent les bàtimens.
Ce rocher, dans sa partie submergée, s'exhausse encore par l'accumulation des
coraux qui s'y attachent ou qui s'y forment journellement ; la partie méridionale du
port est garnie, ainsi que les côtes voisines, de petits récifs de même matière.
C'est en partie en briques crues et en partie avec des fragmens de ces rochers,
qu'est construit le petit nombre de maisons auquel on donne le nom de ville de
Qpç^r.
Je sais quel intérêt doivent avoir des détails, soit sur la ville et le fort, soit sur le
port et le commerce qui s'y fait ; mais les travaux de MM. Girard et Denon ne
H. N. T O M E II.
S