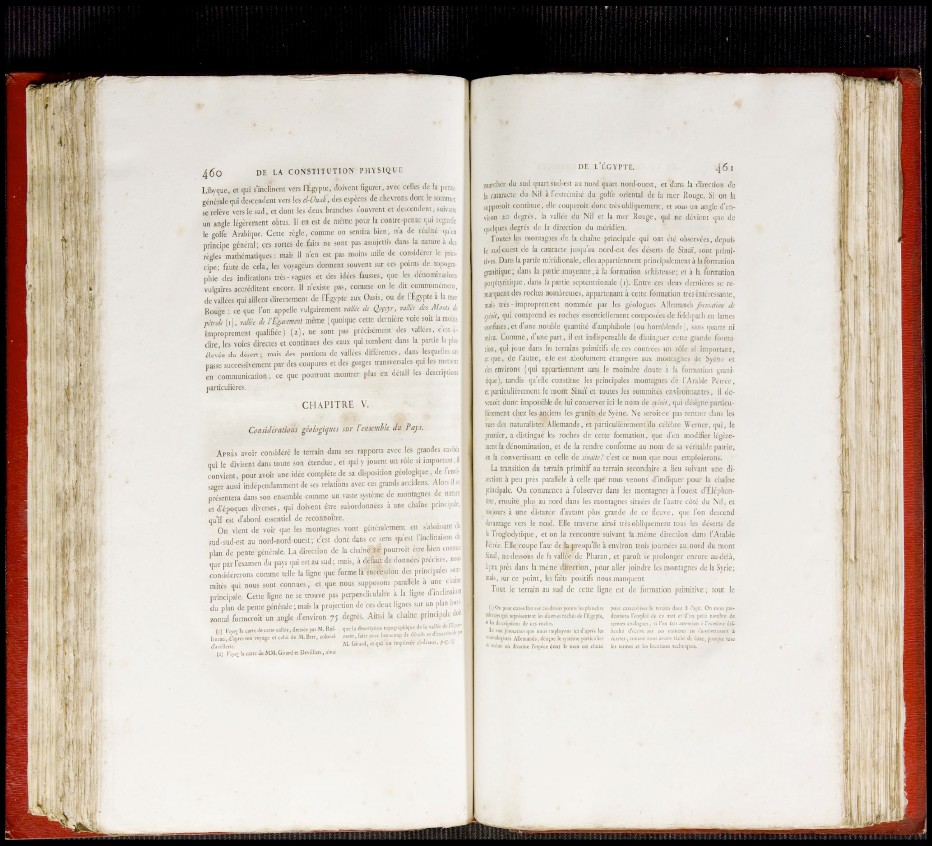
it
i t / : - ' i l '
Km
4 6 0 D E LA C O N S T I T U T I O N P H Y S I Q U E
Libyquc, et qui s ' rncl incnt vers l 'Ég y p i c , d o i v e n t l igur e r , a v e c cel les Je la penic
générale qui de s c endent ver s les eWi w / i . des e spè c e s de che v r ons d ont le s omma
se r e l è v e ver s le s u d , et d o n t les deux branches s 'ouv r ent et d e s c e n d e n t , suivant
un angle l é g è r ement obtus. Il en est de même p o u r la c o i i t r e -pcnt e qui regarde
le g o l f e Ar a b i q u e . C e t t e r è g l e , c omme on sent ira b i e n , n'a de réalité ([lûu
principe g é n é r a l ; ces sor tes de faits ne sont pas assujettis dans la nature à des
règles ma théma t ique s : mai s il n' en est pas mo i n s utile de cons idé r e r le princ
i p e ; faute de c e l a , les voyageur s d o n n e n t s o u v ent sur ces point s de topographie
des indi ca t ions t r è s - v a g u e s et des idées faus ses , que les dénominat ions
vulgaires a c c r édi t ent enc o r e . Il n'existe pa s , c omme on le di t communément ,
d e val lées qui ai l lent d i r e c t ement de l 'Egypt e aux Oa s i s , ou de l 'Egypt e à la mer
Rouge : ce que l 'on appe l l e vul g a i r ement vû/iée de Qpçeyr, vallée des Monts à
pétrole ( i ) , vallée de l'Eganment même ( quo i qu e c e t t e de rni è r e v o i e soi t la moins
improprement qua l i f i é e ) ( 2 ) . ne sont pas pr é c i s ément des val l é e s , c'cst-hdire,
les v o i e s di rec tes et cont inue s des eaux qui t omb ent dans la part ie la plus
élevée du déser t ; mai s des por t ions de val lées d i f f é r ent e s , dans lesquelles on
passe suc c e s s i v ement par des c oupur e s et des gor g e s transversales qui les mctiem
en c ommu n i c a t i o n ; ce que p o u r r o n t mo n t r e r plus en détai l les descriptions
particulières.
C H A P I T R E V.
Considérations géologiques sur l'ensemble du Pays.
APRÈS a voi r cons idé r é le ter rain dans ses rappor t s a v e c les grandes cavitcs
qui le divi s ent dans tout e s on é t e n d u e , et qui y j ouent un rôle si impor tant , il
c o n v i e n t , p o u r a voi r une idé e c omp l è t e de sa di spos i t ion g é o l o g i q u e , de l'envisager
aussi i n d é p e n d amme n t de ses relat ions a v e c ces grands ac c idens . Al o r s il se
présentera dans s on ens embl e c omme un vaste sys tème de mont a gne s de nature
et d' époque s d i v e r s e s , qui d o i v e n t êt re subo rdonné e s a u n e chaîne principale,
qu'il est d'abord essent iel de r e c onno i t r e .
O n v i ent de v o i r que les mo n t a g n e s v o n t g éné r a l ement en s'abaissant du
sud-sud-est au n o r d - n o r d - o u e s t ; c'est d o n c dans ce sens qu'est rinclinaisoi i du
plan de pent e générale. La di r e c t ion de la cha îne ne pour roi t êt re bien connue
que par l ' examen du pays qui est au sud ; mai s , à dé f aut de donné e s préci ses, nous
considérerons c omme tel le la l igne que f o rme la suc ces s ion des prmc ipales sommités
qui nous sont c o n n u e s , et que nous suppo s ons parallèle à une chainc
principale. Ce t t e l igne ne se t r ouv e pas pe rpendi cul a i r e à la l igne d'inclinaisoa
d u plan de pent e générale ; mai s la pr o j e c t i on de ces deux l ignes sur un plan horizontal
f o rme r o i t un angl e d' env i ron 75 degrés . Ai n s i la chaîne princij)ale doit
(,) Voy^ b cane de cc.e vall«, dre»ée par M. Rof- qo. la descrrp.ian ..pographique de U vaille de
( I L d-lé^ so. voyage « «lui de M. Bcr., colonel ment, fake avec beaucoup de d.-a.l. et d «ac.ud.p«
P - M. Girard, e. qui en imprime«
(2} Ki/it la carte de MM. Girard ei Devilliers, ainsi
D E L ' É G Y P T E . 46 I
marcher du sud quart sud-est au no r d quar t nord-oue s t , et dans la di r e c t ion de
ja cataracte du Ni l à l 'ext rémi té du gol f e oriental de la me r Roug e . Si on ia
supposoic c o n t i n u e , elle cou[ )eroi t d o n c t r è s -obl iquement , et sous un angle d'environ
20 d e g r é s , la val lée du Ni l et la me r R o u g e , qui ne dé v i ent que de
quelques degrés de la di r e c t i on du mé r idi en.
Toutes les mont a gne s de la c h ame pr inc ipal e qui ont été obs e r v é e s , depui s
le sud-ouest de la cataracte jusqu'au nord-es t des déserts de SinaY, sont pr imi -
tives. Dans la par t ie mé r idi ona l e , elles appa r t i ennent pr inc ipa l ement à la f o rma t i o n
granitique; dans la part ie mo y e n n e , à la f o rma t i on s chi s teuse; et à la f o rma t i o n
porpliyritique, dans la part ie s ept ent r ionale (1). Ent r e ces deux dernières se reîiiarquent
des roche s nombr eus e s , appar t enant à cet te f o rma t i on très- intéressante,
mais très - imp r o p r eme n t n ommé e j>ar les g é o l o gue s Al l ema n d s formation de
^•¿iiit, qui c omp r e n d les roche s es sent iel lement c omp o s é e s de feldspath en lames
confuses, et d'une notable quant i té d' amphibol e ( o u h o r n b l e n d e ) , sans quartz ni
mica. C o m m e , d'une pa r t , il est indispensable de di s t inguer cet te g r ande formation,
qui joue dans les terrains pr imi t i f s de . c e s cont r é e s un rôle si imp o r t a n t ,
et que, de l 'aut re, elle est abs o lument ét rangère aux mont a gne s de S y è n c et
des envi rons {qui appa r t i ennent sans le mo i n d r e d o u t e à la f o rma t i on grani -
tique), tandis qu'el le cons t i tue les pr incipales mont a gne s de l 'Ar a b i e P é t r c e ,
et par t icul ièrement le mo n t Sinai et tout es les sommi t é s env i r onnant e s , il devenoit
d o n c impos s ible de lui c ons e r v e r ici le n om de syénit, qui dés igne par t i culièrement
che z les anc iens les grani ts de Sy ène . Ne seroi t -ce pas r ent r e r dans les
vues des naturalistes A l l ema n d s , et par t i cul i è r ement du célèbre We r n e r , q u i , le
premier, a di s t ingué les r o che s de cet te f o rma t i o n , que d'en mo d i f i e r l égè r e -
ment la d é n omi n a t i o n , et de la r endr e c o n f o rme au n om de sa vér i table pa t r i e ,
en la conver t i s sant en cel le de sinditc! c'est ce n om que nous emp l o i e r ons .
. La transition .du terrain pr imi t i f au terrain s e conda i r e a l ieu suivant une direction
à peu près paral lèle à cel le que nous venons" d' indiquer p o u r la cha îne
principale. On c omme n c e à l 'observer dans les mont a gne s à l 'ouest d'Él éphanliiie,
ensuite plus au no r d dans les mont a gne s situées de l'autre c ô t é du Ni l , et
toujours à une distance d'autant plus grande de ce fleuve, que l 'on d e s c e n d
davantage ver s le nord. El l e traverse ainsi t rès -obl iquement tous les déserts de
la Tr o g l ody t ique , et on la r enc ont r e suivant la même di r e c t ion dans l 'Ar a b i e
Pctréc. El l e c o u p e l'axe de la presqu' î le à env i r on trois journé e s au no r d du mo n t
Sinai, au-dessous de la val lée de Ph a r a n , et paroî t se pr o l ong e r enc o r e au-delà,
apeu près dans la même d i r e c t i o n , p o u r aller joindr e les mont a gne s de la S ) r i e ;
mais, sur ce j )oint , les faits posi t i fs nous manquent .
Tout le terrain au sud de cet te l igne est de f o rma t i on pr imi t i v e ; tout le
1) On pent consulter sur ces divers points ies planches
wloriéts qui représentent les diverses roches de l'Kgypte,
" 1« descriptions de ces roches.
Le mot yùnnafip/i que nous employons ici d'après les
"iiniTalogisies Allemands, désigne le système particulier
de roches ou domine l'espèce dont le nom est choisi
pour c:
donnera l'emploi de C
-'agit. On n
it et d'un petit r
s tâché de faire, piesque ti
s tCLhniqiies.
• i