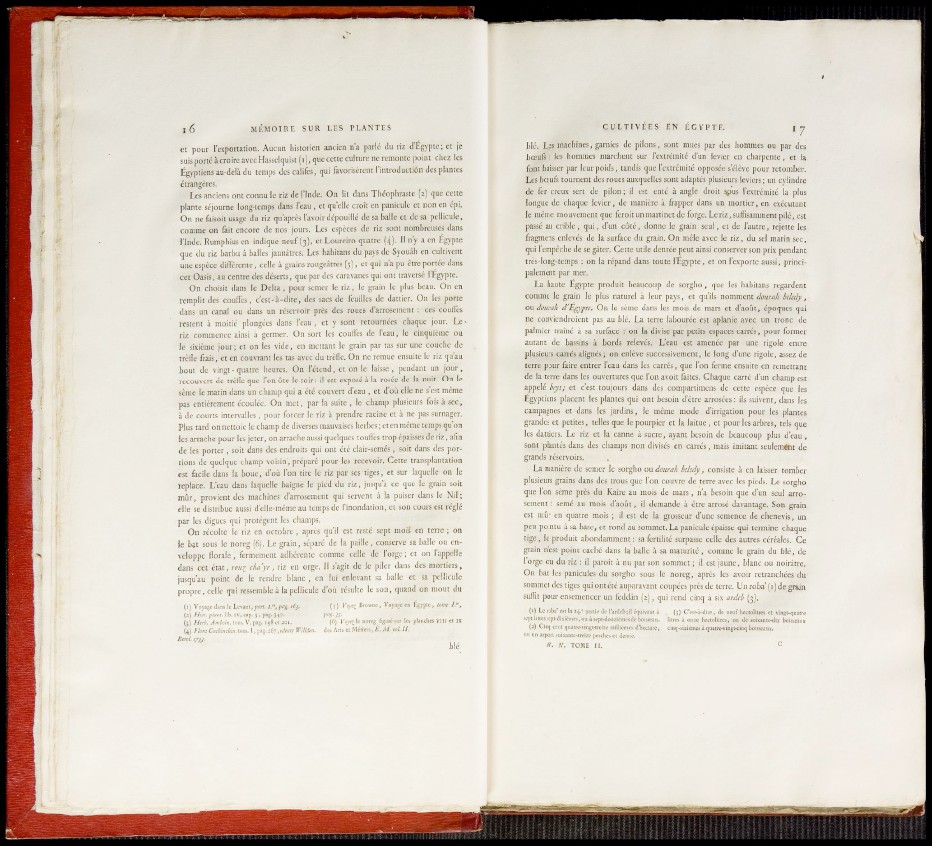
î 6 M É M O I R E S U R L E S P L A N T E S
e t p our l ' e xporut ion. Au c u n liistorieii ancien n'a parle tlu riz d ' É g y p « ; et je
suis por té à croire ave cHa s s c lqui s t ( i ), que cet te culture ne r emont e point che z les
Égypt iens au-delà du t emps des cal i fes , qui favorisèrent l ' int roduct ion des plantes
étrangères.
L e s anciens ont connu le riz de l'Inde. On lit dans Thé o phr a s t c (2) que cet te
pl ant e s é journe long-temps dans l ' e au, et qu'elle croî t en panicule et non en épi.
O n ne faisoit usage du riz qu'après l'avoir dépoui l lé île sa Iialle et de sa pe l l i cul e ,
c omme on fait encor e de no s jour s . L e s espèces de riz sont nombreuses dans
l'Inde. Rumphius en indique neuf (3) , et Lo u r c i r o quat re (4) . Il n'y a en Egypt e
q u e du riz barbu à balles jaunâtres. Le s babi tans du pays de S y ouâ b en cidt ivent
une espèce di f férente, celle à grains rougeât res (5) , et qui n'a pu êt re por t é e dans
c e t Oa s i s , au cent re des déser t s , que par des caravanes qui ont traversé l'Egypte.
On choisit dans le De l t a , p our semer le r i z , le grain le plus beau. On en
rempl i t des c o u f f e s , c ' e s t - à - d i r e , des sacs de feuilles de dattier. On les por t e
clans un canal o u dans un réservoir près des roue s d'ar rosement : ces couf fes
restent à moi t ié plongées dans l'eau , et y sont retournées chaque jour . L e -
r iz c omme n c e ainsi à germer . On sor t les couf fes de l 'eau, le cinquième o u
le sixième j o u r ; et on les v i d e , en met t ant le grain par tas sur une c ouche de
trèHe f rai s , et en couvrant les tas avec du trèfle. On ne r emue ensuite le riz qu'au
b o u t de v i n g t - q u a t r e heures. O n l ' e t end, e t on le l a i s s e , pendant un j o u r ,
r e couve r t de trèHe que l'on ot e le s o i r : il est exposé à la rosée de la nuit. On le
s ème le ma t in dans un champ qui a été couve r t d'eau , et d'où elle ne s'est même
pa s ent ièrement écoulée. On me t , par la suite , le champ plusieurs fois à s e c ,
à de cour t s intervalles , p our forcer le riz à prendre racine et à ne pas surnager.
Plus tard on net toie le champ de diverses mauvai ses herbes ; et en même t emps qu'on
les a r r a che pour les jeter , on ar rache aussi quelques touffes t rop épaisses de r i z , afin
de les p o r t e r , soit dans des endroi t s qui ont été clair-semés , soi t dans des po r -
t ions de que lque champ voi s in, préparé p our les recevoi r . Ce t t e t ransplantat ion
est facile dans la b o u c , d'où l'on tire le riz pa r ses t ige s , et sur laquelle on le
repl a c e . L' eau dans laquelle baigne le pied du r i z , jusqu'à c e que le grain soi t
mû r , provient des machines d'ar rosement qui servent à la puiser dans le Ni l ;
el le se distribue aussi d'el le-même au t emps de l ' inonda t ion, et son cour s est réglé
pa r les digues qui prot ègent les champs .
O n ré col t e le riz en o c t o br e , après qu'il est resté sept moi s en terre ; on
le bat sous le nor e g (6). L e g r a in, séparé de la pa i l l e , cons e rve sa balle ou env
e l o p p e f l o r a l e , f e rmement adhérente c omme celle de l ' o r g e ; et on l'appelle
dans c e t é t a t , roui cha'yr, riz en orge. Il s'agit de le piler dans des mo r t i e r s ,
jusqu'au point de le rendre bl anc , en lui enlevant sa balle et sa pel l icule
p r o p r e , celle qui ressemble à la pellicule d'où résulte le s o n , quand on mout du
( ï ) y^i^ Browne , Voyage en { [ ) Voyage dans le Levant . ;-irt. I . " , p a g . j 6 j , Eg y p t e , tome I . " ,
(2) Hiu. plant. Tib. !V, cap. j , pag. 347*
(3) Hirb. Amboin. torn. V, pag. 198 et 201.
(4) Flora Coclilncliin.wm. I , pag.367, ei/enfe Villden,
Berol. lynj.
ptg-js-
(6) Voyelle noreg figuriisur ies planches y i i
des Arts et Metiers, L. M. vol 11.
blé
C U L T I V E E S E N L G Y P T E . i y
Lié. L e s ma chine s , garnies de p i l ons , sont mues par des homme s ou par des
Loeuf s : les homme s ma r chent sur l'cxtrcmitc d'un levier en charpente , et la
font baisser par leur p o i d s , tandis que l'extrémitc oppos é e s élève p our r e tombe r .
Le s boeuf s tournent des roues auxquelles sont adaptes plusieurs leviers ; un cylindre
de fer creux sert de p i l o n ; il est enté à angle droi t ^ u s l'extrémité la j)!us
longue de chaque l e v i e r , de manière à f rapper dans un mo r t i e r , en exécutant
le même mouv ement que feroit un mar t inet de forge. L e r i z , suffisamment pi l é , esc
passé au c r ibl e , q u i , d'un c ô t é , donne le grain s e u l , et de l 'aut re, rejet te les
f ragmens enlevés de la sur face du grain. On mêle avec le r i z , du sel marin s e c ,
qui l 'empcche de se gitter. Ce t t e utile denrée peut ainsi conserver son prix pendant
t rès - long- temps : on la répand dans toute l 'Ég ypt e , et on l'exporte aus s i , principalement
par mer .
L a haute Egypt e produi t be aucoup de sorgho , que les babitans regardent
c omme le grain le plus naturel à leur p a y s , et qu'ils nomment dounih beledy,
owdourah d'Egypte. On le sème dans les moi s de mar s et d ' a o û t , époque s qui
ne conviendroient pas au blé. L a terre l abourée est aplanie ave c un t ronc de
palmier traîné à sa surface : on la divise par petits espaces c a r r é s , p our forme r
autant de bassins à bords relevés. L' e au est amené e par une r igole entre
plusieurs carrés alignés ; on enlève suc ces s ivement , le l ong d'une r igol e , as sez de
terre p our faire entrer l'eau dans les c a r r é s , que l'on f e rme ensuite en r eme t t ant
de la terre dans les ouver tures que l'on avoi t faites. Ch a q u e carré d'un champ est
appelé b(yt; et c'est toujour s dans des compa r t imens de cet te espèce que les
Égypt iens pl a cent les plantes qui ont besoin d'être arrosées : ils suivent , dans les
c ampagnes et dans les j a rdins , le même mo d e d'irrigation p our les plantes
grandes et pe t i t e s , telles que le pourpier et la l a i tue , et p our les arbres , tels que
les dattiers. L e riz et la c anne à suc r e , ayant besoin de be auc oup plus d ' e a u ,
sont plantés dans des champs n o n divisés en c a r r é s , mai s imitant seulemént de
grands réservoirs.
L a manière de semer le OM doiirah beledy, consiste à en laisser tombe r
plusieurs grains dans des trous que l'on couvr e de terre ave c les pieds. L e s o r gho
que l'on s ème près du Ka i re au moi s de mar s , n'a besoin que d'un seul a r rosement
: s emé au moi s d ' a o û t , il demande à être arrosé davant age. S o n grain
est mûr en quat re moi s ; il est de la gros seur d'une s emenc e de chenevi s , un
peu pointu à sa ba s e , et r ond au s omme t . L a panicule épaisse qui termine chaque
t i g e , le produi t a b ondamment : sa fertilité surpasse celle des autres céréales. C e
grain n'est point c a ché dans la balle à sa ma t u r i t é , c omme le grain du b l é , de
l'orge ou du riz : il paroît à nu ])ar s on s omme t ; il est j a une , blanc ou noirât re.
On bat les panicules du sor gho sous le n o r e g , après les avoi r ret ranchées d u
s omme t des tiges qui ont été aupa ravant coupé e s près de terre. U n r o b a ' ( i ) d e grain
suffit pour ensemencer un feddân (2) , qui rend cinq à six nrdeb {3).
(1) Le robft' est ia 24. ' partie de rardeh; i l cquivaut à (5) C'est-à-dire , de neuf hectolitres et vingt-quatre
sept litres sept-dixièmes, ou à sept-douzièmes de boisseau, litres à onze hectolitres, ou de soixante-dix boisseau*
(2) Cinq cent quatre-vingt-treize millièmes d'hectare, cinq-sixièmes à quatre-vingt-cinq boisseaux,
ou un arpent soixante-treize perches et demie.
H. N. T O ME I I . C