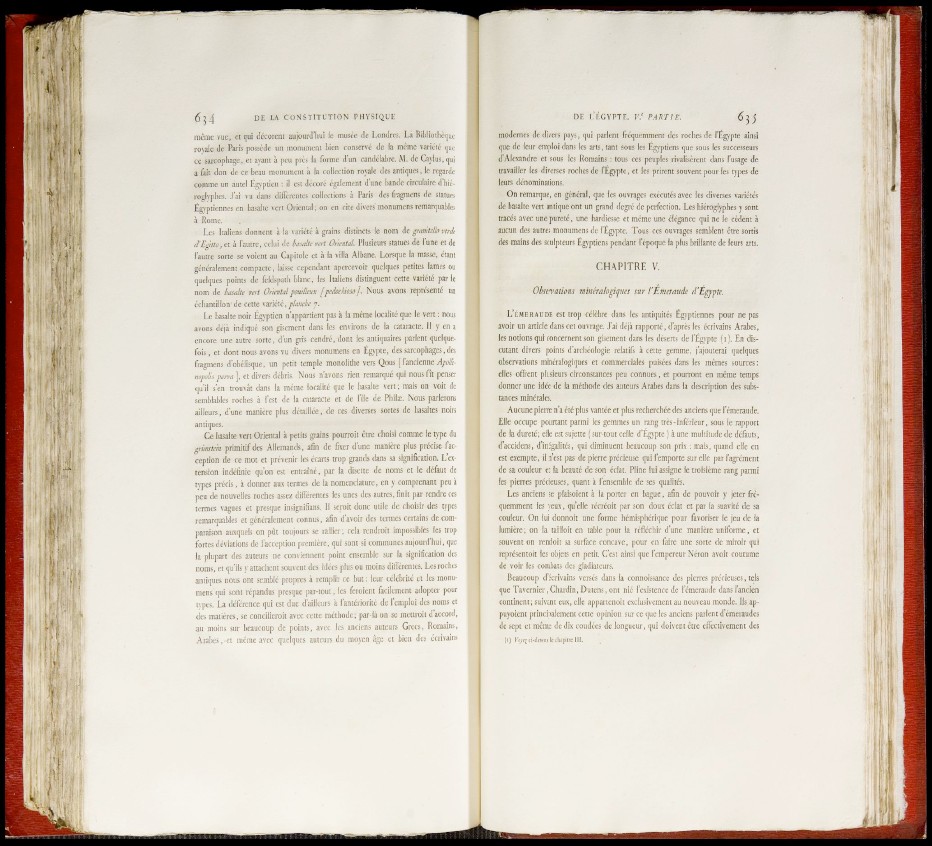
V
M
bu
6 3 4 DE LA C O N S T I T U T I O N P H Y S I Q U E
même vue , et qui décorent aujourd'iuii le musée de Londres . La BiMlotlicquc
royale de Paris possède un monument bien conservé de la même variété (]ue
ce sarcophage, et ayant à peu près la forme d'un candélabre. M. de Ca) lus , qui
a fait don de ce beau monument à la col lect ion royale des ant iques, le regarde
comme un autel Égypt ien : il est décoré également d'une bande circulaire d'hiéroglyphes.
J'ai vu dans différentes col lect ions à Paris des fragmens de statues
Égyptiennes en basalte vert Or iental ; on en cite divers monumens remarquables
à Rome .
Les Italiens donnent à la variété à grains distincts le nom de grankdlo vtrde
¿î'Egitto, et à l'autre, celui de ùiisalte vert OrlaitaJ. Plusieurs statues de l'une et de
l'autre sorte se voient au Capi tole et à la villa Al bane. Lor sque la masse, étant
généralement c omp a c t e , laisse cependant apercevoi r quelques petites lames ou
quelques points de feldspath blanc, les Italiens distinguent cette variété par le
nom de ù<isalte vert Orientai pouilleux [pedochtoso], Nous avons représenté un
échantillon de cette \sxiéié, pUnclie 7.
L e basalte noir Égypt ien n'appartient pas à la même localité que le vert : nous
avons déjà indique son gisement dans les environs de la cataracte. Il y en a
encore une autre sor t e , d'un gris cendré, dont les antiquaires parlent quelquefois
, et dont nous avons vu divers monumens en Egypt e , des sarcophages, des
fragmens d'obél isque, un petit temple monol i the vers Qous [ l 'ancienne y^/t?///-
îwpo/is parva ], et divers débris. Nous n'avons rien remarqué qui nous f î t penser
qu'il s'en trouvât dans la même localité (¡ue le basalte vert ; mais on voi t de
semblables roches à l'est de la cataracte et de l'île de Vhilx. Nous parlerons
ailleurs, d'une manière plus détai l lée, de ces diverses sortes de basaltes noirs
antiques.
C e basalte ver t Oriental à petits grains pour roi t être choisi c omme le type du
oriinsteln primi t i f des Al l emands , afin de fixer d'une manière plus précise l'acception
de ce mot et prévenir les écarts trop grands dans sa signification. L'extension
indéfinie qu'on est ent raîné, par la disette de noms et le défaut de
types préc i s , à donner aux termes de la nomenc lature , en y comprenant peu à
peu de nouvel les roches assez différentes les unes des autres, finit par rendre ces
termes vagues et presque insignifians. Il seroit donc utile de choisir des types
remarquables et généralement connus , afin d'avoir des termes certains de comparaison
auxquels on put toujours se rallier; cela rendroit impossibles les trop
fortes déviations de l 'accept ion première, qui sont si commune s aujourd'hui , que
la plupart des auteurs ne conviennent point ensemble sur la signification des
noms, et qu'ils y attachent souvent des idées plus ou moins différentes. Le s roches
antiques nous ont semblé propres à remplir ce but : leur célébrité et les monumens
qui sont répandus presque par - tout , les feroient faci lement adopter pour
types. La déférence qui est due d'ailleurs à l'antériorité de l 'emploi des noms et
des mat ières, se conci l ieroi t avec cette mé thode ; par-là on se mct troi t d'accord,
au moins sur beaucoup de point s , avec les anciens auteurs Gr e c s , Romains,
Arabes,-et même avec quelques auteurs du moyen âge et bien des écrivains
DE L L O Y P T E . V.' PARTIE.
modernes de divers pays, qui parlent fréquemment des roches de i'Égypte ainsi
que de leur emploi dans les arts, tant sous les Égyptiens que sous les successeurs
d'Alexandre et sous les Romains : tous ces peuples rivalisèrent dans l'usage de
travailler les diverses roches de i 'Égypte, et les prirent souvent pour les tyjies de
leurs dénominations.
O n remarque, en général , que les ouvrages exécutés avec les diverses variétés
de basalte vert antique ont un grand degré de perfect ion. Le s hiéroglyphes y sont
traces avec une pur e t é , une hardiesse et même une élégance qui ne le cèdent à
aucun des autres monumens de I'Égypte. T o u s ces ouvrages semblent être sortis
des mains des sculpteurs Égyptiens pendant l'époque la plus brillante de leurs arts.
C H A P I T R E V.
Observations minéralogiqties sur l'Ènieraude d'Egypte.
L'ÉMERAUDE est trop célèbre dans les antiquités Égypt iennes pour ne pas
avoir un article dans cet ouvrage. J'ai déjà rappor té, d'après les écrivains Arabes ,
les not ions qui concernent son gisement dans les déserts de l'ÉgA'pte ( i ). En discutant
divers points d'archéologie relatifs à cette g emme , j'ajouterai quelques
observations minéralogiques et commerciales puisées dans les mêmes sources :
elles offrent plusieurs circonstances peu c onnue s , et pour ront en même temps
donner une idée de la méthode des auteurs Arabes dans la description des substances
minérales.
Aucune pierre n'a été plus vantée et plus recherchée des anciens que l'émeraude.
Elle oc cupe pourtant parmi les gemmes un rang t rès - infér ieur , sous le rapport
de la dureté; elle est sujette (sur-tout celle d'Ég}'pte ) à une multitude de défauts,
d'accidens, d'inégalités, qui diminuent beaucoup son prix : mais, quand elle en
est exempte, il n'est pas de pierre précieuse qui l 'emporte sur elle par l'agrément
de sa couleur et la beauté de son éclat. Pline lui assigne le troisième rang panni
les pieiTes précieuses, quant à l'ensemble de ses qualités.
Les anciens se plaisoient à la porter en ba gue , afin de pouvoi r y jeter fréquemment
les y eux , qu'elle récréoi t par son doux éclat et par la suavité de sa
couleur. On lui donnoi t une forme hémisphérique pour favoriser le jeu de la
lumière; on la tailloit en table pour la réfléchir d'une manière uni f o rme , et
souvent on rendoi t sa surface conc a v e , pour en faire une sorte de miroir qui
rej)résentoit les objets en petit. C'est ainsi que l'empereur Né ron avoit coutume
de voi r les combats des gladiateurs.
Beaucoup d'écrivains versés dans la connoissance des pierres précieuses, tels
que Ta v e r n i e r , Chardin, Dut ens , ont nié l'existence de l'émeraude dans l'ancien
continent; suivant eux, elle appartenoi t exclusivement au nouveau nionde. Ils appuyoient
j)rincipalement cette opinion sur ce que les anciens parlent d'émeraudes
de sejn et même de dix coudées de longueur , (|ui doivent être ef fect ivement des
(1) Ko/i^ CÌ-CIMSUS le chapitre M.
m
ii
F
LILI