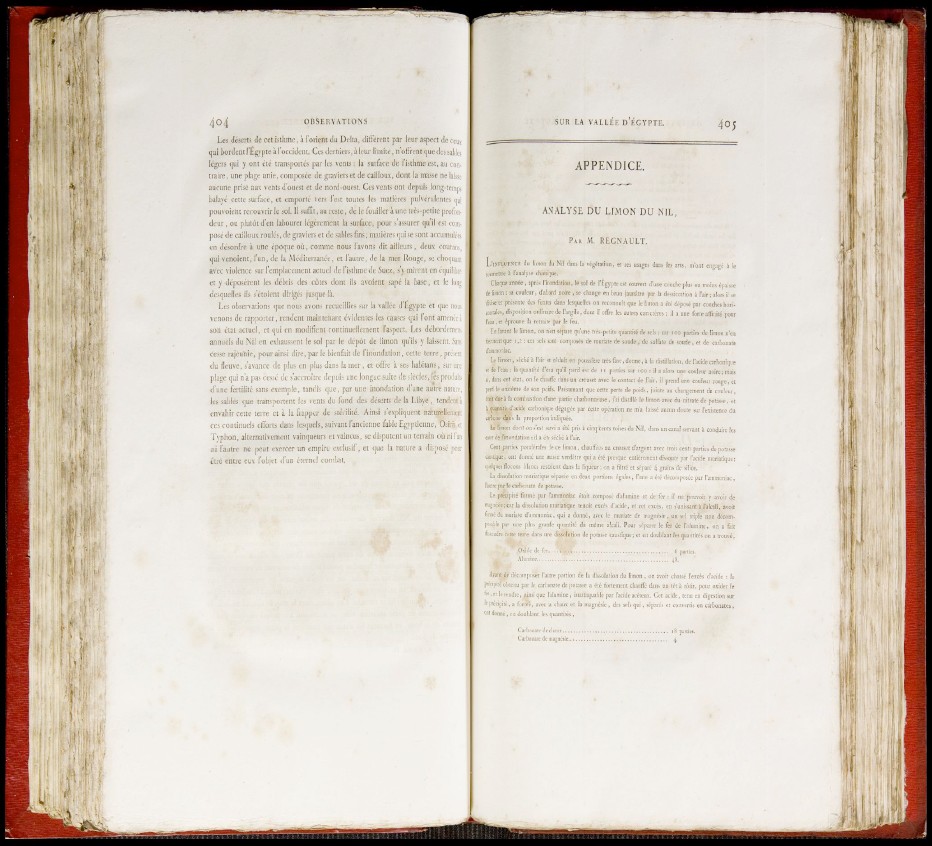
s í ? ,
I' ,' Níi -i
4 0 4 O B S E R V A T I O N S
Les déserts de c e t i s t hme , à l 'or i ent du De l t a , di fTèrcnt par leur a spe c t de ceux
qui b o r d en t l 'Eg ypt e à l ' o c c ident . C e s de rni e r s , à leur l imi t e , n' o f f r ent que dessables
légers qui y o n t é t é t ranspor t é s par les v ent s : la sur face de l ' i s thme es t , au contraire,
une pl a g e uni e , c omp o s é e de gravier s et de c a i l loux , d o n t la mas se ne laisse
aucune pr i se aux v ent s d'oue s t et de no rd- oue s t , C e s v ent s o n t depui s long-temps
balayé c e t t e sur f a c e , et emp o r t é v e r s l'est tout e s les mat i è r e s pul v é rul ent e s (]ui
p o u v o i e n t r e c o u v r i r le sol . Il sui l î t , au r e s t e , de le foui l l e r à une t rès -pet i te profondeur
, ou plut ô t d' en l abour e r l é g è r eme n t la sur f a c e , p o u r s'assurer qu'il est composé
de cai l loux r oul é s , de gr a v i e r s et de sables f ins ; ma i i è r e s (¡uise sont accumulées
en dé s o rdr e à u n e é p o q u e o ù , c omme no u s l 'avons di t a i l l e u r s , deux courant,
qui v e n o i e n t , l 'un, de la Mé d i t e r r a n é e , et l 'aut r e, de la me r l î o u g e , se choquant
aVec v i o l e n c e sur l ' emp l a c eme n t ac tuel de l ' i s thme de S u e z , s'y mi r e n t en équililire
et y d é p o s è r e n t les débr i s de s côt e s d o n t ils a v o i e n t sapé la b a s e , et le long
desquelles ils s c t o i e n t di r igés jusque-là.
L e s obs e r v a t i ons que n o u s a v o n s recuei l l ies sur la val l é e d 'Eg y p t e et que nous
venons de r a p p o r t e r , r e n d e n t ma int enant é v ident e s les causes qui l 'ont amem'cà
son état a c t u e l , et qui en mo d i f i e n t c o n t i n u e l l eme n t l 'aspect , Le s débordemel^
annuels du Ni l en exhaus sent le sol par le d é p ô t de l imo n qu'ils y laissent. Sans
cesse r a j e uni e , p o u r ainsi di r e , par le bienfai t de l ' i n o n d a t i o n, c e t t e t e r r e , préspiii
d u í í e u v e , s ' a v anc e de plus en plus dans la m e r , et o f f r e à ses habi t ans , sur une
plage qui n'a pas cessé de s 'ac c roî t r e depui s une l o n g u e sui te de s i è c l e s , les produits
d'une fer t i l i té sans e x emp l e , tandi s q u e , par une i n o n d a t i o n cl'une aut r e nature,
les sables q u e t r anspor t ent les v ent s du f o n d de s déserts de la L i b ) e , tendent à
envahir c e t t e ter re et à la f r a p p e r de s téi i l i té. Ai n s i s ' e xpl iquent naturellemem
ces c ont inu e l s e f for t s dans lesquel s , suivant l ' anc i enne fable Eg y p t i e n n e , Osiris et
T y p h o n , a l t e rna t i v ement v a inqueur s et v a incus , se di sput ent un terrain où nirun
ni l 'autre ne p e u t e x e r c e r un emp i r e e x c l u s i f , et que la na tur e a di.-posé pour
ctré ent r e eux l 'objet d'un c t e rnc i c omb a t .
S U R LA V A L L E E D E G Y P T E . 4 0 5
m'ont engngé à i e
APPENDICE.
A N A L Y S E D U L I M O N D U N I L ,
PAR M, I Î E G N A U L T .
L'iNFUJr.NCE du limon du Nil dans la végétation, et ses usages dans les a
sjumetire à i'anaiyse chiinique.
Chaque année , apr« l'inondatioi!, le sol de i'Égypte est couvert d'une couche plus ou moins épaisse
de limon : sa couleur, d'abord noire , se change en brun jaunâtre par la dessiccation à ('air ; aîors if se
divise et présente des fentes dans lesquelles on reconnoît que le limon a éi<- déposé par couches horiîontales,
dis])osiiion ordinaire de l'argile, dont il offre les autres car,--ctères : il a une forte affinité pour
l'eau, et éprouve h retraite par le feu.
En lavant le limon, on n'en sépare qu'une très-petite quantité de sel« ; car 100 parties de limon n'en
tiennent que 1,2 : ces seN sont composés de muriate de soude , de sulfate de soude, et de carbonate
d'ammoniac.
Le limon, séché h l'air et réduit en poussière très-fine, donne, à la distillation, de l'acide carbonique
et de l'eau ; la quantité d'eau qu'il perd est de 1 i parties sur 100 : il a alors une couleur noire; mais
si, dans cet état, on le chauffe dans un creuset avec le contact de l'air, il prend une couleur rouge, et
1 poids. Présumant que cette perle de poids, jointe au changement de couleur,
perd le onzième de
éioit due à la combustion d'une partie charbonneuse
li distillé le limon avec du nitrate de potasse , et
la quantité d'acide carbonique dégagée par cette opération
1 laissé aucun doute s
larbone dans la proportion indiquée.
Le limoli dont on s'est servi a été pris à cinq cents toises du Nil, dans
n canal s< it h conduire les
eau* de l'inondation : ii a été séché à l'air.
Cent parties pondérales de ce limon, chauffées au creuset d'argent avec trois cents parties de pot.isse
caustique, ont donné une masse verd'itre qui a été presque entièrement dissoute par l'acide niuriatique;
quelques flocons blancs restoient d.ins la liqueur ; on a filtré et séparé 4 grains de silice.
La dissolution muriatique séparée en deux portions égales, l'une a été décomposée par l'annnoniac,
l'autre par le carbonate de potasse.
Le prfeipité fonné par l'ammoniac étoit composé d'alumine et de for : il ne pouvoit y avoir de
magnésie; car la dissolution muriatique tenoit excès d'acide, et cet excès, en s'unissant à l'alcali, avoit
formé du muriate d'ammoniac, qui a donné, avec le muriate de magnésie, un sel triple ne
posalile par une plus grande quantité du même .lîcali. Pour s-.'p.irer le fer de l'alumine,
dissoudre cette terre dans une dissolution de potasse caustique; et en doublant les quantités or
déco mlì
a fait
trouvé,
OxUW de f-r.
Alumine
, 6 parties
. 48.
Avant de décomposer l'autre portion de la dissolution du limon , on avoit chassé l'excès d'acide ; le
rrtiipiré obtenu par le carbonate de potasse a été fortement chauffé dans un tèt à rôtir, pour oxider le
fer, et le rendre, ainsi que l'alumine , inattaquable par l'acide acéteux. Cet acide, tenu en digestion sur
le précii)iié, a birmé, avec la chaux et la magnésie , des sels qui, séparés et convertis en carbonates,
on! donné , en doubl.int les quantités ,
Carbonate île chaux..
Carbonaie de magnesi.
8 parties.
l ì / -
ü i : - i m