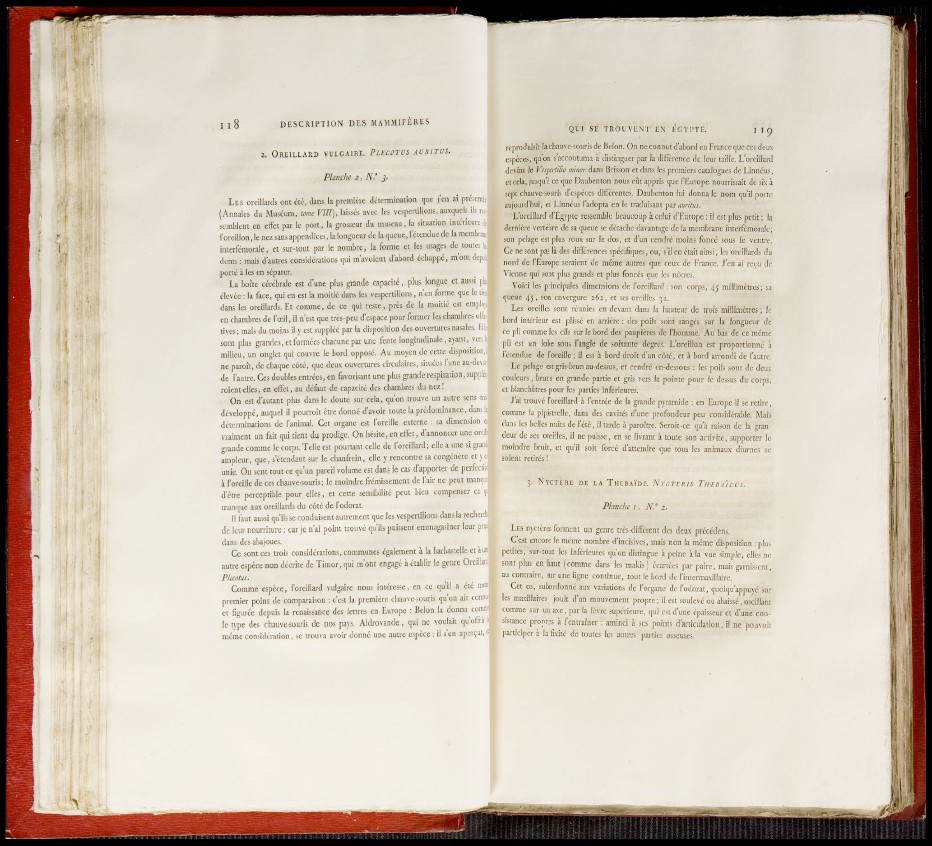
L L 8 D E S C R I P T I O N D E S M A M M I F È R E S
2, O R E I L L A R D V U L G A I R E . PLECOTVS AVRITVS.
Planche 2, N.' 3.
LES oreillaids ont été, dans la première détermination que j'en ai présemii
(Annales du Muséum, tomi Vili), laissés avec les vespertilions, auxquels ils rtssemblent
en effet par le por t , la grosseur du museau , la situation intérieure 4
l'oreillon, le nez sans appendices, la longueur de la queue, l'étendue de la membra«
interfemorale, et sur-tout par le nombre, la forme et les usages de toutes fc
dents : mais d'autres considérations qui m'avoient d'abord échappé, m'ont deput
porté à les en séparer.
La boîte cérébrale est d'une plus grande capacité, plus longue et aussi pli
élevée : la 6 c e , qui en est la moitié dans les vespertilions, n'en forme que le tiei
dans les oreillards. Et comme, de ce qui reste, près de la moitié est emploi,
en chambres de l'oeil, il n'est que très-peu d'espace pour former les chambres olfac
tives ; mais du moins il y est suppléé par la disposition des ouvertures nasales. Elit
sont plus grandes, et formées chacune par une fente longitudinale , ayant, vers '
milieu, im onglet qui couvre le bord opposé. Au moyen de cette disposition
ne paroît, de chaque côté, que deux ouvertures circulaires, situées l'une au-den
de l'autre. Ces doubles entrées, en favorisant une plus grande respiration, supplii
roient-elles, en ef fet , au défaut de capacité des chambres du ne z :
On est d'autant plus dans le doute sur cela, qu'on trouve un autre sens ttè
développé, auquel il pourroit être donné d'avoir toute la prédominance, dans k
déterminations de l'animal. Ce t organe est foreille externe ; sa dimension n
vraiment un fait qui tient du prodige. On hésite, en ef fet , d'annoncer une orcil;
grande comme le corps. Tel le est pourtant celle de l'oreillard ; elle a une si grani
ampleur, que, s'e'tendant sur le chanfrein, elle y rencontre sa congénère et y e,
unie. On sent tout ce qu'un pareil volume est dans le cas d'apporter de perfeciic
à foreille de ces chauve-souris; le moindre frémissement de fair ne peut manqii
d'être perceptible pour elles, et cette sensibilité peut bien compenser ce iimanque
aux oreillards du côté de l'odorat.
Il faut aussi qu'ils se conduisent autrement que les vespertilions danslarecheict
de leur nourriture : car je n'ai point trouvé qu'ils puissent emmagasiner leur proi
dans des abajoues. _ ,
C e sont ces trois considérations, communes également à la barbastelle etàui:,
autre espèce non décrite de Timo r , qui m'ont engagé à établir le genre Oreillaii
PUcotus.
Comme espèce, l'oreillard vulgaire nous intéresse, en ce qu'il a été notii
premier point de comparaison : c'est la première chauve souris qu'on ait connu
et figurée depuis la renaissance des lettres en Europe : Belon la donna comitî
le type des chauve-souris de nos pays. Aldrovande , qui ne voulait qu'offrir li
même considération, se trouva avoir donné une autre espèce ; il s'en aperçut, c.
QUI SE T R O U V E N T EN E G Y P T E . 1 1 5 1
reproduisit la chauve-souris de Belon. On ne connut d'abord en France que ces deux
espèces, qu'on s'accoutuma à distinguer par la différence de leur taille. L'oreillard
devint le VespenU'w minor dans Brisson et dans les premiers catalogues de Linnéus,
et cela, jusqu'à ce que Daubenton nous eilt appris que l'Europe nourrissait de six à
sept chauve-souris d'espèces différentes. Daubenton lui donna le nom qu'il porte
aujourd'hui, et Linnéus l'adopta en le traduisant par auriùis.
L'oreillard d'Egypte ressemble beaucoup à celui d'Europe : il est plus petit ; la
dernière vertèbre de sa queue se détache davantage de la membrane interfémorale;
son pelage est plus roux sur le dos, et d'un cendré moins foncé sous le ventre.
Ce ne sont pas là des différences spécifiques, ou, s'il en était ainsi, les oreillards du
nord de l'Europe seraient de même autres que ceux de France. J'en ai reçu de
Vienne qui sont plus grands et plus foncés que les nôtres.
Voici les principales dimensions de l'oreillard : son corps, 45 millimètres; sa
queue son envergure 262, et ses oreilles 32.
Les oreilles sont réunies en devant dans la hauteur de trois millimètres ; le
bord intérieur est plissé en arrière ; des poils sont rangés sur la longueur de
ce pli comme les cils sur le bord des paupières de l'homme. Au bas de ce même
pli est un lobe sous l'angle de soixante degrés. L'oreillon est proponionné à
l'étendue de l'oreille ; il est à bord droit d'un côte, et à bord aiTondi de l'autre.
Le pelage est gris-brun au-dessus, et cendré en-dessous : les poils sont de deux
couleurs, bruns en grande partie et gris vers la pointe pour le dessus du corps,
et blanchâtres pour les parties inférieures.
J'ai trotivé l'oreillard à l'entrée de la grande pyramide : en Europe il se retn-e,
comme la pipistrelle, dans des cavités d'une profondeur peu considérable. Mais
dans les belles nuits de l'été, il tarde à paroître. Seroit-ce qu'à raison de la grandeur
de ses oreilles, il ne puisse, en se livrant à toute son activité, supporter le
moindre bruit, et qu'il soit forcé d'attendre que tous les animaux diurnes se
soient retirés
3. NY C T È R E DE LA THËBA'ÎDE. NYCTERIS THEBA'ÎCUS.
Planche i. N.' 2.
LES nyctères forment un genre très-différent des deux précédens.
C'est encore le même nombre d'incisives, mais non la même disposition ; plus
petites, sur-tout les inférieures qu'on distingue à peine à la vue simple, elles ne
sont plus en haut (comme dans les makis) écartées par paire, mais garnissent,
au contraire, sur une ligne continue, tout le bord de l'intermaxillairc.
Cet os, subordonné aux variations de l'organe de l'odorat, quoiqu'apptiyé sur
les maxillaires, jouit d'un mouvement propre ; il est soulevé ou abaissé, oscillant
comme sur un axe, par la lèvre supérieure, qui est d'une épaisseur et d'une consistance
propres à l'entraîner : aminci à ses points d'articulation, il ne pouvoir
participer à la fixité de toutes les autres parties osseuses.
S u
r '
! « • '
. iti