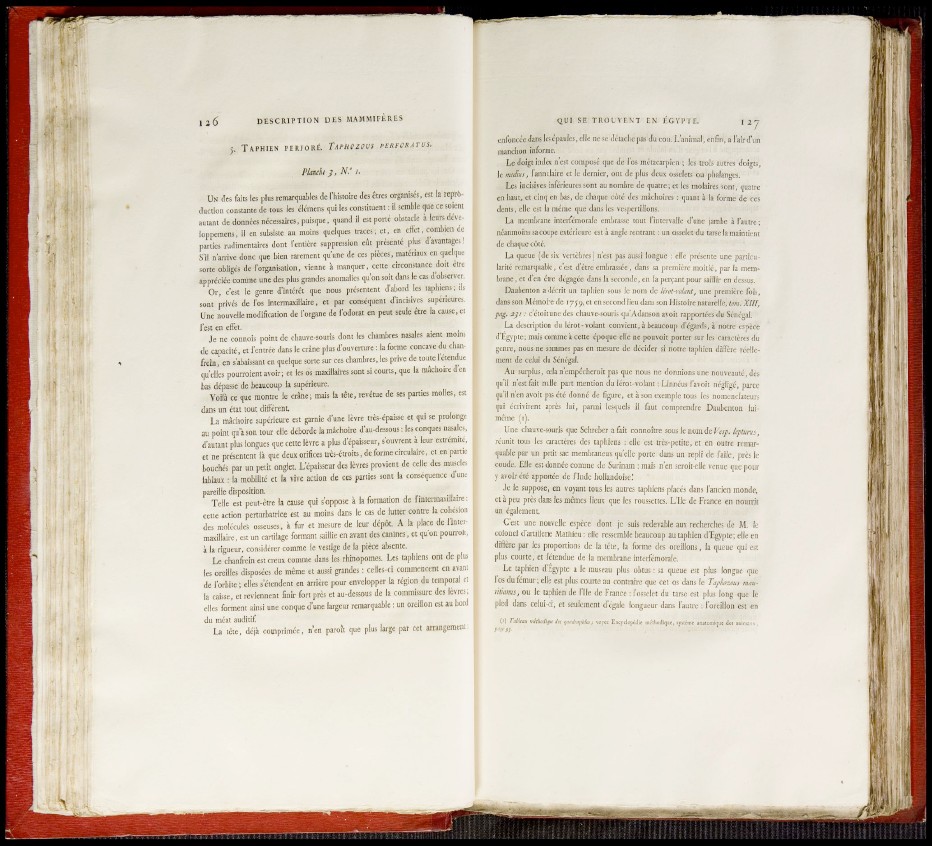
120 D E S C R I P T I O N D E S MAMMI F È R E S
5. T A PHI E N PERFORÉ. T^P/JÛZÛUS P£I!F01iATUS.
Pimch 3, N.' I.
UN cfcs faits les plus rematquables de l'histoire des êtres organisés, est la reproduction
constante de tous les elcmens qui les constituent ; il semble que ce soient
autant de données nécessaires, puisque, quand il est porté obstacle à leurs dcvcloppemens,
il en subsiste au moins quelques traces; e t . en ef fet , combien de
parties rudimentaires dont l'entière suppression eût présenté plus d'avantages I
S'il n'arrive donc que bien rarement qu'une de ces pièces, matériaux en quelque
sorte obligés de l'organisation, vienne à manquer , cette circonstance doit etre
appréciée comme une des plus grandes anomalies qu'on soit dans le cas d'observer.
Or, c'est le genre d'intérêt que nous présentent d'abord les tapliiens ; ils
sont prives de l'os intermaxillaire, et par conséquent d'incisives supérieures.
Une nouvelle modification de l'organe de l'odorat en peut seule être la cause, et
l'est en effet.
Je ne connois point de chauve-souris dont les chambres nasales aient moins
de capacité, et l'entrée dans le crâne plus d'ouverture : la forme concave du chanfrein,
en s'abaissant en quelque sorte sur ces chambres, les prive de toute 1 ctendue
qu'elles pourroient avoir; et les os maxillaires sont si courts, que ia mâchoire d e n
bas dépasse de beaucoup la supérieure.
Voilà ce que montre le crâne; mais la tête, revêtue de ses parties mol les, est
dans un état tout différent.
L a mâchoire supérieure est garnie d'une lèvre très-épaisse et qui se prolonge
au point qu'à son tour elle déborde la mâchoire d'au-dessous : les conques nasales,
d'autant plus longues que cette lèvre a plus d'épaisseur, s'ouvrent à leur extrémité,
et ne présement là que deux orifices très-étroits, de forme circulaire, et en partie
bouchés par un petit onglet. L'épaisseur des lèvres provient de celle des muscles
labiaux : la mobilité et la vive action de ces parties sont la conséquence dune
pareille disposition.
Telle est peut-être la cause qui s'oppose à la formation de fintermaxillaire :
cette action perturbatrice est au moins dans le cas de lutter contre la cohésion
des molécules osseuses, à fur et mesure de leur dépôt. A la place de lintermaxillaire,
est un cartilage formant saillie en avant des canines, et qu'on pourroit,
à la rigueur, considérer comme le vestige de la pièce absente.
L e chanfrein est creux comme dans les rhinopomes. Les taphiens ont de plus
les oreilles disposées de même et aussi grandes : celles-ci commencent en avani
de l'orbite ; elles s'étendent en arrière pour envelopper la région du temporal et
la caisse, et reviennent finir fort près et au-dessous de la commissure des lèvres;
elles forment ainsi une conque d'une largeur remarquable : un oreillon est au bord
du Lma éatte taeu, dditéijf à couipr imé e. n'en paroît que plus large par cet arrangement:
QUI SE T R O U V E N T EN E G Y P T E . 1 2 7
cnlbncce tîans Icscpauies, elle ne se ilctacliepas du cou. L'animal, enfin, a l'air d'un
manchon informe.
L e doigt index n'est compose cjuc de l'os métacarpien ; les trois autres doigts,
Je médius, l'annulaire et le dernier, ont de plus deux osselets ou piialanges.
Les incisives inférieures sont au nombre de quatre ; et les molaires sont, quatre
en haut, et cinq en Las, de chaque côté des mâchoires : quant à la forme de ces
dents, elle est la même que dans les vespertilions.
La membrane interfémorale embrasse tout l'intervalle d'une jambe à l'autre ;
néanmoins sa coupe extérieure est à angle rentrant : un osselet du tarse la maintient
de chaque coté.
La queue (de six vertèbres) n'est pas aussi longue : elle présente une particularité
remarquable, c'est d'être embrassée, dans sa première moi t ié, par la membrane
, et d'en être dégagée dans la seconde, en la perçant pour saillir en dessus.
Daubenton a décrit un taphien sous le nom de léroH'olunt, une première fois,
dans son Mémoi re de 17^9, et en second lieu dans son Histoire naturelle, torn. XIU,
pag. 2^1 : c'étoit une des chauve-souris qu'Adanson avoit rapportées du Sénégal.
La description du lérot -volant convient , à beaucoup d'égards, à notre espèce
d'Ég)'pte; mais comme à cette époque elle ne pouvoit porter sur les caractères du
genre, nous ne sommes pas en mesure de décider si notre taphien diffère réellement
de celui du Sénégal.
A u swplus, celan'empccheroi t pas que nous ne donnions une nouveauté, dès
qu'il n'est fait nuüe part mention du lérot-volant : Linnéus l'avoit négligé, parce
qu'il n'en avoit pas été donné de figure, et à son exemple tous les nomenclateurs
qui écrivirent après lui , parmi lesquels il faut comprendre Daubenton luimême
{i}.
Une chauve-souris que Schreber a fait connoître sous le nom de Vcsp. lepturus,
réunit tous les caractères des taphiens : elle est très-petite, et en outre remarquable
par un petit sac membraneux qu'elle porte dans un repli de l'aile, près le
coude. Elle est donnée comme de Surinam : mais n'en seroit-elle venue que pour
y avoir été apportée de l'Inde hollandoisef
Je le suppose, en voyant tous les autres taphiens placés dans l'ancien monde,
et à peu près dans les mêmes lieux que les roussettes. L' I le de France en nourrit
un également.
C'est une nouvelle espèce dont je suis redevable aux recherches de M. le
colonel d'artillerie Mathieu : elle ressemble beaucoup au taphien d'Ég>'ptc; elle en
difièrc par les proportions de la tête, la forme des orei l lons, la queue qui est
plus courte, et l'étendue de la membrane interfémoralc.
L e taphien d'Egypte a le museau plus obtus : sa queue est plus longue que
l'os du fémur ; elle est plus courte au contraire que cet os dans le Taphozous mau -
ritianus, ou le taphien de l'Ile de France : l'osselet du tarse est plus long que le
pied dans celui-ci, et seulement d'égale longueur dans l'autre : l'oreillon est en
(1) Tableau méihodi<iue des quadrup^dts; voyez Eiicjlc'illoiopdcidqiuc e1, système anatomit^ue des
H.