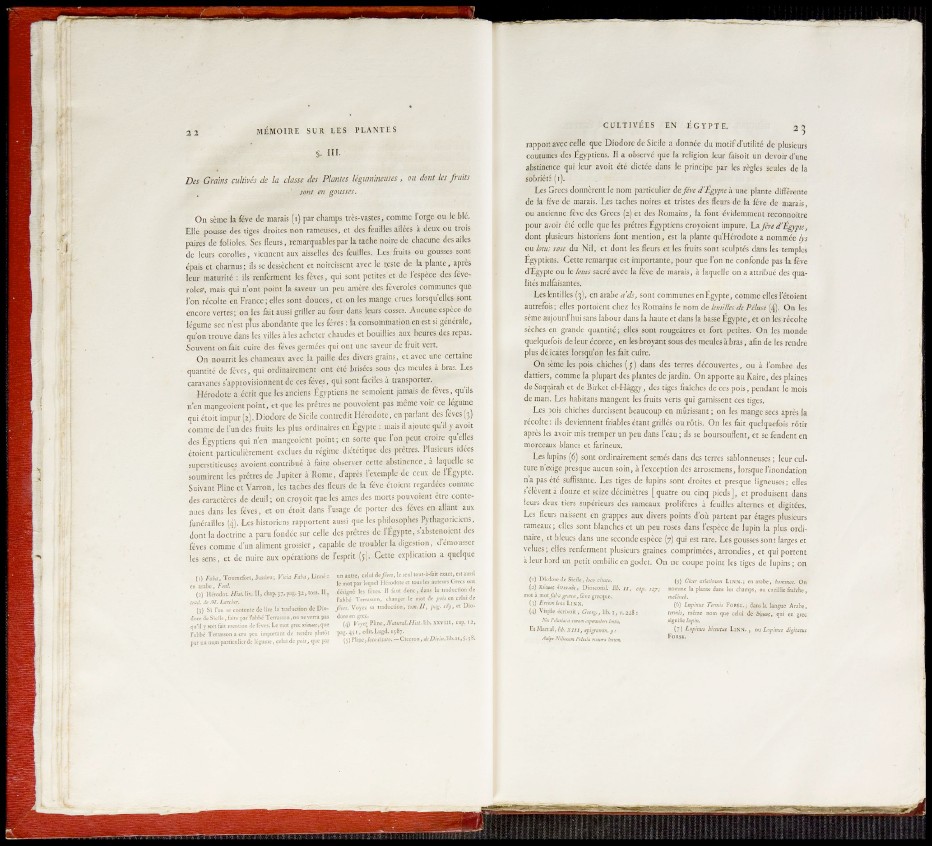
' I l
• I ! ' :
i
3 2 M É M O I R E S U R L E S P L A N T E S
§. i n .
Des Grains cultivés de la classe des Plantes légumineuses, ou dont les fruits
On sème la féve de marais (i) par champs très-vastes, comme l'orge ou le blé.
Elle pousse des tiges droites non rameuses, et des feuilles ailées à deux ou trois
paires de folioles. Ses fleurs, remarquables par la tache noire de chacune des ailes
de leurs corolles, viennent aux aisselles des feuilles. Les fruits ou gousses sont
épais et charnus; ils se dessèchent et noircissent avec le r.este de la plante, après
leur maturité : ils renferment les fèves, qui sont petites et de l'espèce des féveroles,
mais qui n'ont point la saveur un peu amère des féveroies communes que
l'on récolte en France ; elles sont douces, et on les mange crues lorsqu'elles sont
encore vertes; on les fait aussi griller au four dans leurs cosses. Aucune espèce de
legiune sec n'est plus abondante que les fèves : la consommation en est si générale,
qu'on trouve dans les villes aies acheter chaudes et bouillies aux heures des repas.
Souvent on fait cuire des fèves germées qui ont une saveur de fruit vert.
On nourrit les chameaux avec la paille des divers grains, et avec une certaine
quantité de fèves, qui ordinairement ont été brisées sous des meules à bras. Les
caravanes s'approvisionnent de ces fèves, qui sont faciles à transporter. ^
Hérodote a écrit que les anciens Égyptiens ne scmoient jamais de fèves, qu'ils
n'en mangeoient point, et que les prêtres ne pouvoient pas même voir ce légimie
qui étoit impur (2). Diodore de Sicile contredit Hérodote, en parlant des fèves (3)
comme de l'un des fruits les plus ordinaires en Egypte : mais il ajoute qu'il y avoit
des Égyptiens qui n'en mangeoient point ; en sorte que l'on peut croire qu'elles
étoient particulièrement exclues du régime diététique des prêtres. Plusieurs idées
superstitieuses avoient contribué à faire observer cette abstinence, à laquelle se
soumirent les prêtres de Jupiter à Rome, d'après l'exemple de ceux de l'Égypte.
Suivant Pline et Varron, les taches des fleurs de la féve étoient regardées comme
des caractères de deuil ; on croyoit que les ames des morts pouvoient être contenues
dans les fèves, et on étoit dans l'usage de porter des fèves en allant aux
C U L T I V É E S EN É C Y P T E .
funérailles (4). Les historiens rapportent aussi que les philosophes Pythagoriciens,
dont la doctrine a paru fondée sur celle des prêtres de l'Egypte, s'abstenoient des
fèves comme d'un aliment grossier , capable de troubler la digestion, d'èmousser
les sens, et de nuire aux opérations de l'esprit (5). Cette explication a quelque
•u; Viiid F i t t a , L i n n t :
m. I I ,
(1) Faba, Tournefort, J
en arabe , Foui.
(2) Hé rodot . HistAW. I I , chap.37,pag. ¡2
irad. dr; M. Larriier.
(3) Si l'on se contente de lire ia traduction de Di o -
dore de Sicile , faite par l'abbé Terrasson, on ne verra pas
qti'il y 3oit lait mention de fèves. Le mot grec Kiiauac.que
l'abbé Terrasson a cru peu important de rendre plutôt
par un nom particulitrde légume, celui de ¡wis, que par
un autre, celui deféves, le seul tout-à-fait exact, est aussi
le mot par lequel Hérodote et tous les auteurs Crées ont
désigné les fèves. Il faut d o n c , dans la traduction de
l'abbé Terrasson, changer le luoi de en celui de
fiveî. Voyez sa tr.iduction, tem.Il, pci^. ¡S'), et Diodore
en grec.
{4) PUrie,Niitiiriil,//ist. lib. x x y n l , cap. I 2 ,
pag. 4 5 1 , edi t .Lugd. 15B7.
(5)Plinc,/ûroCii<iio.-Ciccroii,rf.-Wi';/i.lib.il,S.ïR.
rapport avec celle guc Diodore de Sicile a donnée du motif d'utilité de plusieurs
coutumes des Égyptiens. Il a observé que la religion leur faisoit un devoir d'une
abstinence qui leur avoit été dictée dans je principe par les règles seules de la
sobriété (i).
Les Grecs donnèrent le nom particulier de/éue d'Ég^pie à une plante différente
de ia féve de marais. Les taches noires et tristes des fleurs de la féve de marais,
ou ancienne féve des Grecs (2) et des Komains, la font évidemment reconnoître
pour avoir été celle que les prêtres Égyptiens croyoient impure, La five d'Egypte,
dont plusieurs historiens font mention, est la plante qu'Hérodote a nommée lys
ou lotus rose du Nil, et dont les fleurs et les fruits sont sculptés dans les temples
Égyptiens. Cette remarque est importante, pour que l'on ne confonde pas la féve
d'Égypte ou le lotus sacré avec la féve de marais, à laquelle on a attribué des qualités
malfaisantes.
Les lentilles (3), en arabe a'ds, sont communes en Egypte, comme elles l'étoient
autrefois ; elles portoient chez les Romains le nom de lemilles de Péluse (4). On les
sème aujourd'hui sans labour dans la haute et dans la basse Égypte, et on les récolte
sèches en grande quantité; elles sont rougeâtres et fort petites. On les monde
quelquefois de leur écorce, en les broyant sous des meules à bras, afin de les rendre
plus délicates lorsqu'on les fait cuire.
On sème les pois chiches ( 5 ) dans des terres découvertes, ou à l'ombre des
dattiers, comme la plupart des plantes de jardin. On apporte au Kaire, des plaines
de Saqqàrah et de Birket el-Hâggy, des tiges fraîches de ces pois, pendant le mois
de mars. Les habitans mangent les fruits verts qui garnissent ces tiges.
Les pois chiches durcissent beaucoup en mûrissant ; on les mange secs après ia
récolte : ils deviennent friables étant grillés ou rôtis. On les fait quelquefois rôtir
après les avoir mis tremper un peu dans l'eau ; ils se boursouflent, et se fendent en
morceaux blancs et farineux.
Les lupins (6) sont ordinairement semés dans des terres sablonneuses ; leur culture
n'exige presque aucun soin, à l'exception des arrosemens, lorsque l'inondation
n'a pas été suffisante. Les tiges de lupins sont droites et presque ligneuses; elles
s'élèvent a douze et seize décimètres [quatre ou cinq pieds], et produisent dans
leurs deux tiers supérieurs des rameaux prolifères à feuilles alternes et digitées.
Les fleurs naissent en grappes aux divers points d'où partent par étages plusieurs
rameaux; elles sont blanches et un peu roses dans l'espèce de lupin la plus ordinaire,
et bleues dans une seconde espèce (7) qui est rare. Les gousses sont larges et
velues; elles renferment plusieurs graines comprimées, arrondies, et qui portent
à leur bord un petit ombilic en godet. On ne coupe point les tiges de lupins; on
(!) Diodor e (le Sicile,/«CD chato. (5) Cicer arininum LiNN. ; en a r abe , hommos. On
( i ) Koo^f «"«»•.«f, Dioicorid. lib. I I . cap. u^; nomme la plante dans les champs, ou cueillie f r a î che ,
mot à mot faba gr^ca, féve grecque. melàmh.
0) ¿"'""i/f/wLiNN. (6) Luftm.
(.j) Virgile é c r ivoi t, , lib. i , v. 2 î 8 : Unnis, mcmi
Kk Ptltiiiu-.t curam .isj-fnal>fe leatis. signifie lupin.
EiMartial,W. A'///, eplgramm. i, : _ (")
Accipi Nilùic.m Pelusiu i-i Forsk.
r Termis Fousk, ; dans la langue Ar a b e ,
i que celui de qui en grec
i ¡¡¡rsutus L i n n . , ou Lupinus d'i^'itacus