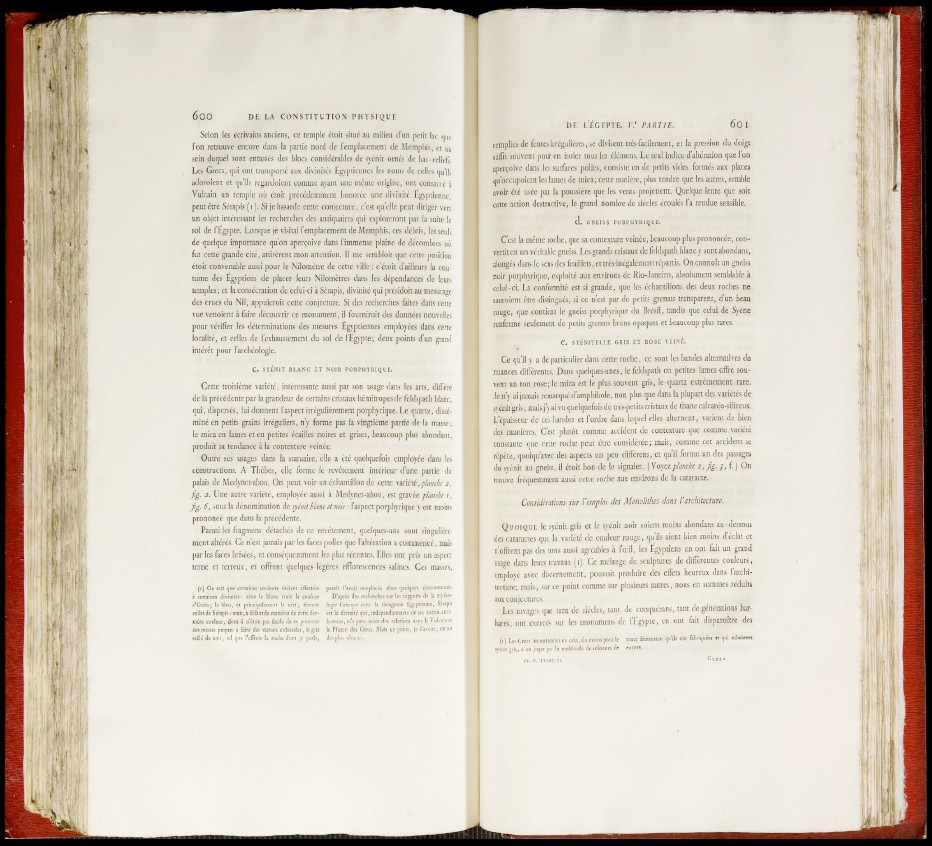
u:'
«A
i 'ìi^ìlif
.1
' h
íiiíí í'
mS'
600 DE LA C O N S T I T U T I O N I ' H Y S I Q U E
Selon les écrivains anciens, ce temple ctoit situé au milieu d'un petit lac (juc
l'on retrouve encore dans la partie nord de l'emplacement de Memphis , et au
sein duquel sont entasses des blocs considérables de syénit ornes de bas-reliefs
Les Grecs, qui ont transporté aux divinités Égyptiennes les noms de celles qu'ils
adoroient et qu'ils regardoient comme ayant tuie même origine, ont consacré à
Vulcain un temple où étoit précédemment honor ée une divinité Égyptienne,
peut-être Sérapis ( 1 ). Si je hasarde cette conjecture, c'est qu'elle peut diriger vers
un objet intéressant les recherches des antiquaires qui exploreront par la suite le
sol de l'Égypte. Lorsque je visitai l'emplacement de Memphis , ces débris, les seuls
de quelque importance qu'on aperçoive dans l'immense plaine de décombres où
fut cette grande cité, attirèrent mo n attention. Il me sembloit que cette position
étoit convenable aussi pour le Nilomètre de cette ville : c'étoit d'ailleurs la coutume
des Égyptiens de placer leurs Nilomètres dans les dépendances de leurs
temples; et la consécration de celui-ci à Sérapis, divinité qui présidoit au mesurage
des crues du Nil, appuieroit cette conjecture. Si des recherches faites dans cette
vue venoient à faire découvrir ce mo n ume n t , il fourniroit des données nouvelles
pour verifier les déterminations des mesures Égyptiennes employées dans cette
localité, et celles de l'exliaussement du sol de l'Égypte; deux points d'un grand
intérêt pour l'archéologie.
C. SYÉNl T B LANC ET NOfR P O R P H Y R I Q U E .
Cette troisième variété, intéressante aussi par son usage dans les arts, diffère
de la précédente par la grandeur de certains cristaux hémitropes de feldspath blanc,
qui, dispersés, lui donnent l'aspect irrégulièrement porphyrique. Le quartz, disséminé
en petits grains irréguliers, n'y forme pas la vingtième partie de la masse;
le mica en lames et en petites écailles noires et grises, beaucoup plus abondant,
produit sa tendance à la contexture veinée.
Outre ses usages dans la statuaire, elle a été quelquefois employée dans les
constructions. A Thèbe s , elle forme le revêtement intérieur d'une partie du
palais de Medynet-abou. On peut voir un échantillon de cette vmé t e ,p/anc/n-
Jig. 2. Un e autre variété, employée aussi à Medynet-abou, est gravée pLinche 1,
jig. 6, sous la dénomination de syémt blanc et noir : l'aspect porphyrique y est moins
prononcé que dans la précédente.
Parmi les fragmens détachés de ce revêtement, quelques-uns sont singulièrement
altérés. Ce n'est jamais par les faces polies que l'altération a commenc é , mais
par les faces brisées, et conséquemment les plus récentes. Elles ont pris un aspect
terne et terreux, et offrent quelques légères efïïorescences salines. Ce s masses,
(1) On sait que certaines couleurs étoient affectées
à cercainrs diviniiés: ainsi le blanc éioic la couleur
d'Osiris; le bleu, « principalement le vert, étoient
celles de Sérapis : mais, à défautde matières de cette dernière
couleur, donc il n'étoit pas facile de se procurer
des masses propres à faire des statues colossales, le gris
méic de noif, itl que l'offroit la roche dont je parle.
paroit l'avoir remplacée dans quelque
D'après des recherches sur les rapports de la mythologie
Grecque avec la théogonie Égyptienne, Sérapis
est la divinité qui, indépendamment de ses autres attributions,
m'a paru avoir des relations avec le Vulcain et
le Pluton des Grecs. Mais ce point, je l'avotie, est un
dk-s plus obscurs.
DE LÉGVPTE. V.' PARTIE. 6 0 1
remplies de fentes irrégulières, se divisent très-facilement, et la pression du doigt
suffit souvent pour en isoler tous les élémens. Le seul indice d'altération que l'on
aperçoive dans les surfaces polies, consiste en de petits vides formés aux places
qu'occupoient les lames de mica; cette matière, plus tendre que les autres, semble
avoir été usée par la poussière que les vents projettent. Quelque lente que soit
cette action destructive, le grand nombr e de siècles écoulés l'a rendue sensible.
c l . GNE I S S P O R l ' H Ï R I Q U E .
C'est la même roche, que sa contexture veinée, beaucoup plus prononc é e , convertit
en un véritable gneiss. Les grands cristaux de feldspath blanc y sont abondans,
alongés dans le sens des feuillets, et très-inégalementrépartis. On connoit un gneiss
noir porphyrique, exploité aux environs de Rio-Janeiro, absolument semblable à
celui-ci. La conformité est si grande, que les échantillons des deux roches ne
sauroient être distingués, si ce n'est par de petits grenats transparens, d'un beau
rouge, que contient le gneiss porphyrique du Brésil, tandis que celui de Syène
renferme seulement de petits grenats bruns opaques et beaucoup plus rares.
e . S Ï É N I T E I . L E GRIS ET ROSE VEINÉ.
Ce qu'il y a de pai'ticulier dans cette r o c h e , ce sont les bandes alternatives de
nuances différentes. Dans quelques-unes, le feldspath en petites lames of&e souvent
un ton rose; le mica est le plus souvent gris, le quartz extrêmement rare.
Je n'y ai jamais remarqué d'amphibole, non plus que dans la plupart des variétés de
syénit gris ; mais j'y ai vu quelquefois de très-petits cristaux de titane calcaréo-siliceux.
L'épaisseur de ces bandes et l'ordre dans lequel elles alternent, varient de bien
des manières. C'est plutôt comme accident de contexture que c omme variété
constante que cette roche peut être considérée; mais, c omme cet accident se
répète, quoiqu'avec des aspects un peu différens, et qu'il forme un des passages
du syénit au gneiss, il ctoit bon de le signaler. (Voyezplanche 2, jig.3, {. ) On
trouve f r équemment aussi cette roche aux environs de la cataracte.
Considérations sur l'emploi des Afonoliches dans l'architecture.
QUOIQUE le syénit gris et le syénit noir soient moins abondans au-dessous
des cataractes que la variété de couleur rouge , qu'ils aient bien moins d'éclat et
n'offrent pas des tons aussi agréables à l'oeil, les Ég)ptiens en ont fait un grand
usage dans leurs travaux (r). Ce mélange de sculptures de différentes couleurs,
employé avec discernement, pouvoit produire des effets heureux dans l'architecture;
mais, sur ce point c omme sur plusieurs autres, nous en sommes réduits
aux conjectures.
Les ravages que tant de siècles, tant de conquérans, tant de générations barbares,
ont exercés sur les monumens de l'Égypte, en ont fait disparoître des
(i) Lesiirecs les ont imitas en cela, du moins pour le
sjtnit gris, .1 en juger par la multitude de colonnes de
n . .V. TOMr. 11.
e dimension qu'ils ont fabriquées et qui s
1 ;!
I i
: il
M
M