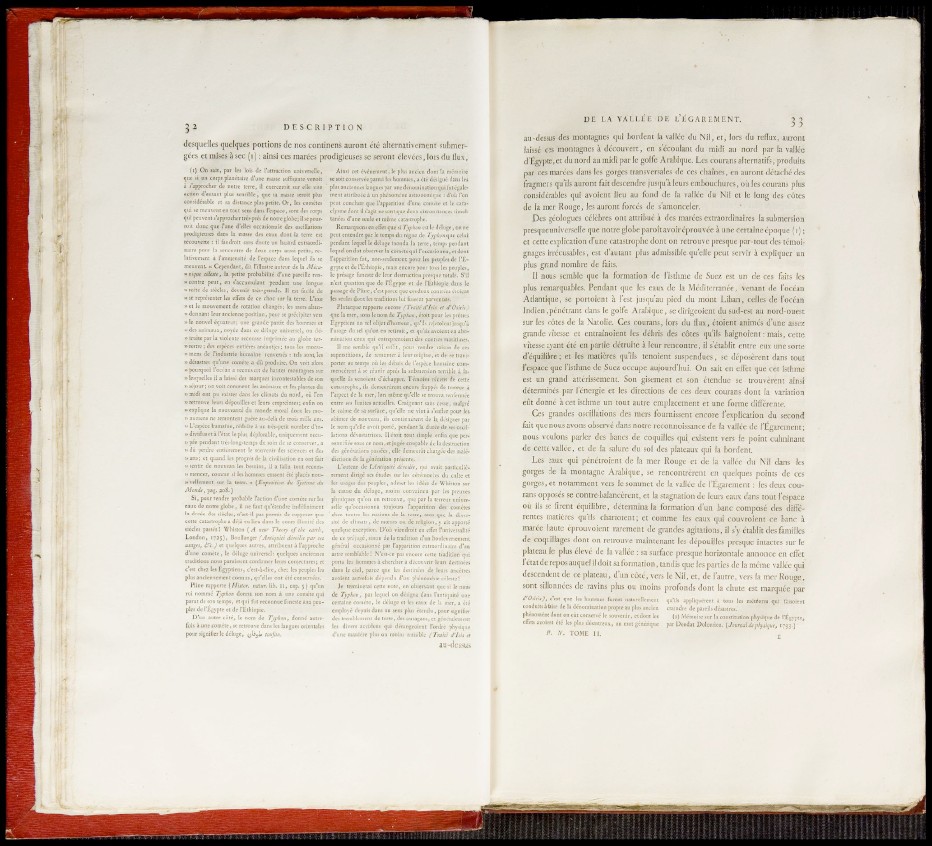
M
f i
'yi
r
3 2 D E S C R I P T I O N
desquelles quelques por t ions de nos continens auront été alternativement submergées
et mises à sec ( i ) : ainsi ces marées prodigieuses se seront élevées, lors du ilux
(I) On sait, par les lois <!e i'attraction universelle, A
que si un corps planétaire d'une masse suffisante venoit se so
à s'approcher de notre terre, il excrceroit sur elle une ' plus,
a n i o n d'autant plus sensible, que sa masse seroit plus mem
considérable et sa distance plus petite. O r , les comètes peut
qui se meuvent en tout sens dans l'espace, sont des corps clysi
qui peuvent s'approcher très-près de notre globe; il se pour- tanè,
roit donc que l'une d'elles occasionuât des oscillations
prodigieuses dans la masse des eaux dont la terre est
recouvene : il faudroii sans doute un hasard e i t r aordinaire
pour la rencontre de deux corps aussi petits, relativement
à runmensité de Tespace dans lequel ils se
meuvent. « Cependant , dit l'illustre auteur de la M k a -
^ nique céUste, la petite probabilité d'une pareille ren-
M contre p e u t , en s'accumulant pendant une longue
» s u i t e de siècles, devenir très-grande. Il est facile de
» s e représenter les effeu de ce choc sur la terre. L'axe
» e t le mouvement de rotation changés; les mers aban-
»> donnant leur ancienne position, pour se précipiter vers
« l e nouvel équateur; une grande pa.
M des a n ima u x , noyée dans ce déluge
e des hommes et
» truite par la violente secousse inipri
.niversel, ou déée
ï>restre; des espèces entières anéantie
au globe teriés
»mens de l'industrie humaine renvt
»désastres qu'une comète a dû prode
: tels sont, les
» p o u r q u o i l'océan a recouvert de hai
re. On voit alors
» lesquelles il a laissé des marques ine
montagnes sur
» s é j o u r ; on voit comment les animaux ntestables et les plantes de son
du
» midi ont pu exister dans les climats du n o r d , où l'on
»retrouve leurs dépouilles et leurs empreintes; enfin on
»explique la nouveauté du monde moral dont les mo -
» numens ne remontent guère au-delà de trois mille ans.
» L'espèce humaine, réduite à un très-petit nombre d' in-
» dividus et à l'état le plus, déplorable, uniquement occu-
« pée pendant très-long-temps du soin de se conserver, a
» d ii perdre entièrement le souvenir des sciences et des
» arts ; et quand 1« progrès de la civilisation en ont fait
»sentir de nouveau les besoins, il a fallu tout recom-
» mencer, comme si les hommes eussent été placés nou-
» v e i l eme nt sur la terre. » (Exposition du Système du
/Monde, pag. 208. )
Si, pour rendre probable l'action d'une comète sur les
eaux de notre globe , il ne faut qu'étendre indéfiniment
la durée des siècles, n'est-il pas permis de supposer que
cette catastrophe a déjà eu lieu dans le cours illimité des
siècles passés! Whiston { A ma' Theory of the earth,
London, 1725), BonlìàTìger CAini(juiié divoiL'e j-ar ses
usages, ¿7'c.) et quelques autres, attribuent à l'approche
d'une comète , le déluge universel: quelques anciennes
traditions nous paroissent confirmer leurs conjectures; et
c'est chez les Égj-ptiens, c'est-à-dire, c h e : les peuples les
plus anciennement c o n n u s , qu'elles ont été conservées.
Pline rapporte (Histor. naiur. iib. 11, cap. 5) qu'un
roi nommé Typhon donna son nom à une comète qui
parut de son temps, et qui fut reconnue funeste aux peuples
de l'Egypte et de l'Ethiopie.
D ' un autre côté, le nom de Typhon, donné autrefois
à u n e comè t e , se retrouve dans les langues
• signifier le déluge, y b j ^ toufan.
t événement, le plus ancien dont I.1
se soit conservée parmi k-s homme s , a été désigné dans le»
plusancieniies langues par unedénomina t ionqui lut également
.wribuée à un phénomène astronomifjue : d'où l'on
peut conclure que l'apparition d'ung comcie et le cataclysme
dont il s'agit ne sont que deux circonitancer simultanées
d'une seule et même catastrophe.
Remarquons en effet que si Typhon est le déluge, on ne
peut entendre par le temps du règne de T^/'Aonque celui
pendant lequel le déluge inonda la terre, temps pendant
lequel on dut observer la comète qui l'occasiouna, et dont
l'apparition f u i , non-seulemeni pour les peuples de l 'Egypte
et de l'Ethiopie, mais encore pour tous les peuples,
le présage funeste de leur destruction j)resque totale. S'il
n'est question que de l'Egypte et de l'Ethiopie dans le
passage de Pl ine , c'est parce que ces deux con trC es éioicnt
les seules dont les traditions lui fussent parvenues.
Plutarque rapporte encore (Tnùtc d'Isis et d'Osins '
^ue la me r , sous le nom de Typhon, étoit pour les prêtres
Egyptiens un tel objet d'horreur, qu'ils rejetoient jusqu'à
l'usage du sel qu'on en reiiroit, et qu'ils avoient en abomination
ceux qui entreprenoicnt des courses maritimes.
11 me semble qu'il suliit, pour rendre raison de ces
superstitions, de r emont e r a l euroi igine , et de se transporter
au temps où les débris de l'espèce humaine commencèrent
à se réunir après ia submersion terrible à laquelle
ils venoient d'échapper. Témoins récens de cette
catastrophe, ils demeurèrent encore frappés de terreyr a
l'aspect de la me r , lors même qu'elle se trouva renfermée
entre ses limites actuelles. Craignant sans cesse, malgré
le calme de sa surface, qu'elle ne vint s'enfler pour les
abîmer de nouve au, Ils continuèrent de la désigner par
le nom qu'elle avoit porté, pendant la durée de ses oscillations
dé\astatrices. Il étoit tout simple enfin que personnifiée
sous ce nom, et jugée coupable de la destruction
des générations passées, elle demeur.'it chargée des malédictions
de la génération présente.
L'auteur de VAntiquité dévoilée, qui a \ a i t particulièrement
dirigé ses éludes sur les cérémonies du culte et
les usages des peuples, admet les idées de Whision sur
la cause du déluge, moins convaincu par les preuves
physiques qu'on en retrouve, que par la terreur universelle
qu'occasionna toujours l'apparition des comètes
chez toutes k-s nations de la terre, sans que la diversité
de climats, de moeurs ou de religion, y ait apporté
quelque exception. D'où viendroit en effet l'universalité
de ce préjugé, sinon de la tradition d'un bouleversenjcnt.
général occasionné par l'apparition extraordinaire d'uti
por
• semblable '
a les homm
N'est-c pas. traditi
poui
rhercher à découvrir leurs destinées
dans le ciel, parce que les destinées de leurs ancêtres
avoient autrefois dépendu d'un phénomène céleste!
J e terminerai cette note, en observant que si le nom
de Typhon, pat lequel on désigna dans l'antiquité une
peu- certaine comè t e , le déluge et les eaux de la mer, a éié
employé depuis dans un sens plus étendu , pour signifier
utre- des trembk-mens de terre, des ouragans, et généialem^nt
taies les divers accidens qui dérangeoicnt l'ordre physique
d'une manière plus ou moins nuisible (Traité d'Jsis ei
au-(lcssu,s
DE LA VAL L E E DE L E C A R E M E N T . ^^
au-dessus des montagnes qui bordent ia vallée du Ni l , e t , lors du reflux, auroni
iaissc ces montagnes à d é c o u v e r t , en s'écoulant du midi au nord j>ar ia vallée
d'Ég>'pte,et du n o r d au midi par le golfe Arabique. Les courans alternatifs, produits
par ces marées dans les gorges transversales de ces chaînes, en auroni détaché des
fragmens qu'ils auront fait descendre jusqu'à leurs embouchur e s, où les courans plus
considérables qui avoient lieu au f on d de la vallée du Nil et le long des côtes
de la mer Rouge , les auront forcés de s'amonceler.
Des géologues célèbres ont attribué à des marées extraordinaires la submersion
presque universelle que notre globe paroît avoir éprouvée à une certaine époque (i) ;
et cette explication d'une catastrophe dont on retrouve presque ])ar-tout des témoignages
irrécusables, est d'autant plus admissible qu'elle peut servir à expliquer un
plus grand nombr e de faits.
Il nous semble que la formation de l'isthme de Suez est un de ces faits les
plus remarquables. Pendant que les eaux de la Médi t e r r ané e , venant de l'océan
Atlantique, se por toi ent à l'est jusqu'au pied du mo n t Li b a n , celles de l'océan
lndien,pénétrant dans le golfe Ar abique , se dirigeoient du sud-est au nord-oue s t
sur les côtes de la Natolie. Ces courans, lors du flux, étoient animés d'une assez
grande vitesse et entraînorent les débris des côtes qu'ils baignoient : mais, cette
vitesse ayant été en partie détruite à leur r encont r e , il s'établit entre eux une sorte
d'équilibre; et les matières qu'ils tenoient suspendue s , se dépos è r ent dans tout
J'espace que l'isthme de Suez oc cupe aujourd'hui. On sait en effet que cet isthme
est un grand attcrissement. Son gisement et son é t endue se t rouvè r ent ainsi
déterminés par l'énergie et les directions de ces deux courans dont la variation
eût d o n n é à cet isthme un tout autre empl a c ement et une f o rme différente.
Ces grandes oscillations des mers fournissent encor e l'explication du second
fait que nous avons observé dans notre reconnoissance de la vallée de l'Égarement ;
nous voulons parler des bancs de coquilles qui existent vers le point culminant
de cette vallée, et de la salure du sol des plateaux qui la bordent.
Les eaux qui pénét roient de la me r Rouge et de la \allée du Nil dans les
gorges de la mont agne Ar abique , se r encont r è r ent en quelques points de ces
gorges, et n o t ammen t vers le somme t de la vallée de l'Égarement : les deux courans
opposés se contre-balancèrent, et la stagnation de leurs eaux dans tout l'espace
où ils se firent équilibre, détermina la forma t ion d'un banc c omp o s é des différentes
matières qu'ils charioient; et c omme les eaux qui couvroi ent ce banc à
mai-ée haute éprouvorcnt r a r ement de grandes agitations, il s'y établit des familles
d e coquillages d o n t on retrouve maintenant les dépouilles presque intactes sur ie
plateau le plus élevé de la vallée : sa surface presque horizontale annonc e en effet
l'état de reposauquel il doit sa forma t ion, tandis que les parties de la même vallée qui
descendent de ce plateau, d'un côté, vers le Nil, et, de l'autre, vers la me r Ro u g e ,
sont sillonnées de ravins plus ou moins jH-ofonds d o n t la chute est marquée par
d'Osi,
•J, c'est que les homm
condì
à fail
phénomèn
elfecs avoli
été les plus désastre
A'. T OME I I .
, et dont le
)t génériqu,
qu'ils appliquèrent
craindre de pareils
( i ) A k W r e sur
parDeodat Doloir
I les météores qui faisoien
itution physique de l'Egypte
ournal de physique, 1793.)
E