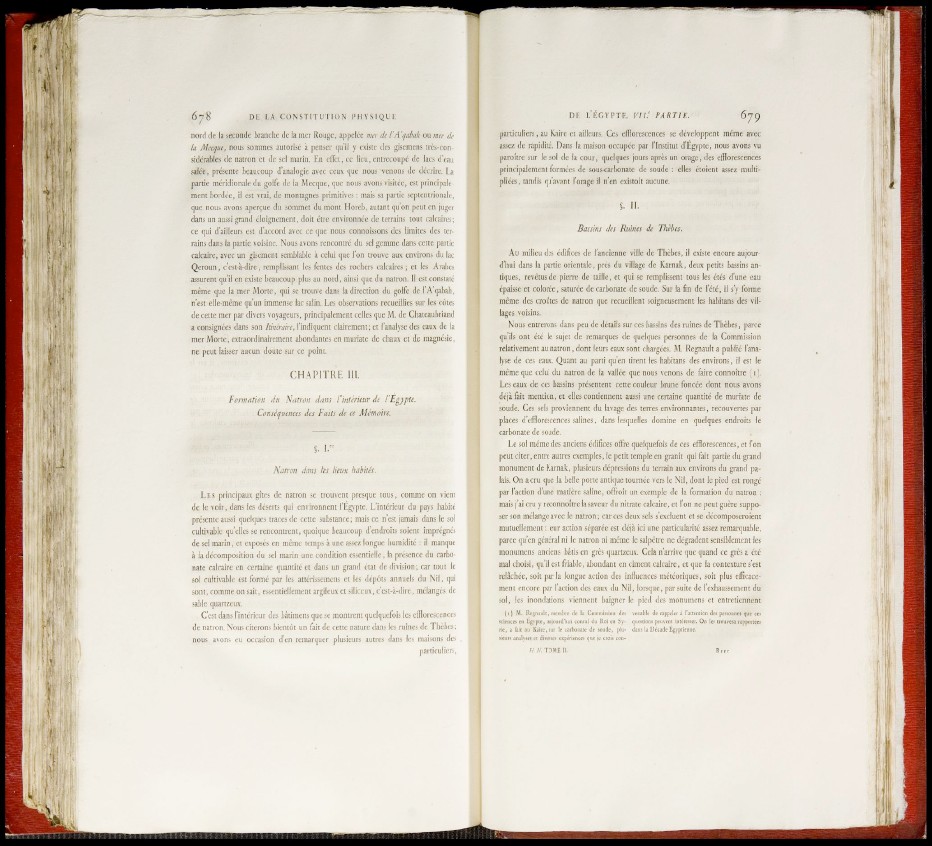
IP
(I Í
678 D l i I .A C O N S T I T U T I O N P H Y S I Q U L
nord de la seconde branche de la mer Rouge, appelée mer de i'A 'tfubuh ou mev de
lu Mecque, nous sommes autorisé à penser cju'il y existe des giscmcus trcs-con
sidcrables de natron et de sel marin. En ef fet , ce lieu, entrecoupé tie lacs d'eau
salée, présente beaucoup d'analogie avec ceux que nous venons de décrire. La
partie méridionale du gol fe de la Me cque , que nous avons visitée, est principale
ment bordée, il est vrai, de montagnes primitives : mais sa partie septentrionale,
que nous avons aperçue du sommet du mont Hor eb, autant qu'on peut en juger
dans un aussi grand éloignement , doit être environnée de terrains tout calcaires;
ce qui d'ailleurs est d'accord avec ce que nous connoissons des limites des terrains
dans la partie voisine. Nous avons rencontre du sel gemme dans cette partie
calcaire, avec un gisement semblable à celui que l'on trouve aux environs du lac
Qeroun, c'est-à-dire, remplissant les fentes des rochers calcaires ; et les AraJ)es
assurent qu'il en existe beaucoup plus au nord, ainsi que du natron. Il est constaté
même que la mer Mo r t e , qui se trouve dans la direction du golfe de l'A'qabah,
n'est elle-même qu'un immense lac salin. Le s observations recueillies sur les côtes
de cette mer par divers voyageurs, principalement celles que M. de Chateaubriand
a consignées <lans son Itinéraire, l'indiquent clairement; et l'analyse des eaux de la
mer Mor t e , extraordinairement abondantes en muriate de chaux et de magnésie,
ne peut laisser aucun doute sur ce point.
C H . \ P I T R E ( I I .
Formation du Natron dans l'intérieur de l'Egypte.
Conséquences des Faits de ce Mémoire.
§. I . "
Natron dans ks lieux habités.
LES principaux gîtes de natron se trouvent presque tous , comme on vient
de le voi r , dans les déserts qui envi ronnent l 'Égjpte. L'intérieur du pays habité
présente aussi quelques traces de cette substance; mais ce n'est jamais dans le sol
cultivable qu'elles se rencont rent , quoique beaucoup d'endroits soient imprégnés
de sel marin, et exposés en même temps à une assez longue humidité : il manque
à la décomposi t ion du sel marin une condi t ion essentielle, la présence du carbonate
calcaire en certaine quantité et dans un grand état de division; car tout le
sol cultivable est formé par les attcrissemens et les dépôts annuels du Ni l , qui
sont, c omme on sait, essentiellement argileux et siliceux, c'est-à-dire, mélangés de
sable quartzeux.
C'est dans l'intcricur des bàtimens que se mont rent quehjuefois les eillorescences
de natron. Nous citerons bientôt un fait de cette nature dans les ruines de Thèbc s ;
nous avons eu occasion d'en remarquer plusieurs autres dans les maisons tîes
particuliers,
DE L É G Y P T I i . VII.' PARTIE. ^79
particuliers, au Kaire et ailleurs. Ces eiTlorescences se développent même avec
assez de raj)iclité. Dans la maison occupée par l'Institut d'Egypte, nous avons vu
paroître sur le sol de la cour , quelques jours après un orage, des efflorescences
principalement formées de sous-carbonate de soude : elles étoient assez multipliées,
tandis qu'avant l'orage il n'en existoit aucune.
Bassins des Ruines de Thèbes.
A u milieu des édifices de l'ancienne ville de Thèbes , il existe encore aujourd'hui
dans la partie orientale, près du village de Karnak, deux petits bassins antiques,
revêtus de pierre de taille, et qui se remplissent tous les étés d'une eau
épaisse et colorée, saturée de carbonate de soude. Sur la fin de l'été, il s'y forme
même des croûtes de natron que recueillent soigneusement les habitans des villages
voisins.
Nous entrerons dans peu de détails sur ces bassins des ruines de Thè b e s , parce
qu'ils ont été le sujet de remarques de quelques personnes de la Commi s s ion
relativement au natron, dont leurs eaux sont chargées. M. Regnault a publié l'analyse
de ces eaux. Quant au parti qu'en tirent les habitans des environs, il est le
même que celui du natron de la vallée que nous venons de faire connoî tre ( i ).
Les eaux de ces bassins présentent cette couleur brune foncée dont nous avons
déjà fait ment ion, et elles contiennent aussi une certaine quantité de muriate de
soude, Ces sels proviennent du lavage des terres environnantes, recouvertes par
places d'efÏÏorescences salines, dans lesquelles domine en quelques endroits le
carbonate de soude.
L e sol même des anciens édifices offre quelquefois de ces efflorescences, et l'on
peut citer, entre autres exemples, le petit temple en granit qui fait partie du grand
monument de Karnak, plusieurs dépressions du terrain aux environs du grand palais.
O n a cru que la belle porte antique tournée vers le Ni l , dont le pied est rongé
par l'action d'une matière saline, offroit un exemple de la format ion du natron :
mais j'ai cru y reconnoitre la saveur du nitrate calcaire, et Ton ne peut guère supposer
son mélange avec le natron ; car ces deux sels s'excluent et se dccomposerorent
mutuellement : leur action séparée est déjà ici une particularité assez remarquable,
parce qu'en général ni le natron ni même le salpêtre ne dégradent sensiblement les
monumens anciens bâtis en grès quartzeux. Ce la n'arrive que quand ce grès a été
mal choisi, qu'il est friable, abondant en ciment calcaire, et que la contexture s'est
relâchée, soit par la longue action des influences météoriques, soit plus efficacement
encore par l'action des eaux du Ni l , Iors(|ue, par suite de l'exhaussement du
sol, les inondations viennent baigner le pied des monumens et entretiennent
{1) M. Regnault, membre de la Commission des venabic de rappclei
sciences en Egypte, aujourd'hui consul du Roi en Sy- questions peu\
•ie, a fait au Kaire, sur le carbonate de soude, plu- dans la Décade Égypti
lieur? analyses et diverses expériences que ¡e crois con-
//. A'. TOME If.
ition des personnes que ces
On les trouvera rapportées
il