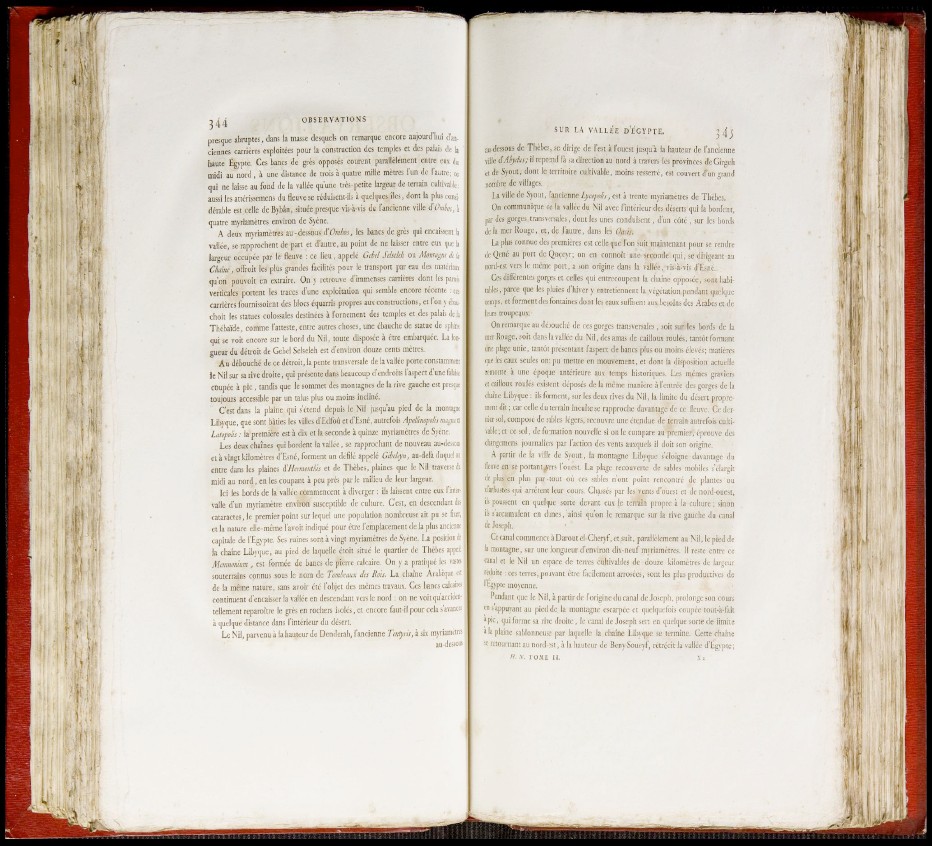
I l '
t
' i!
^ ^ ^ O B S E R V A T I O N S
presque a b r u p t e s , dans la masse desquels on r ema r q u e e n c o r e aujourd'kui d V
ciennes carrières exploicces p o u r !a cons t ruc t ion des t empl e s et des palais de la
haute Egypte. Ce s bancs de grès oppos é s c o u r e n t parallèlement ent r e eux du
midi au n o r d , à u n e distance de trois à quatre mille mèt re s l'un de l'auire; ce
qui ne laisse au f o n d de la vallée qu'une t r è s -pe t i t e largeur de terrain cultivalJe:
aussi les atterissemens du fleuve se rcduisent-ils à quelques îles, d o n t la plus considé
r abl e est celle de Bybàn. située presque vis-à-vis de l'ancienne ville i
quatre myr i amè t r e s e n v i r o n de Syène.
A deux myr i amè t r e s a u - d e s s o u s ^Omb o s , les bancs de grès qui encaissent la
vallée, se r a p p r o c h e n t de part et d' aut r e , au p o i n t de ne laisser ent r e eux que la
lai-geur o c c u p é e par le fleuve : ce lieu , appe l é Gcbel Seisdch ou M on'ague de k
Cluûrie, of f roi t les plus grandes facilités p o u r le t r anspor t par eau des matcriaux
qu'on p o u v o i r en extraire. On y r e t rouve d' immens e s carrières d o n t les parois
verticales p o r t e n t les traces d'une exploitation qui semble e n c o r e r é c ent e ; ces
carrières fourni s soi ent des blocs équarris p r o p r e s aux cons t ruc t ions , et l'on y cbauchoit
les statues colossales destinées à l ' o r n eme n t des temples et des palais de la
T h é b a ï d e , c omme l'atteste, ent r e autres chos e s , u n e ébauche de statue de sphinx
qui se voit e n c o r e sur le bord du Ni l , t o u t e di spos ée à être embarquée . La longueur
du d é t r o i t de Gebe l Selseieh est d' envi ro n d o u z e cents mètres.
A u d é b o u c h é de ce dé t roi t , la p e n t e transversale de la vallée por t e constamment
h Ni ! sur sa rive d r o i t e , qui pr é s ent e dans be aucoup d' endroi t s l'aspect d'une falaise
coupée à pic , tandis que le s omme t des mo n t a g n e s de la rive gauche est presque
toujours accessible par un talus plus ou mo i n s incliné.
C'est dans la plaine qui s'étend depui s le Nil jusqu'au pi ed de la montagne
Libyque, que sont bâties les villes d 'Ed f o ù et d'Esné , autrefois Apollhwpolis maguv. \
Latopolis : la p r emi è r e est à dix et la s e conde à quinze myr i amè t r e s de Syène.
Les deux chaînes qui b o r d e n t la vallée, se r a p p r o c h a n t de n o u v e a u au-dessoui
e t à vingt ki lomè t r e s d 'Es n é , f o rme n t un défilé appe l é CibeUyn, au-delà duquel on ;
entre dans les plaines ^Hermonthis et de T h è b e s , plaines que le Nil traverse du '
midi au n o r d , en les c o u p a n t à p e u près par le milieu de leur largeur.
Ici les bords de la vallée c omme n c e n t à dive rge r : ils laissent e n t r e eux l'intervalle
d ' u n my r i amè t r e envi ron susceptible de culture. C' e s t , en descendant des i
cataractes, le p r emi e r p o i n t sur lequel une p o p u l a t i o n n omb r e u s e ait pu se fixer,
e t la na tur e e l l e -même l'avoit indiqué p o u r être l ' empl a c ement de la plus ancienne
capitale de l'Égypte. Ses ruines sont à vingt myr i amè t r e s de Syène. La position de
la chaîne Li b y q u e , au pi ed de laquelle é toi t situé le quartier de Th è b e s appi-li
Memnonïum , est f o rmé e de bancs de pi e r r e calcaire. On y a pratiqué les vasie»
souterrains c o n n u s sous le n om de Tombeaux des Rois. La chaîne Arabique est
d e la même n a t u r e , sans avoir été l'objet des même s travaux. Ce s bancs calcaires
continuent d'encaisser la vallée en de s c endan t vers le nord : on ne voit qu'accidentellement
r epa roî t r c le grès en roche r s isolés , et e n c o r e faut-il p o u r cela s'avancer
à quelque distance dans l'intérieur du désert.
Le Ni l , pa rvenu à la haut eur de De n d e r a h , l'ancienne Tenîyris, à six myriamctio
au-desjou>
SUR LA VALLI ÎE D' JÉCYPTE.
3 4 i
a u - d e s s o u s de Th è b e s , se dirige de l'est à l'ouest jusqu'à la haut eur de l ' anc i enne
ville iiiAbydns; il r epr end là sa di rect ion au n o r d à travers les provinces de Gi rge h
et de Syout , d o n t le territoire cultivable, mo i n s resserré, est couve r t d'un gr and
nombre de villages.
La ville de Syout , l'ancienne Lycopolis, est à t r ent e myriamètres de Th è b e s .
On c ommu n i q u e de la vallée du Nil ave c l'intérieur des déserts qui la bordent ,
par des gorges transversales, d o n t les unes c o n d u i s e n t , d'un c ô t é , sur les bords
de la mer Ro u g e , e t , de l'autre, dans les Oasis.
La plus c o n n u e des pr emi è r e s est celle que l'on suit ma i n t e n a n t p o u r se r endr e
de Qené au p o r t de Qo ç e y r ; on en c o n n o î t u n e s e c o n d e q u i , se dirigeant au
nord-est vers le même p o r t , a son or igine dans la vallée, vis-à-vis d'Esné.
Ces différentes gorges et celles qui e n t r e c o u p e n t la chaîne oj jpos é e , sont habitables,
parce que les pluies d'hiver y ent r e t i ennen t la végétation j)eiidanc quelque
temps, et f o rme n t des font a ine s d o n t les eaux suffisent aux besoins des Arabes et de
leurs troupeaux.
On r ema rque au d é b o u c h é <[e ces gorges transversales, soit sur les bords de la
mer Rouge, soit dans la vallée du Ni l , des amas de cailloux roul é s , t antôt f o rma n t
une plage u n i e , t antôt pr é s ent ant l'aspect de bancs plus ou mo i n s élevés; matières
que les eaux seules o n t pu me t t r e en mo u v eme n t , et d o n t la disposition actuelle
remonte à u n e é p o q u e ant é r i eur e aux t emps historiques. Le s même s graviers
et cailloux roulés existent déposés de la même mani è r e à l'entrée des gorges de la
chaîne Libyque ; ils f o rme n t , sur les deux rives du Ni l , la limite du désert propr e -
ment dit ; car celle du terrain inculte se r a p p r o c h e davantage de ce fleuve. Ce dernier
sol, c omp o s e de sables légers, r e couvr e u n e é t e n d u e de terrain autrefois cultivable
; et ce s o l , de f o r j n a t i o n nouvel le si on le c omp a r e au p r emi e r , é p r o u v e des
changcmens journaliers par l'action des vents auxquels il doit son origine.
A partir de la ville de S y o u t , la mo n t a g n e Libyque s'éloigne davantage du
fleuve en se p o r t a n t ^ e r s l'ouest. La plage r e couve r t e de sables mobiles s'élargit
de plus en plus p a r - t o u t où ces sables n ' o n t p o i n t r e n c o n t r é de plantes ou
d'arbustes qui a r r ê t ent leur coin's. Chassés par les vents d'ouest et de nor d- oue s t ,
ils poussent en quelque sorte devant eux le terrain p r o p r e à la culture ; s inon
ils s'accumulent en d u n e s , ainsi qu'on le r ema rqu e sur la rive gauche du canal
de Joseph.
Ce canal c omme n c e àDa r o u t e l -Che ryf , et suit, parallèlement au Ni l , le pied de
la mont agne, sur u n e longueur d' envi ron dix-neuf myriamètres. II reste ent r e ce
canal et le Ni l un espace de terres cultivables de douz e ki lomè t r e s de largeur
réduite : ces terres, p o u v a n t être f a c i l ement arrosées, sont les plus produc t ive s de
l'Ég\pte moyenne .
Pendant que le Ni l , à partir de l'origine du canal de J o s e p h , p r o l o n g e son cours
en sappuyant au pied de la mo n t a g n e escarpée et quelquefois c o u p é e tout-à-fait
^pic, qui f o rme sa rive d r o i t e , le canal de J o s e p h sert en quelque sorte de limite
a la plaine sablonneuse par laquelle la chaîne Libyque se t e rmine . Ce t t e chaîne
se retournant au nord- e s t , à la haut eur de Beny-Soueyf, rétrécit la vallée d'Egypt e ;
//. /V. TOME II, Xï
!' • i
N U