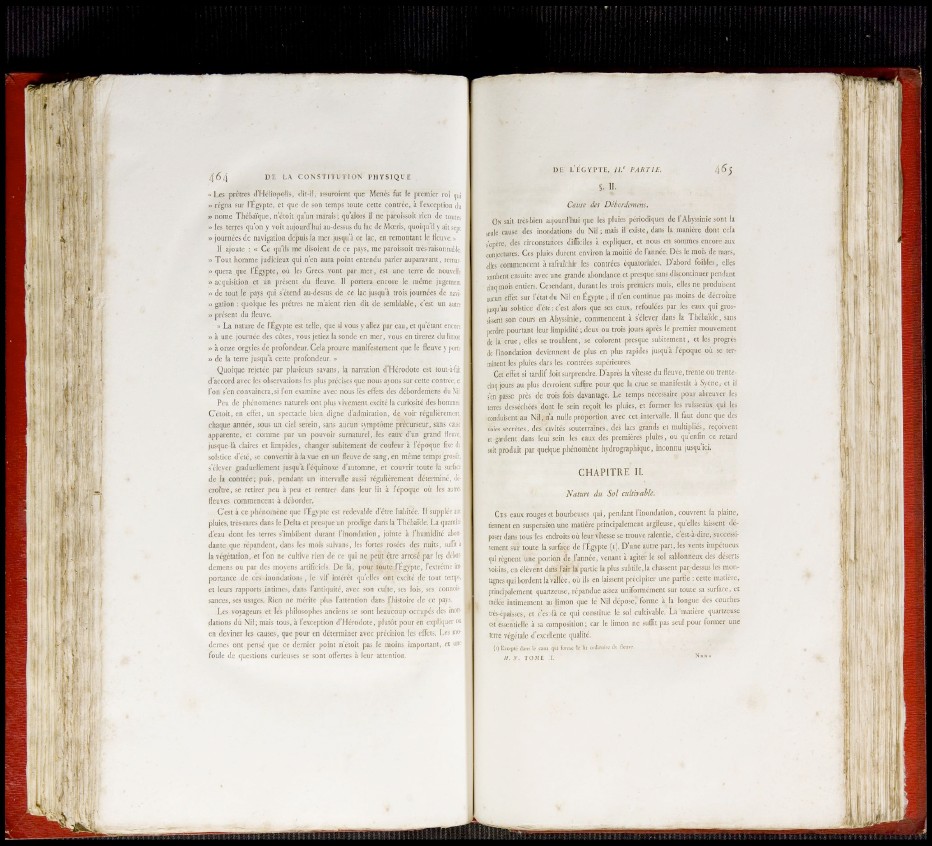
- ' f í
• F
® '- I!.:
4 6 4 DE LA C O N S T I T U T I O N P H Y S I Q U E
« Les prêtres d'HéliopoÜs, dit-il, assuroient que Menés fïit le premier roi cjui
5> régna sur l'Égypte, et que de son temps toute cette contrée, à l'exception du
3> nome Tliébaïque, n'étoit qu'un marais; qu'alors il ne paroissoit rien de toutes
» les terres qu'on y voit aujourd'hui au-dessus du lac de Moeris, quoiqu'il y ait sept
5> journées de navigation depuis la mer jusqu'à ce lac, en remontant le lîeuvc, »
Il ajoute : « Ce qu'ils me disoient de ce pays, me paroissoit très-raisonnable.
» Tout homme judicieux qui n'en aura point entendu parler auparavant, reiuar-
» quera que l'Egypte, où les Grecs vont par me r , est une terre de nouvelle
» ac<|uisition et un présent du fleuve. Il portera encore le même jugement
» de tout le pays qui s'étend au-dessus de ce lac jusqu'à trois journées de iia\i-
» gation : quoiqite les prêtres ne m'aient rien dit de sembiabie, c'est un autre
» présent du fleuve.
» La nature de l'Egypte est telle, que si vous y allez par eau, et qu'étant encore
n à une journée des côtes, vous jetiez la sonde en mer , vous en tirerez du limon
» à onze orgyies de profondeur. Cela prouve manifesteinent que le fleuve y porte
» de la teiTe jusqu'à cette profondeur. »
Quoique rejetée par plusieitrs savans, la narration d'Hérodote est tout-à-fait
d'accord avec les observations les plus précises que nous ayons sur cette contréc;et
l'on s'en convaincra, si l'on examine avec nous les effets des dcbordemens du Nil,
Peu de phénomènes naturels ont plus vivement excite la curiosité des homrae>.
Cc toi t , en effet, un spectacle bien digne d'admiration, de voir régulièrement,
chaque année, sous un ciel serein, sans aucun symptôme précurseur, sans cause
apparente, et comme ]>ar un pouvoir surnaturel, les eaux d'un grand flcu\c.
jusque-là claires et limpides, changer subitement de couleur à l'époque fixe du
solstice d'été, se convertir à la vue en un fleuve de sang, en même temps grossir,
s'élever graduellement jusqu'à l'equinoxe d'automne, et couvrir toute la surface
de la cont rée; puis, pendant un intervalle aussi régulièrement déterminé, décroître,
se retirer peu à peu et rentrer dans leur lit à l'époc^ue où les autres
fleuves commencent à déborder.
C'est à ce phénomène que l'Égypte est redevable d'être habitée. Il supplée aux
pluies, très-rares dans le Delta et presque un prodige dans la Thébaïde. La quantité
d'eau dont les terres s'imbibent durant l'inondation, jointe à l'humidité abon
dante que répandent, dans les mois suivans, les fortes rosées des nuits, sullit à 1
la végétation, et l'on ne cultive rien de ce qui ne peut être arrosé par le? débor
demens ou par des moyens artificiels. De là, pour toute l'Egypte, l'extrême importajice
de ces inondations , le vif intérêt qu'elles ont excité de tout tcinp\
et leurs rapports intimes, dans l'antiquité, avec son culte, ses lois, ses coiinoi>-
sances, ses usages. Rien ne mérite j)lus l'attention dans l'histoire tie ce jiays.
Les voyageurs et les philosoj)hes anciens se sont beaucoup occupés des inondations
du Nil; mais tous, à l'exception d'Hérodote, ])lutüt pour en exi>liquer ou
en deviner les causes, que pour en déterminer avec précision les efl"ets. Les modernes
ont pensé que ce dernier point n'étoit pas le moins important, et uiic
foule de questions curieuses se sont ofl^ertes à leur attention.
DE L ' ÉGYP T E . JI.' PARTIE.
I I .
Cause des Déboriiemens.
4 ^ 5
ON sait très-bien aujourd'hui qut: les pluies pcrrodi([ues de i'Abyssinie sont la
^eule cause des inondations du Nil ; lîtais il existe, dans la manière dont cela
s'opère, des circonstances difliciies à expii([uer, et nous en sommes encore aux
conjectures. Ces pluies durent environ la moitié de l'année. Dès le mois de mars,
elles commencent à rafraîchir les contrées cquatoriales. D'abord foibles, elles
lombent ensuite avec une grande abondance et presque sans discoEitinuer pendant
cin(] mois entiers. Cependant, durant les trois premiers mois, elles ne produisent
aucun effet sur l'état du Nil en Égypte ; il n'en continue pas moins de décroître
jusqu'au solstice d'été : c'est alors que ses eaux, refoulées par les eaux qui grossissent
son cours en Abyssinie, commencent à s'élever dans la Thébaïde, sans
perdre pourtant leur limpidité ; deux ou trois jours après le premier mouvement
de la crue, elles se troublent, se colorent presque subitement, et les progrès
Je l'inondation deviennent de plus en plus rapides jusqu'à l'époque où se terminent
les pluies dans les contrées supérieures.
Cet effet si tardif doit surprendre. D'après la vîtesse du fleuve, trente ou trentecinq
jours au plus devroient suffire pour que la crue se manifest-ùt à Syène,- et il
s'en passe près de trois fois davantage. Le temps nécessaire pour abreuver les
terres desséchées dont le sein reçoit les pluies, et former les ruisseaux qui les
conduisent au Nil, n'a nulle proportion avec cet intervalle. Il faut donc que des
voies secrètes, des cavités souterraines, des lacs grands et multipliés, reçoivent
et gardent dans leur sein les eaux des premières pluies, ou qu'enfin ce retard
soit produit par quelque phénomène hydrographique, inconnu jusqu'ici.
C H A P I T R E I I .
Nature du Sol cultivable.
CES eaux rouges et bourbeuses qui. pendant l'inondation, couvrent la plaine,
tiennent en suspension une matière principalement argileuse, qu'elles laissent déposer
dans tous les endroits où leur vîtesse se trouve ralentie, c'est-à-dire, successivement
sur toute la surface de l'Égypte (t). D'tuie autre part, les vents impétueux
ijui régnent une portion de l'année, venant à agiter le sol sablonneux des déserts
voisins, en élèvent dans l'air la partie la plus subtile,la chassent par-dessus les montagnes
qui bordent la vallée, où ils en laissent précipiter tme partie ; cette matière,
principalement quartzeuse, répandue assez uniformément sur toute sa surface, et
mêlée intimement au limon que le Nil dépose, forme à la longue des couches
très-épaisses, et c'est-là ce qui constitue le sol cultivable. La matière quartzeuse
est essentielle à sa composition ; car le limon ne suffn pas seul pour former une
terre végétale d'excellente ([ualité.
(i) Escepri Jans le canai qui forint le Ut orJin.lire du lîeuvc.
U. N. TO.ME II.
J - FE