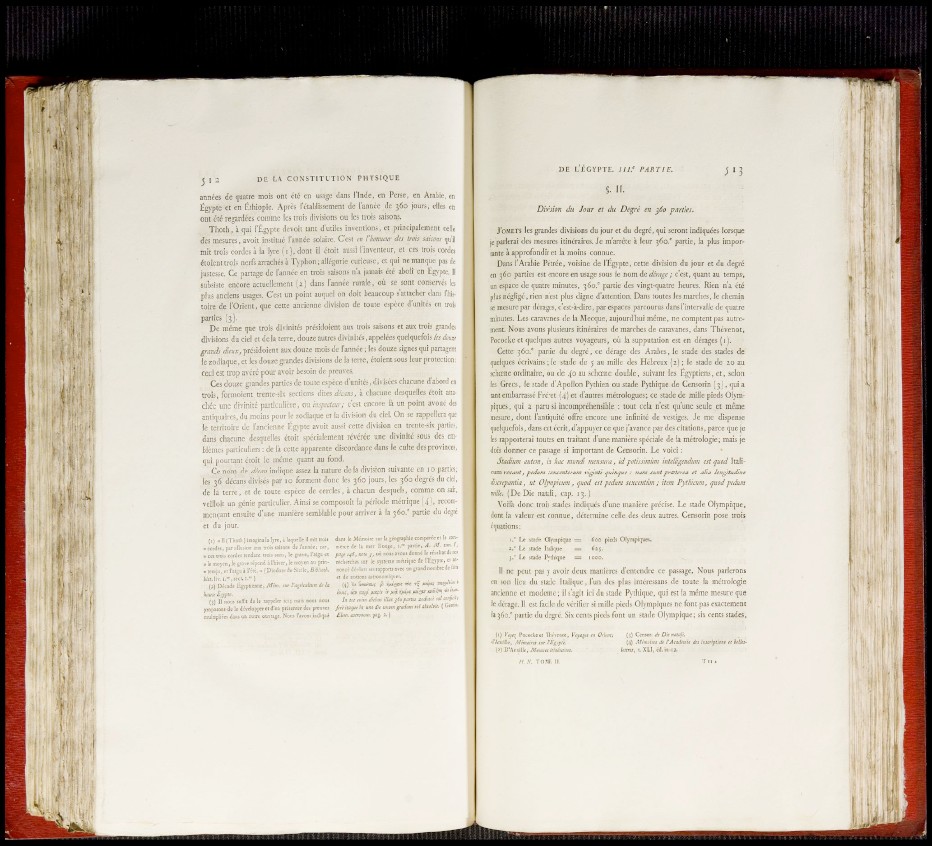
r í ; '
ïfïC!
m '•"i!.i i
5 ' - D E LA C O N S T I T U T I O N P H Y S I Q U E
années de quatre mois ont été en usage clans l'Inde, en Perse, en Arabie, en
Egypte et en Ethiopie. Après 1 ctablissement de l'année de 360 jours, elles en
ont été regardées comme les trois divisions ou les trois saisons.
Thoth, à qui l'Egypte devoit tant d'utiles inventions, et principalement celle
des mesures, avoit institué l'année solaire. C'est en l'honneur des trois saisons qu'il
mit trois cordes à la lyre ( i ), dont il ctoit aussi l'inventeur, et ces trois cordes
étoient trois nerfs arrachés à Typhon ; allégorie curieuse, et qui ne manque pas de
justesse. Ce partage de l'année en trois saisons n'a jamais été aboli en Egypte, Il
subsiste encore actuellement (2) dans l'année rurale, où se sont conservés les
plus anciens usages. C'est un point auquel on doit beaucoup s'attacher dans l'histoire
de l'Orient, que cette ancienne division de toute espèce d'unités en trois
parties (3).
De même que trois divinités présidoient aux trois saisons et aux trois grandes
divisions du ciel et de la terre, douze autres divinités, appelées quelquefois les douzt
grands dieux, présidoient aux douze mois de l'année ; les douze signes qui partagent
le zodiaque, et les douze grandes divisions de la terre, étoient sous leur protection:
ceci est trop avéré pour avoir besoin de preuves.
Ces douze grandes parties de toute espèce d'unités, divisées chacune d'abord en
trois, fonnoient trente-six sections dites décatis, à chacune desquelles ctoit attachée
une divinité particulière, ou inspecteur; c'est encore là un point avoué des
antiquaires, du moins pour le zodiaque et la division du ciel. On se rappellera que
le territoire de l'ancienne Egypte avoit aussi cctte division en trente-six parties,
dans chacune desquelles ctoit spécialement révérée une divinité sous des emblèmes
particuliers : de là cette apparente discordance dans le culte des provinces,
qui pourtant étoit le même quant au fond.
Ce nom de dccan indique assez la nature de la division suivante en 1 o parties;
les 36 décans divisés par 10 forment donc les 360 jours, les 360 degrés du ciel,
de la terre, et de toute espèce de cercles, à chacun desquels, comme on sair,
veilioit un génie particulier. Ainsi se composoit la période métrique (4), recommençant
ensuite d'une manière semblable pour arriver à la 360.' partie du degré
et du jour.
{:) « Il (Thoth ) imagina la lyre, à laquelle il mit trois
«cordes, par nllusion aux trois saisons de Tannée; car,
» ces trois cordes rendant trois sons, ie grave, l'aigu et
» le moyen, le grave répond à l'hiver, le moyen au prin-
» temps, et i'aiguà l'itu. >> (Diodore de Siàk, Biblioïk.
i w f . l i v . l . " , s e c r . i . " )
(i) Décade Égyptienne, Mém. sur l'agriculture de la
havtt Egypte.
(3) 11 nous suffit de le rappeler ici; mais nous nous
proposons de ¡e développer et d'en présenter des preuves
multipliées dans un autre ouvrage. Nous l'avons indiqué
dans le Mémoire sur la géographie comparée ei le commerce
de la mer Kouge, i . " partie, Â. AI. lom. I,
page i^S, iwK j , où nous avons donné le résultat de nos
recherches sur ie systeme métrique de l'Egypte, et annoncé
dès-lors ses rapports avec i:n grand nombre de fait»
et de notions astronomiques.
(4) 'E. jS ¿^'esc/f wV T?' A"'?« m&à i ^ •
¿lit « (MX i/jif^ fu'&r wraAt)
In tot entm diebus ¡lias j6o partes zodiaci sol confie"!
firi itaque ¡n uno die unum gradum sol ahoMt. { Gemin,
Eltm. astnnom. pag. 2. )
DE L EGYPTE. ¡¡I.' PARTIE. j 13
S- II.
Division du Jour et du Degré en ^60 parties.
J'omets les grandes divisions du jour et du degré, qui seront indiquées lorsque
je parlerai des mesures itinéraires. Je m'arrête à leur 360.' partie, la plus importante
à approfondir et la moins connue.
Dans l'Arabie Pétrée, voisine de l'Égyptc, cette division du jour et du degré
en 360 parties est encore en usage sous le nom de dérage ; c'est, quant au temps-,
un espace de quatre minutes, 360.® partie des vingt-quatre heures. Rien n'a été
plus négligé, rien n'est plus digne d'attention. Dans toutes les marches, le chemin
se mesure par dérages, c'est-à-dire, par espaces parcourus dans l'intervalle de quatre
minutes. Les caravanes de la Mecque, aujourd'hui même, ne comptent pas autrement.
Nous avons plusieurs itinéraires de marches de caravanes, dans Thévenoi,
Pococke et quelques autres voyageurs, où la supputation est en dérages ( 1}.
Cette 360.' partie du degré, ce dérage des Aralies, le stade des stades de
quelques écrivains ; le stade de 5 au mille des Hébreux {2) ; le stade de ao au
sclicene ordinaire, ou de 4o au schcene double, suivant les Égyptiens, e t , selon
les Grecs, le stade d'Apollon Pychien ou stade Pythique de Censorin ( 3 ), qui a
tant embarrassé Fréret (4) et d'autres métrologues; ce stade de mille pieds Olympiques,
qui a paru si incompréhensible : tout cela n'est qu'une seule et même
mesure, dont l'antiquité offre encore une infinité de vestiges. Je me dispense
{¡uelquefois, dans cet écrit, d'appuyer ce que j'avance par des citations, parce que je
les rapporterai toutes en traitant d'une manière spéciale de la métrologie; mais je
dois donner ce passage si important de Censorin. Le voici :
Stadium autem, in iuu mundi mensura, id potissimiim intelligendum est (juod Italicum
vocant, pedum sexcentorum viginti-quinque : n<vn sunt prcet ere a et alui longitudme
itscrepantia, ut Olympicum , qtiod est pedum sexcentûm ; item Pythicum, qiiod pedum
mile. (De Die natali, cap. 13.)
Voilà donc trois stades indiqués d'une manière précise. Le stade Olympique,
dont la valeur est connue, détermine celle des deux autres. Censorin pose trois
équations :
1." Le sind» Olympique =
2.° Le stade Itaîique =
3.° I.e stade Pythique = 1000.
600 pieds Olympiques.
Il ne peut pas y avoir deux manières d'entendre ce passage. Nous parlerons
en son lieu du stade Italique, l'un des plus intéressans de toute la métrologie
ancienne et moderne ; il s'agit ici du stade P} ihique, qui est la même mesure que
le dcrage. Il est facile de vérifier si mille pieds Olympiques ne font pas exactement
la 360.' partie du degré. Six cents pieds font un stade Olympique; six cents stades,
(1) Voyei Pococke 6t Th.\'cnot, Voyages ri
il'Anvillf, Mémoires sur l'Ég^i-pre.
(2) D'An ville, AJesures iiiiiéruires.
I!. A'. TO.MK 11.
(3) Censor, de Die ntitali.
(4) AJrmcires de l'Académie des iiiscripliens ei btllei-
/ « f r « , t, XLl , cd. in- I2.
i • Il
i l !