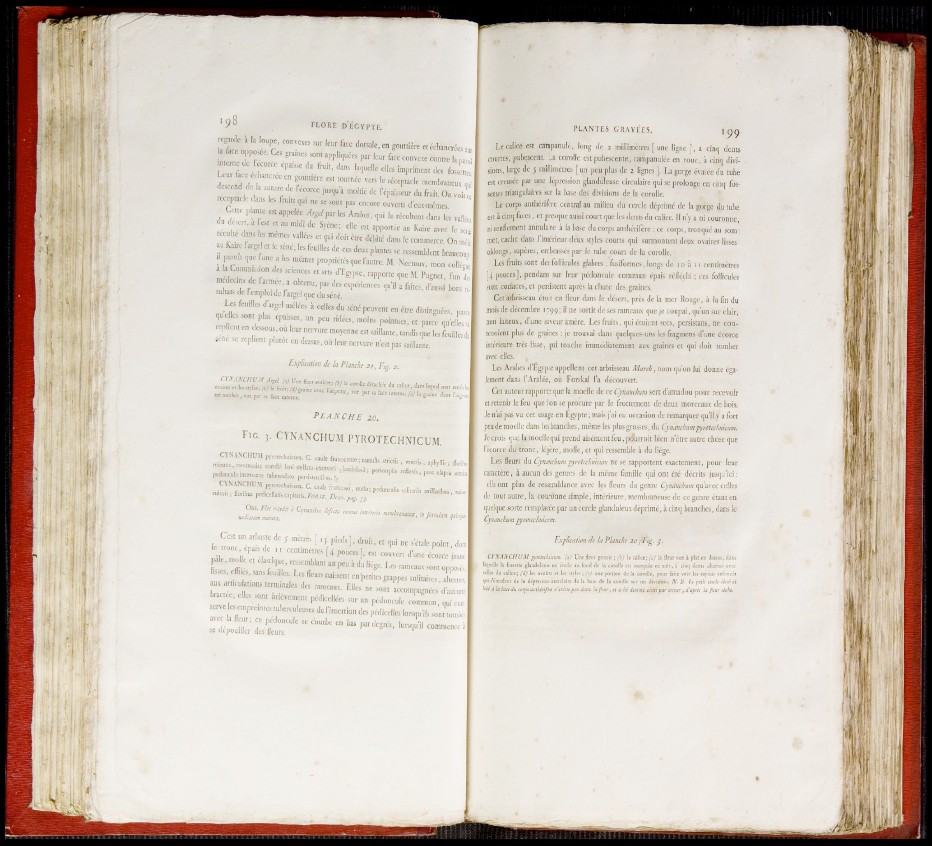
41
f i l •
1 9 8 F L O R E D ' É G Y P T E .
egnrJe a la loupe, convexe, sur leu,- face dorsale, en gouttière et¿chancrées s»,
la race opposée. Ces graines sont appliquées par leur facc convexe contre pw
mterne de lecorce épaisse du fruit, dan. laquelle elles inrprin,cn. des fo sï ,
d r . „ r d " , ^^^ " - . „ t r a n c J
é e ta le 1 T " ' f " " " " " " f™" ' O " voit
rcceptatle dans les fru.ts qu, ne se son. pas encore ouverts deux.nêtnes.
Cette plante est appelée A r g d par les Arabes, qui la récoltent dans les vaili,-
du desert, a est et au midi de Syène; elle est apportée au Kaire avec le ^
récolté dans les „rentes vallées et qui doit être tléUté dans le co.nmerce. On
au Kat t . 1 arge et le séné; les feuilles de ces deux plantes se ressen,blcnt beauco, !
.1 parott que une a les tnêmes propriétés que l'autre. M. Nectoux, nron co 2
a a Cotttmtsston des sciences et arts d t g j p t e , rapporte que H, Pugnet,
ssuu tttaat ss dd e Ii teml pr lToi 'd,e ' i argcl <jue du séné ^ ^ o »
Les feuilles dargel nrèlées à celles du séné peuvent en être distinguées parc,
,U elles sont plus épaisses, un peu ridées, moins pointues, et parce qu" ife
repltent en dessous, où leur nervure moyenne est saillante, tandis ue les feuill J
>cne se rephcnt ph.tôt en dessus, où leur nervure nc s tpa s saillatite.
Explication Jt k PLimhc 20, Fig. 2.
CYKAKCHUM Argd. (a) U„, ,
o.a.rc, „ 1„ „,.]„ ; f,, le [„¡,. f j ) ,
est lombcc, vue par sa face eïlerne.
Hère; (h) la corolle dèiacbie du calice, dans lequel sont rc
= )'«SreTe, ,ue par sa face ¡„rernci (,) la grame don, r.'^',;
PLANCHE 20.
FIG. 3. C YNANCHUM P YROTECHNI CUM.
pPe dl ulnc'uilo éincrrars sai;o l,u berculato persistentil.us. 5 pericrp' iis ', ¥ lapsa, ,
CYN.WCHU.N! p,r„„ch„icum. C. caule f , r „ i „ „ , „„d»; „„
euiosBi floribui pedicdladi capimij. Dm,. ¡¡. "xUlanbus , lulei-
C'est t,n arluste de 5 tnitres [ piet l s ] , droit, et qui ne s'étale point don.
le tronc cpats de t , centimètres [4 pouces ] , est cot!vert d'une écoTc
pa e, ,no e et elas.tque, ressemUant un peu à tlu liège. Les rameaux sont 0 , 1 .
Itsses, effiles sans feu,Iles. Les fleurs nai.-sent en 'petites grappes solitaires a ternc<
trac ce elles sont tnevement pédicellées sur un pédoncule c omt u n , qui co.-
P L A N T E S G R . W É E S . >99
Le calice est campanulé, long de 2 millimètres [ une l i g n e ] , a cinq dents
courtes, pubescent. La corolle est pubescente, campanulée en roue, à cinq divisions,
large de J tuillimètres [un peu plus de 2 lignes ]. La gorge évasée du tube
est creusée par une dépression glanduleuse circulaire qui se prolonge en cinq fossettes
triangulaires sur la base des divisions de la corolle.
Le corps anthérifère central au milieu du cercle déprime de la gorge du tube
est à cincj laces, et presque aussi court que les dents du calice. Il n'y a ni couronne,
ni renflement annulaire à la base du corps anthérifère : ce corps, tronqué au som
met, cache dans l'intérieur deux styles courts (|ui surmontent deux ovaires lisses
oMongs, supères, embrassés par le tube court de la corolle.
Les fruits sont des follicules glabres, fusiformes, longs de lo à r i centimètres
[4 pouces], pendans sur leur pédoncule commun épais réfléclii ; ces follicules
sont coriaces, et persistent aj)rès la chute des graines.
Cet arbrisseau ctoit en Heur dans le désert, près de la mer Rouge, à la fin du
mois de décembre f 799 ; il ne sortit de ses rameaux que je coupai, qu'un suc clair,
non laiteux, d'une saveur amère. Les fruits, qui étoient secs, persistans, ne contenolent
plus de graines : je trouvai dans quelques-uns les fragmens d'une écorce
intérieure très-lisse, qui touche immédiateinent aux graines et qui doit tomber
avec elles.
Les Arabes d'Egypte appellent cet arbrisseau Mardi, nom qu'on lui donne également
dans l 'Arabie, où ForskaI l'a découvert.
Cet auteur rapporte que la moelle de ce Cynanchum sert d'amadou pour recevoir
et retenir le feu que l'on se procure par le frottement de deux morceaux de bois.
Je n'ai pas vu cet usage en Egypte ; mais j'ai eu occasion de remarquer qu'il y a fort
peu de moelle dans les branches, même les plus grosses, du Cynanchumpyrotechnicum.
Je crois que la moelle qui prend aisément f eu, pdurroit bien n'être autre chose que
l'écorce du tronc, légère, mol le, et qui ressemble à du liège.
Les fleurs du Cynuuchumpyrotcc/micum ne se rapportent exactement, pour leur
caractère, à aucun des genres de la même famille qui ont été décrits jusqu'ici :
élis ont plus de ressemblance avec les lîeurs du genre Cyrmnc/mm qu'avec celles
de tout autre, la couronne simple, intérieure, membraneuse de ce genre étant en
quelque iorte remplacée par un cercle glanduleux déprimé, à cinq branches, dans le
Cynanchum fyroi echnicum.
Explication de ta Planche 20, Fig.
CYNANCHUM pyrotechnkum. (a) Une fle.ir grossie ; (hj le calice; (c) la fleur vue à piat en dessus, d.ins
f.iquelle la fossette glanduleuse en étoile au fond de la corolle est marquée en noir, à cinq dents aliernes avec
celles du calice; (d) les ovaires et les styles; (e) une portion de la corolle, pour faire voir les rayons entoncéj
qui s'étendent de la dépression annulaire «le la base de la corolle sur ses divisions. N. B. Le peut cercle élevé et
lobé à Id base du corps anthériftre n'existe pas dans lajieur, et a été dessiné ainsi par erreur , d'après l.i Jieur sèche.