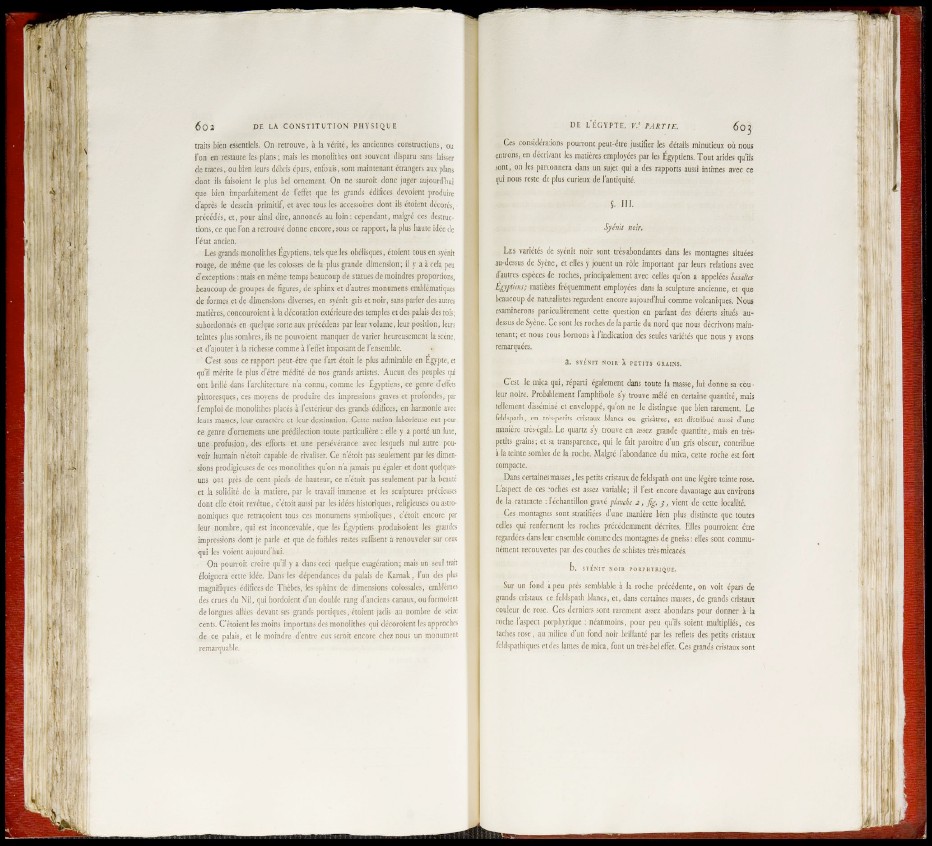
.- h
6 o 3 DE LA C O N S T I T U T I O N P H Y S I Q U E
traits Lien essentiels. On ret rouve, à ia vérité, les anciennes constructions, ou
i on en restaure les plans ; mais les monoliilies ont souvent disparu sans laisser
île traces, ou bien leurs débris cpars, enfouis, sont maintenant étrangers aux plans
dont ils faisoient ie plus bel ornement. On ne sauroit donc juger aujourd'hui
que bien imparfaitement de l'effet que les grands édifices devoient ]>roduire
d'après le dessein primitif, et avec tous les accessoires dont ils étoient décorés,
précédés , et, pour ainsi dire, annoncés au loin : cependant , malgré ces destructions,
ce que l'on a retrouvé donne encore, sous ce rappor t , la plus haute idée de
l'état ancien.
L e s grands monolithes Égyptiens, tels que les obélisques, étoient tous en sycnit
rouge, de même que les colosses de la plus grande dimens ion; il y a à cela peu
d'exceptions : mais en même temps beaucoup de statues de moindres proportions,
beaucoup de groupes de figures, de sphinx et d'autres monumens emblématiques
de formes et de dimensions diverses, en syénit gris et noi r , sans parler des autres
matières, concouroient à la décoration extérieure des temples et des palais des rois;
subordonnés en quelque sorte aux précédens par leur volume, leur position, leurs
teintes plus sombres , ils ne pouvoient manquer de varier heureusement la scène,
et d'ajouter à la richesse c omme à l'effet imposant de l'ensemble.
C'est sous ce rappor t peut-être que l'art étoit le plus admirable en Égypte, et
qu'il mérite le plus d'être médi té de nos grands artistes. Aucun des peuples qui
ont brillé dans l'architecture n'a connu, comme les Égj'ptiens, ce genre d'effets
pi t toresques , ces moyens de produire des impressions graves et profondes , par
l'emploi de monolithes placés à l'extérieur des grands édifices, en harmonie avec
leurs masses, leur caractère et leur destination. Ce t t e nation laborieuse eut pour
ce genre d'ornemens une prédilection toute particulière : elle y a porté un luxe,
une pro fus ion. des efforts et une persévérance avec lesquels nul autre pouvoir
humain n'étoit capable de rivaliser. C e n'étoit pas seulement par les dimensions
prodigieuses de ces monolithes qu'on n'a jamais pu égaler et dont quelquesuns
ont près de cent pieds de hauteur, ce n'étoit pas seulement par la beauté
et la solidité de la matière, par le travail immense et les sculptures précieuses
dont elle étoit revêtue, c'étoit aussi par les idées historiques, religieuses ou astronomiques
que retraçoient tous ces monumens symboliques, c'étoit encore par
leur nombre , qui est inconcevable, que les Ég\'ptiens produisoient les grandes
impressions dont je parle et que de foibles restes suffisent à renouveler sur ceux
qui les voient aujourd'hui.
On pourroit croire qu'il y a dans ceci quelque exagération; mais un seul trait
éloignera cette idée. Dans les dépendances du palais de Ka rnak, l'un des plus
magnifiques édifices de Thèbe s , les sphinx de dimensions colossales, emblèmes
des crues du Ni l , qui bordoient d'un double rang d'anciens canaux, ou formoient
de longues alfées devant ses grands port iques , étoient jadis au nombre de seize
cents. C'étoient les moins importans des monolithes qui décoroient les approches
de ce palais, et le moindre d'entre eux serort encore chez nous un monument
remarquable.
DE L ' ÉGY P T E . V.' PARTIE. 60 3
Ces considérations pourront peut-être justifier les détails minutieux où nous
entrons, en décrivant les matières employées par les Égyptiens. T o u t arides qu'ils
sont , on les pardonnera dans un sujet qui a des rapports aussi intimes avec ce
qui nous reste de plus curieux de l'antiquité.
§. ì l i .
Syénit noir.
LES variétés de syénit noir sont très-abondantes dans les montagnes situées
au-dessus de Syène, et elles y jouent un rôle important par leurs relations avec
d'autres espèces de roches, principalement avec celles qu'on a appelées ùasa/tes
Egyptiais; matières f réquemment employées dans la sculpture ancienne, et que
beaucoup de naturalistes regardent encore aujourd'hui c omme volcaniques. Nous
examinerons particulièrement cette question en parlant des déserts situés audessus
de Syène. C e sont les roches de la partie du nord que nous décrivons maintenant;
et nous nous bornons à l'indication des seules variétés que nous y avons
remarquées.
a . SYÉNI T NOIR À P E T I T S GRAINS .
C'est le mica qui , réparti également dans toute la masse, lui donne sa couleur
noire. Probablement l'amphibole s'y trouve mêlé en certaine quantité, mais
tellement disséminé et enveloppé, qu'on ne le distingue que bien rarement. L e
feldspath, en très-petits cristaux blancs ou grisâtres, est distribué aussi d'une
manière très-égale. L e quartz s'y trouve en assez grande quantité, mais en trèspetits
grains; et sa transparence, qui le fait paroître d'un gris obscur, contribue
à la teinte sombre de la roche. Malgré l'abondance du mica, cette roche est fort
compacte.
Dans certaines mas ses , les petits cristaux de feldspath ont une légère teinte rose.
L'aspect de ces roches est assez variable; il l'est encore davantage aux environs
de la cataracte : l'échantillon gravé planche 2, fig. ^, vient de cette localité.
Ces montagnes sont stratifiées d'une manière bien plus distincte que toutes
celles qui renferment les roches précédemment décrites. Elles pourroient être
regardées dans leur ensemble c omme des montagnes de gneiss : elles sont communément
recouvertes par des couches de schistes très-micacés.
b . S y É N J T N O I R P O R P H Y R I Q U E .
Sur un fond à peu près semblable à la roche précédente, on voit épars de
grands cristaux de feldspath blancs, et , dans certaines masses, de grands cristaux
couleur de rose. Ce s derniers sont rarement assez abondans pour donner à la
roche l'aspect porphyrique : néanmoins , pour peu qu'ils soient multipliés, ces
taches r o s e , au milieu d'un fond noir brillanté par les reflets des petits cristaux
foldspathiques et des lames de mica, font un très-bel effet. Ce s grands cristaux sont
i i. ^ ! '