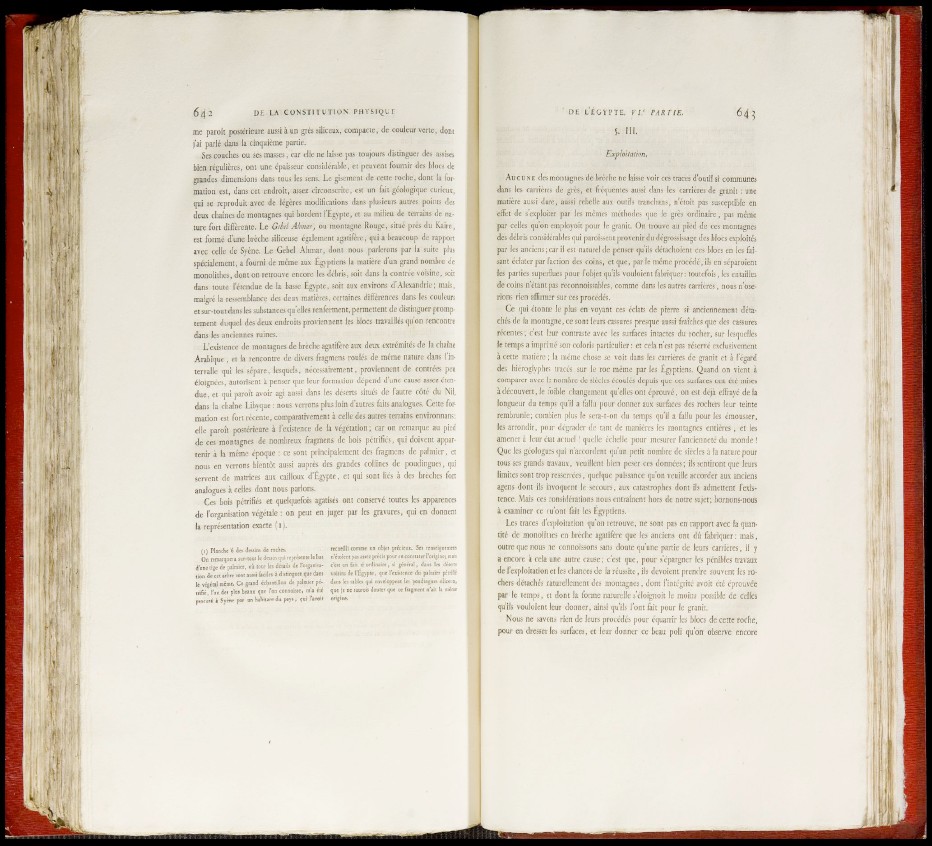
'li
6 4 2 DE LA C O N S T I T U T I O N P H Y S I Q U E
me pa roî t postérieure aussi à un grès siliceux, c omp a c t e , de couleur verte, doni
j'ai parié dans la c inqui ème partie.
Ses couches ou ses masses, car elle ne laisse pas toujour s distinguer des assises
bien régulières, o n t une épaisseur considérable, et peuvent fourni l des blocs de
grandes dimens ions dans tous les sens. Le gisement de cette r o c h e , d o n t la formation
est, dans cet e n d r o i t , assez circonscrite , est un fait géologique curieux,
qui se r eprodui t avec de légères modilications dans plusieurs autres points des
deux chaînes de mont agne s qui b o r d e nt l'Egypte, et au milieu de terrains de nature
for t différente. Le Almiar, ou mo n t a g n e Ro u g e , situé près du Kaire,
est f o rmé d'une brèche siliceuse également agatifère, qui a be aucoup de rapport
avec celle de Syène. Le Gebel Ahma r , d o n t nous parlerons par la suite plus
spécialement, a f o u r n i de même aux Ég\pt i en s la ma t iè re d'un grand n omb r e de
monolithes, d o n t on r e t rouve encor e les débris, soit dans la c ont r é e voi s ine, soit
dans tout e l'étendue de la basse Egypt e , soit aux envi rons d'Al e xa ndr i e ; mais,
malgré la ressemblance des deux matières, certaines différences dans les couleurs
et sur - tout dans les substances qu'elles r e n f e rme n t , p e rme t t e n t de distinguer promplement
duquel des deux endroi ts p r o v i e n n e n t les blocs travaillés qu'on rencontre
dans les anc i enne s ruines.
L'existence de mont a gne s de brèche agatifère aux deux extrémités de la chaîne
Arabique , et la r e n c o n t r e de divers f r agmens roulés de même na tur e dans l'intervalle
qui les s épa r e , lesquels, n é c e s s a i r eme n t , provi ennent de contrées peu
éloignées, autorisent à penser que leur forma t ion d é p e n d d'une cause assez étendue
, et qui paroît avoir agi aussi dans les déserts situés de l'autre côté du Nil,
dans la chaîne Libyque : nous ve r rons plus loin d'autres faits analogues. Ce t t e formation
est for t r é c ent e , compa r a t ivement à celle des autres terrains environnans :
elle paroît postérieure à l'existence de la végétation ; car on r ema r q ue au pied
de ces mo n t a g n e s de n omb r e u x f r agmens de bois pétrifiés, qui doivent appartenir
à la même é p o q u e : ce sont pr inc ipa l ement des f r agmens de p a lmi e r , et
nous en ve r rons bi entôt aussi auprès des grandes collines de p o u d i n g u e s , qui
servent de matrices aux cailloux d'Ég>pt e , et qui sont liés à des brèches fort
analogues à celles d o n t nous parlons.
Ces bois pétrifiés et quelquefois agatisés o n t conservé tout es les apparences
d e l'organisation végétale : on peut en juger par les gravures, qui en donnent
la r epr é s ent a t ion exacte ( i ).
(i) Planche 6 des dessins de roches. recueilli comme un objet précieux. Ses rerseignemtns
On remarquera sur-toui le dessin qui représente le bas n'étoient pas assez précis pour en constater l'origine; mats
d'une lige de palmier, où tous les détails de l'organisa- c'est un fait si ordinaire, si gener.il, dans les déserts
tion de cet arbre sont aussi faciles à distinguer que dans voisins de l'Egypte, que l'existence du palmier pétrifié
le végétal même. Ce grand échantillon de palmier pé- dans les sables qui enveloppent les poudingues siliceux,
trifié, l'un des plus beaux que l'on connoisse, m'a été que je ne saurois douter que ce fragment n'ait ia même
procu'ré à Syène par un habitant du pays, qui l'aroit origine.
m
D E L E G V P T E . K / . ' PARTIE.
%. I I I .
Exploiiation.
6 4 5
AUCUNE des mont agne s de brèche ne laisse voir ces traces d'outil si c ommu n e s
dans les carrières de grès, et fréquentes aussi dans les carrières de granit : u n e
matière aussi d u r e , aussi rebelle aux outils tranchans , n'étoit pas susceptible en
effet de s'exploiter par les même s mé thode s que le grès ordinaire , pas même
par celles qu'on employoi t p o u r le granit. On t rouve au pied de ces mont agne s
des débris considérables qui paroissent proveni r du dégrossissage des blocs exploités
par les anciens ; car il est naturel de penser qu'ils détachoient ces blocs en les faisant
éclater par l'action des coins, et que, par le même p r o c é d é , ils en séparoient
les parties superflues p o u r l'objet qu'ils vouloi ent fabriquer : tout e foi s , les eniailles
de coins n'étant pas reconnoissables, c omme dans les autres carrières, nous n'oserions
rien affirmer sur ces procédés.
Ce qui é tonne le plus en voyant ces éclats de pierre si a n c i e n n eme n t détachés
de la mo n t a g n e , ce sont leurs cassures presque attssi fraîches que des cassures
récentes; c e s t leur contraste avec les surfaces intactes du r o c h e r , sur lesquelles
le t emps a impr ime son coloris particulier : et cela n'est pas réservé exclusivement
à cette matière ; la même chose se voit dans les carrières de granit et à l'égard
des hiéi-oglyphes tracés sur le roc même par les Égyptiens. Qu a n d on vient à
comparer avec le n omb r e de siècles écoulés depuis que ces surfaces ont été mises
à d é c o u v e r t , le foible changemen t qu'elles ont é p r o u v é , on est déjà effraye de la
longueur du temps qu'il a fallu p o u r d o n n e r aux surfaces des rochei-s leur teinte
rembrunie; combi en plus le sera-t-on du t emps qu'il a fallu p o u r les émous s e r ,
les a r rondi r , p o u r dégrader de tant de manières les mont agne s entières , et les
amener à leur état actuel ! quelle échelle p o u r mesurer l'ancienneté du mo n d e !
Que les géologues qui n' a c cordent qu'un petit n omb r e de siècles à la na tur e p o u r
tous ses grands travaux, veuillent bien peser ces d o n n é e s ; ils sentiront que leurs
limites sont t r o p resserrées, quelque puissance qu'on veuille a c corde r aux anciens
agens d o n t ils invoquent le secours , aux catastrophes d o n t ils adme t t ent l'existence.
Mais ces considérations nous ent r a înent hors de not r e sujet; bornons -nous
à examiner ce qu'ont fait les Égyptiens,
Les traces d'exploitation qu'on r e t rouve , ne sont pas en r a p p o r t avec la quantité
de monol i the s en brèche agatifère que les anciens ont du f abr ique r : ma i s ,
outre que nous ne connoissons sans d o u t e qu'une partie de leurs carrières, il y
a encor e à cela une autre c aus e ; c'est que , p o u r s'épargner les pénibles travaux
de l'exploitation et les chances de la réussite, ils devoi ent pr endr e souvent les rochers
détachés naturellement des mo n t a g n e s , dont l'intégrité avoit été é p r o u v é e
par le t emp s , et d o n t la f o rme naturelle s'cloignoit le moins possible de celles
qu'ils vouloi ent leur d o n n e r , ainsi qu'ils l'ont fait p o u r le granit.
Nous ne savons rien de leurs proc édé s p o u r équarrir les blocs de cette r oc he ,
pour en dresser les surfaces, et leur d o n n e r ce beau poli qu'on observe encor e
if
lllr
il
mm