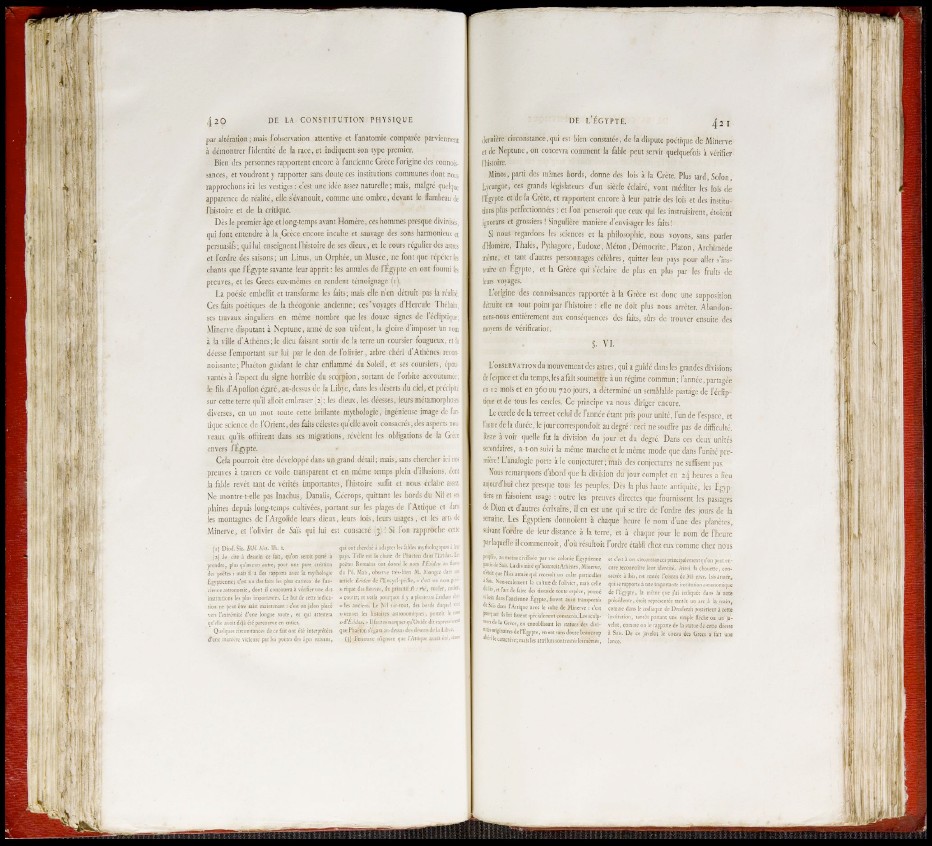
i
Î
^ 2 0 DE LA C O N S T I T U T I O N P H Y S I Q U E
par al térat ion ; mai s l 'obs e r v a t ion a t t ent i v e et l ' ana tomi e c omp a r é e parviennent
à d émo n t r e r l ' ident i té de la r a c e , et ind i q u ent son t ype pr emi e r .
Bien de s pe r s onne s r a p p o r t en t e n c o r e à l ' anc i enne Gr è c e l 'or igine des connoissances,
et v o u d r o n t y r a p p o r t e r sans d o u t e c e s ins t i tut ions c ommu n e s dont nous
rapprochons ici les ves t ige s : c'est une idé e assez na tur e l l e ; ma i s , ma l g r é quelque
apparence de r é a l i t é , el le s ' é v a n o u i t , c omme une omb r e , d e v a n t le flambeau de
l'histoire et de la c r i t ique.
D è s le p r emi e r â g e et l o n g - t emp s a v ant H o m è r e , ces h omme s pr e sque divinisés,
qui f o n t e n t e n d r e à la ,Gr è c e e n c o r e incul t e et s auv a g e de s sons ha rmoni eux et
persuasifs ; qui lui ens e i gnent l 'hi s toi re de ses di eux , et le cour s r é gul i e r des astres
e t l 'ordr e des s a i s ons ; un L i n u s , un O r p h é e , un Mu s é e , ne f o n t que répéter les
chants que l 'Eg y p t e savant e leur appr i t : les annal e s de l 'Ég) pce en o n t fourni les
preuves, et les Gr e c s e u x -même s en r e n d e n t t émo i g n a g e ( i ) .
L a p o é s i e embe l l i t et t r ans f o rme les fai ts; mai s el le n' en dét rui t pas la réalité.
Ces faits p o é t i q u e s de la t h é o g o n i e a n c i e n n e ; c e s ' v o y a g e s d 'He r c u l e Tlicbain,
ses t ravaux s ingul ier s en même n omb r e que les d o u z e s ignes de récliptiijue,
M i n e r v e di sput ant à N e p t u n e , a rmé de son t r i d e n t , la g l o i r e d' i jnpo s e r Un nom
à la vi l le d ' A t h è n e s ; le di eu faisant sor t i r de la ter re un cour s i e r f o u g u e u x , et la
déesse l ' emp o r t a n t sur lui par le d o n de l ' o l i v i e r , arbre ché r i d ' A t h è n e s reoonnoissante;
P h a é t o n guidant le cha r e n f l ammé du S o l e i l , et ses c our s i e r s , é])ouvantés
à l 'aspec t du s igne hor r ibl e du s c o r p i o n , sor t ant de l 'orbi te accoutumée;
le fils d ' A p o l l o n é g a r é , au-des sus de la L i b y e , dans les déser t s du c i e l , et précipitii
sur c e t t e t e r r e qu'il al loi t embr a s e r (2) ; les d i e u x , les dé e s s e s , leurs mctamorpl ion^
diverses, en un mo t t o u t e c e t t e br i l lante my t h o l o g i e , ing éni eus e ima g e de l'antique
s c i enc e de l 'Or i e n t , de s fai ts céles tes qu'el le a v o i t c o n s a c r é s , de s aspects nouveaux
qu'ils o f f r i r ent dans ses mi g r a t i o n s , r é v è l en t les obl i g a t ions de la Grèce
envers l 'Ég ypt e .
C e l a p o u r r o i t êt re d é v e l o p p é dans un g r and détai l ; ma i s , sans c h e r c h e r ici nos
preuves à t raver s ce v o i l e t ranspar ent et en même t emp s p l e in d' i l lus ions , dont
la fable r e v ê t tant de v é r i t é s Ln p o r t a n t e s , l 'hi s toi re suffit et n o u s éc lai re assez.
N e mo n t r e -t-elle pas Ina chus , Da n aUs , C é c r o p s , qui t tant les b o r ds du Ni l et s«
plaines depui s l o n g - t emp s cul t i v é e s , po r t ant sur les plage s de l 'At t i q u e et dam
les mo n t a g n e s de l ' A r g o l i d e leurs d i e u x , leurs l o i s , leurs usages , et les arts de
M i n e r v e , et l 'ol i v i e r de Sais qui lui est c ons a c r é ( 3 ) ! Si l 'on r a p p r o c h e cetie
(1) Diod.Sic. BiH. hhr. lib. I.
(2) Je ciie à dessein ce fail, qu'o
prendre, plus qu'aucun autre, pour ur
des poètes : mais il a des rapports av<
Égyptienne; c'est un des faits les plus
cienneasironotiiie, dont il
institutions les plus importât
tien ne peut être saisi maim
vers l'extrémité d'une longu
qu'elle avoit déjà été parcour
Quelques circonstances de ce fait
d'une manii;re vicieuse par 1« poëti
seroit porté à
pure création
: la mythologie
jrieux de l'anvérifier
une d.s
-e but de cette indica-
: c'«t un jalon placé
entier.
t ont été interprétées
des .Iges suivans.
qui ont cherché à adapter les fables mythologiques à itur
pays. Telle est la chute de Phai-ton dans l'JirKlan. Lt(
poëtes Romains ont donné lo nom ¿'£.rid,in au Hcuif
du Pô. Mais, observe très-bien M. A;ongi;z dan? sm
article Èridun de l'Encycl' pcdie,.. c'est un nom grnf-
« rique des Heuves, du primitii ^ •• rhr. rouler, coder,
M courir; et voilà pourquoi i! y s plusienrs l.ridans thf.
» les anciens. Le Nil sur-tout, des bords dutiuel sont
»venues les histoires astronomiques, portoit It noin
»d'Ériiian.» il faut remarquer qu'Ovide dnfxpress'mfnl
quePhaétoii sVyaraau-dessu. des désirtsdc la Lil) .-.
(3) Personne n'ignoie que l'Alluiue avoit été, sinw
D E L ' É G Y P T E . 4 2 1
dernière c i r c ons t anc e , qui est bi en c o n s t a t é e , de la di sput e p o é t i q u e de Mi n e r v e
et de Ne p t u n e , on c o n c e v r a c omme n t la fable peut servi r que lque foi s à vé r i f i e r
('Jiistoire.
Minos, par t i de s même s b o r d s , d o n n e de s lois à la Cr è t e . Plus tard, S o l o n ,
Lvcurgue, ces g r ands législateurs d'un s iècle é c l a i r é , v o n t mé d i t e r les lois de
fÉg}pte et de la C r è t e , et r a p p o r t en t e n c o r e à leur patrie des lois et des inst i tutions
plus p e r f e c t i onné e s : et l 'on pens e r o i t que c eux qui les ins t rui s i r ent , é toi ent
ignorans et grossiers ! Singul i è r e mani è r e d' env i s a g e r les fai t s !
Si nous r e g a rdons les s c i enc e s et la p h i l o s o p h i e , no u s v o y o n s , sans par ler
d'Homère, T h a ï e s , P y t h a g o r e , E u d o x e , Mé t o n , D émo c r i t e , Platon , A r c h imè d e
même, et tant d'aut res pe r s onna g e s c é l è b r e s , qui t ter leur pays p o u r al ler s'instruire
en É g } p t e , et la G r è c e qui s 'éclai re de plus en plus par les frui ts de
leurs voyages.
L'origine de s c onno i s s anc e s r a p p o r t é e à la G r è c e est d o n c une s u p p o s i t i o n
détruite en t out p o i n t par l 'hi s toi re : el le ne do i t plus no u s ar rêter . A b a n d o n -
nons-nous ent i è r ement aux c o n s é q u e n c e s de s fai ts, sûrs de t r o u v e r ensui te des
moyens de v é r i f i c a t ion,
§. VL
L'OBSERVATION d u mo u v eme n t des ast res, qui a g u i d é dans les g r ande s di v i s ions
de l'espace et du t emp s , les a fait s o ume t t r e à un r é g ime c o m m u n ; l ' anné e , pa r t agé e
en 12 moi s et en 3 6 0 ou 7 2 0 jour s , a d é t e rmi n é un s emblable par tage de l 'ec l iplique
et de tous les c e r c l e s . Ce p r inc i p e va no u s di r ige r enc o r e .
Le cercle de la ter re et c e lui de l 'anné e étant pris p o u r uni t é , l'un de l ' e spa c e , et
l'autre de la d u r é e , le j o u r c o r r e s p o n d o i t au de g r é : c e c i ne souf f r e pas de di f f icul té.
Reste à v o i r que l l e fut la di v i s i on du j o u r et du de g r é . Da n s ces deux uni t é s
secondaires, a - t - on suivi la même ma r c h e et le m ê m e mo d e que dans l 'uni té pr e -
mière! L' ana l o g i e po r t e à le c o n j e c t u r e r ; mai s de s c onj e c t u r e s ne suf f isent pas.
Nous r ema r quons d' abord que la di v i s ion du j o u r c omp l e t en 24 heur es a l ieu
aujourd'hui c h e z pr e sque tous les peupl e s . D è s la plus haut e ant iqui t é , les Ég \ p -
tiensen fai soi ent usage : out r e les p r e u v e s <lirectes que fourni s s ent les passages
<le Dion et d'aut res é c r i v a ins , il en est une qui se tire de l 'ordr e de s jour s de la
semaine. L e s Ég y p t i en s d o n n o i e n t à chaque h e u r e le n om d'une des pl anè t e s ,
suivant l 'ordre de leur di s t anc e à la ter re, et à cha q ue jour le n om de l 'heur e
par laquelle il c omme n ç o i t , d ' où r c sul toi t l 'ordr e établ i c h e z eux c omme che z nous
:oionie Égyptienne e Itupiée, an moins civilisée par ii t c'est à ces circoi
P«iie<ie Sais. La divinité qu'hon.
nttoit que l'Isis armée qui recevoit un culte particulier
aSais. Non-seulemeut la culture de l'olivier, mais celle
lin, et l'art de faire des tissus de toute espèce, poussé
«loin dans l'ancienne Egypte, furent aussi transportés
de Sais dans ¡'Attique avec le culte de Minerve : c'est
pootijuoi ils lui furent spécialement consacrés. Le« sculp-
«"rsdel, (¡réce.en ennoblissant les statues des divinilo!
originaires de l'Égypte, en ont sans doute beaucoup
'Wle caractère; mais les attributs sont testés les mêmes,
de l'Égypte
précédente.
institution,
velot, comi
istances principalenient qu'on peut
•ur identité. Ain-i la chouette, o
fstée l'oiseau de ^li erve. Isis arm
ic importante instiluliona^iK.nomii
i la n
le zodiaque de Denderah pnstér
sniôt portant une simple flèche ou un ¡a-
: on le rapporte de la statue de cette déesse
e ja\elot le ciseau des Grecs a fait une
»•1.1