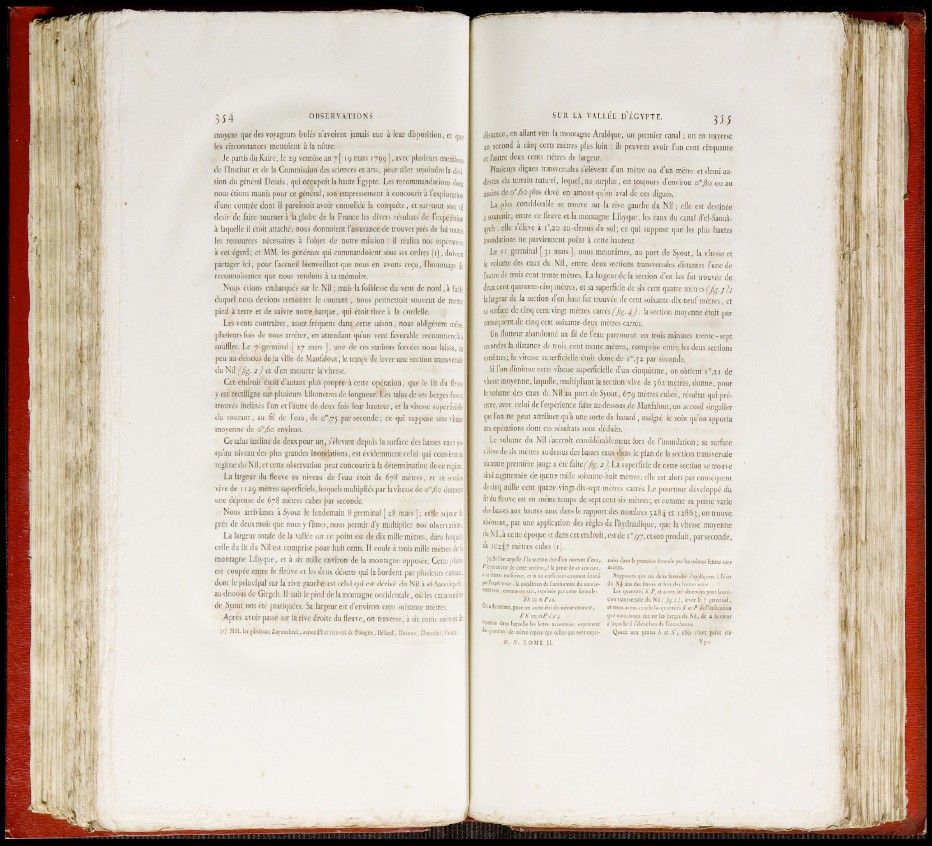
t i '
' M i
r i
f u
3 54 OBSERVATIONS
moyens que des voyageurs isoles navoiciit jâiTisis eue u Isiir disposition, et (nip
les circonstances inettoient à la nôtre.
J e partis du Kaire, le 2 9 ventôse an 7 [ 19 mars 1799 ] , avec plusieurs membres
de l'Institut et de la Commission des sciences et ans , pour aller rejoindre la division
du générai Desaix, qui occupoit la haute Egypte. Les recommandations doiu
nous étions munis pour ce général, son empressement à concourir à l'exploration
d'une contrée dont il paroissoit avoir consolidé la conquê t e , ec sur-tout son vif
désir de faire tourner à la gloire de la France les divers résultats de l'expéclition
à laquelle il étoit attaché, nous donnoi ent l'assurance de t rouve rpr c s de lui touieî
les ressources nécessaires à l'objet de not r e mission : il réalisa nos espcranccs
à cet égard; et MM. les généraux qui commandoi ent sous ses ordres ( i ) , doivent
partager ici, pour l'accueil bienveillant que nous en avons r e ç u, l'hommage de
reconnoissance que nous rendons à sa mémoire.
Nous étions embarqués sur le Nil ; mais la foiblesse du vent de n o r d , à l'aide
duquel nous devions r emont e r le courant , nous penne t toi t souvent de mettre
pied à terre et de suivre not r e barque, qui étoit tirée à la cordelle.
Les vents contraires, assez frcquens clans cette saison, nous obligèrent même
plusieurs fois de nous arrêter, en attendant qu'un vent favorable recommençât i
souffler. Le 7 germinal [ 2 7 mars ], une de ces stations forcées nous laissa, un
peu au-dessous de la ville de Manf a lout , le temps de lever une section transversale
du Nil fjîg. 2 J et d'en mesurer la vitesse.
Cet endroit étoit d'autant plus propr e à cette opé r a t ion, que le lit du fleuve
y est rectiligne sur plusieurs kilomètres de longueur. Les talus de ses berges fuieii!
trouvés inclinés l'un et l'autre de deux fois leur hauteur , et la vitesse superficielle
du c o u r a n t , au fil de l'eau, de o"',75 par s e conde ; ce qui suppose une vitesse
moyenne de o^.ôo environ.
Ce talus incliné de deux p o u r im, s'élevant depuis la surface des basses eaux jusqu'au
niveau des plus grandes inondations , est évidemment celui qui conviemau
régime du Nil ; et cette observation peut concourir à la détermination de ce régime,
La largeur du fleuve au niveau de l'eau étoit de 6 7 8 mè t r e s , et sa section
vive de 1 I 2 9 mètres superficiels, lesquels multipliés ]>ar Ja vitesse de o ^ ô o doniien:
une dépense de 6 7 8 mètres cubes par seconde.
Nous arrivâmes à Syout le lendemain 8 germinal [ 2 8 mars ] ; er*le séjour de
près de deux mois que nous y f îme s , nous permit d'y multiplier nos observations.
La largeur totale de la vallée sur ce point est de dix mille mè t r e s , dans lesquelcelle
du lit du Nil est comprise pour huit cents. Il coule à trois mille mètres de la
montagne Libyque , et à six mille environ de la mont agne opposée. Cette plaiw
est coupée entre le fleuve et les deux déserts qui la bordent par plusieurs canaux,
• dont le principal sur la r ive gauche est celui qui est dérivé du Nil à el-Saouàfj\eh,
au-dessous de Girgeh. 11 suit le pied de la mont agne occidentale, où les catacombes
de Syout ont été pratiquées, Sa largeur est d'environ cent soixante mètres.
Après avoir passe sur la rive droite du fleuve, on traverse, à six cents mètres de
{1) MM. les généraux Zayoncheck, aujourd'hui vicc-roi de Pologne , Béliard , Davoust, Don/.elot, Friant.
S U R LA V A L L É E D ' É G Y P T E . ^
distance, en allant vers la montagne Arabique, un premier canal ; on en traverse
un second à cinq cents mètres plus loin : ils peuvent avoir l'un cent cinquante
et l'autre deux cents mètres de largeur.
Plusieurs digues transversales s'élèvent d'un mètre ou d'un mètre et demi audessus
du terrain naturel, lequel, au surplus, est toujours d'environ o^.So ou au
moins de ©".óo plus élevé en amont qu'en aval de ces digues.
La plus considérable se trouve sur la rive gauche du Nil ; elle est destinée
à soutenir, entre ce Heuve et la mont agne Libyque, les eaux du canal d'cl-Saouâ-
([Veh ; elle s'élève à i " 2 0 au-dessus du sol; ce qui suppose que les plus hautes
inondations ne parviennent point à cette hauteur.
Le 11 germinal [ 3 i mars ], nous mesurâmes, au por t de Syout, la vitesse et
le volume des eaux du Ni l , entre deux sections transversales distantes l'une de
l'autre de trois cent trente mètres. La largeur de la section d'en bas fut trouvée de
deux cent quarante-cinq mètres, et sa superficie de six cent quatre mètres );
lalargeurde la section d'en haut fut trouvée de cent soixante-dix-neuf mètres, et
sa surface de cinq cent vingt mètres carrés fJig. 4 ) • ^^ section moyenne étoit par
conséquent de cinq cent soixante-deux mètres carrés.
Un flotteur abandonné au fil de l'eau parcourut en trois minutes t r e n t e - s e p t
secondes la distance de trois cent trente mètres, comprise entre les deux sections
extrêmes; la vitesse superficielle étoit d o n c de r",52 par seconde.
Si l'on diininue cette vitesse superficielle d'un c inqui ème , on obtient i'",2i de
Vitesse moyenne , laquelle, multipliant la section vive de 5 6 2 mètres, d o n n e , p o u r
le volume des eaux du Nil au por t de Syout, 6 7 9 mètres cubes, résultat qui présente,
avec celui de l'expérience faite au-dessous de Manfalout, un accord singulier
(¡ue l'on ne peut attribuer qu'à une sorte de hasard, malgré le soin qu'on apporta
aux opérations dont ces résultats sont déduits.
Le volume du Nil s'accroît considérablement lors de l'inondation ; sa surface
s'élève de six mètres au-dessus des basses eaux dans Je plan de la section transversale
ounotre première jauge a été faite(0%- 2 ) . La superficie de cette section se trouve
ainsi augiiientée de quatre mille soixante-huit mètres; elle est alors par conséquent
de cinq mille cent quatre-vingt-dix-sept mètres carrés. L e pour tour développé du
fit du fleuve est en mêine temps de sept cent six mètres ; et c omme sa pente varie
des basses aux hautes eaux dans le rapport des nombres 5 2 8 4 et 1 2 8 6 3 , on trouve
aisément, par une application des règles de l'hydraulique, que la vitesse moyenne
du Nil, à cette époque et dans cet endroi t , est de i"',97, et son produi t , par seconde,
de 10247 mètres cubes (i).
(ijSi l'on appelle J'la ction vive d'un cou
, mées dans I,i première formule par les mêmes lettres sans
/'Itpérimètrede cene s<
ion, h la pente de •
"îJ vitesse uniforme, ec
un coefficient con;
parrexpérience.la cond
t, exprimée pai
Sh =
le même, pour un autre état du mcm
S'h- z=iinFu'u',
nn dans laquelle les kttrrs acccntuc
antités de mSmc espèce que celles
/ / . N. T O M E I I .
Supposons que ces deux formules s'appliquent 4
Ju Nii lors des basses et lors des hautes eaux.
Les quantités .i, P , et u ont été observée« pour li
ion transversale du Nil ( fig. 2), levée le 7 germ:
;t nous a\ons conclu lesquantia's S' et P'del'indicatior
lous avons eue sur les berges du Nil, de k liauievv
i laimelle il s'élève iors de l'inondation.
Quant aux pentes h et / . ' , elles n'ont point
Yy.