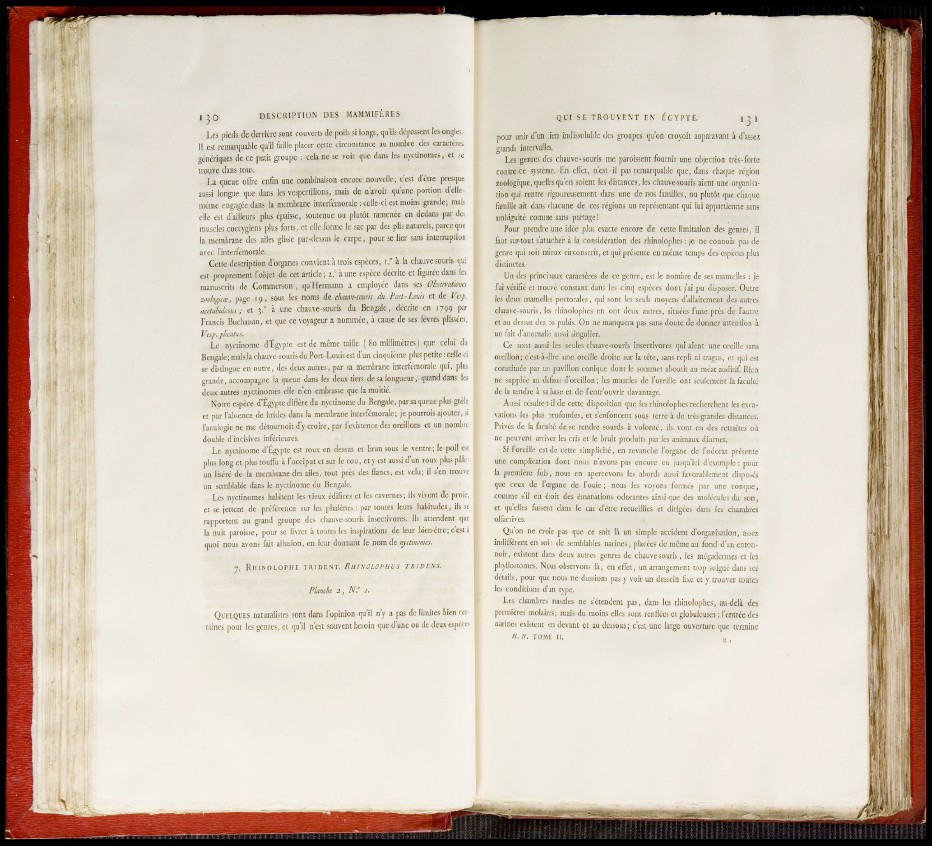
3 0
D E S C R I P T I O N D E S M A M M I F È R E S
•
Les pieds de denière sont couvci ls de poils si longs, qu'ils dépassent les ongles.
Il est remaïquable qu'il faille placer cette circonstance au nombre des caractères
génériques de ce petit groupe : cela ne se voit que dans les nyct inomes, et se
trouve dans tous.
La queue offre enfin une combinaison encore nouvelle; c'est d'être presque
aussi longue que dans les vespertilions, mais de n'avoir qu'une portion d'elle^
même engagée dans la membrane interfemorale ; celle-ci est moins grande; mais
elle est d'ailleurs plus épaisse, soutenue ou plutôt ramenée en dedans par des
muscles coccygiens plus forts, et elle forme le sac par des plis naturels, parce que
la membrane des ailes glisse par-dessus le carpe, pour se lier sans interruption
avec l'interféinorale.
Cette description d'organes convient à trois espèces, i à la clutive-souris qui
est proprement l'objet de cet article ; 2.° à une espèce décrite et figurée dans les
manuscrits de Coinmerson , qu'Herinann a emplo) ce dans ses Obsoyaùoms
zoologicoe, page 1 9 , sous les noms de chmve-souris du Poit-Louis et de Vesp.
acetubnlosus ; et 3."' à une chauve-souris du Bengale, décrite en 1799 par
Francis Buchanan, et que ce voyageur a nommé e , à cause de ses lèvres plissées,
Vtip. plicatus.
L e nyctinome d'Égypte est de même taille ( 80 millimètres) que celui du
Bengale; mais la chauve-souris du Port -Louis est d'un cinquième plus petite : celle-ci
se distingue en outre, des deux auu-es, par sa membrane intcrfémoralc qui, plus
grande, accompagne la queue dans les deux tiers de sa longueur, quand dans les
deux autres nyctinomes elle n'en embrasse que la moitié.
Notre espèce d'Ég) ptc diffère du nyctinome du Bengale, par sa queue plus grêle
et par ra])sence de brides dans la membrane interfemorale; je pourrois ajouter, si
l'analogie ne me dctournoit d'y croi ix, par l'existence des oreillons et un nombre
double d'incisives inférieures.
L e nyctinome d'Egypte est roux en dessus et brun sous le ventre; le poil est
plus long et plus touffu à l'occiput et sur le cou, et y est aussi d'un roux plus paie;
un liséré de la membrane des ailes, tout prés des flancs, est velu; il s'en trouve
un semblable dans le nyctinome du Bengale.
Les nyctinomes habitent les vieux édifices et les cavernes ; ils vivent de proie,
et se jettent de préférence sur les jihalènes : pa- toutes leurs habitudes, ils se
rapportent au grand groupe des chauve-souris insectivores. Ils attendent que
la nuit paroisse, pour se livrer à toutes les inspirations de leur bien-être; c'est à
quoi nous avons fait allusion, en leur donnant le nom de nyctinomes.
7 . R H I N O L O P H E T R I D E N T . RHINOLOPHUS TRIDENS.
Planée 2, N." 1.
QUELQUES naturalistes sont dans l'opinion qu'il n'y a pas de limites bien rer
tarnes pour les genres, et qu'il n'est souvent besoin que d'une ou de deux espèce^
Q U I SE T R O U V E N T EN È G Y P T E , i T i
pour unir d'un lien indissoluble des groupes qu'on croyoit auparavant à d'assez
grands intervalles.
Les genres des chauve-souris me paroissent fournir une objection très-fôrte
contre ce système. En eflct, n'est-il pas remarquable que, dans chaque région
zooJogique, quelles qu'en soient les distances, les chauve-souris aient une organisation
qui rentre rigoureusement dans une de nos familles, ou plutôt que chaque
famille ait dans chacune de ces régions un représentant qui lui appartienne sans
ambiguité comme sans partage!
Pour prendre une idée j)Ius exacte encore de cette limitation des genres, il
faut sur-tout s'attacher à la considération des rhinolophes : je ne connois pas de
genre qui soit mieux chxonscrit, et qui présente en même temps des espèces plus
distinctes.
Un des principaux caractères de ce genre, est le nombre de ses mamelles : je
l'ai vérifié et trouvé constant dans les cinq espèces dont j'ai pu disposer. Outre
les deux mamelles ])ectorales, qui sont les seuls moyens d'allaitement des autres
chauve-souris, les rliinoiophes en ont deux autres, situées l'une près de l'autre
et au dessus des os pubis. On ne manquera pas sans doute de donner attention à
un fait d'anomalie aussi singulier,
Ce sont aussi les seules chauve -souris insectivores qui aient une oreille sans
oreillon; c'est-à-dire une oreille droite sur la tête, sans repli ni tragus, et qui est
constituée par un pavillon conique dont le sommet aboutit au méat auditif Rien
ne supplée au défaut d'oreillon ; les muscles de l'oreille ont seulement la faculté
de la tendre à sa base et de l'entr'ouvrir davantage.
Aussi résulte-t-il de cette disposition que les rhinolophes recherchent les excavations
les plus profondes, et s'enfoncent sous terre à de très-grandes distances.
Prives de la faculté de se rendre sourds à volonté, ils vont en des retraites où
ne peuvent arriver les cris et le bruit produits par les animaux diurnes.
Si l'oreille est de cette simplicité, en revanche l'organe de l'odorat présente
une complication dont nous n'avons pas encore eu jusqu'ici d'exemple : pour
la première f o i s , nous en apercevons les abords aussi favorablement disposés
que ceux de l'organe de l'ouie ; nous les voyons formés par une conque ,
comme s'il en étoit des émanations odorantes ainsi que des molécules du son,
et qu'elles fussent dans le cas d'être recueillies et dirigées dans les clrambres
olfactives.
Qu'on ne croie pas que ce soit là un simple accident d'organisation, assez
indiiîérent en soi : de semblables narines, placées de même au fond d'un entonnoir.
existent dans deux autres genres de chauve-souris, les mcgadermes et les
phyllostomes. Nous observons là, en ef fet , un arrangement trop soigne dans ses
détails, pour que nous ne dussions pas y voir un dessein fixe et y trouver toutes
les conditions d'un type.
Les chambres nasales ne s'étendent pas, dans les rhinolophes, au-delà des
premières molaires; mais du moins elles sont renflées et globuleuses : l'entrée des
narines existent en devant et au dessous ; c'est une lai-ge ouverture que termine
H. N. T O M E II.
i
1 '
• ^ S ;