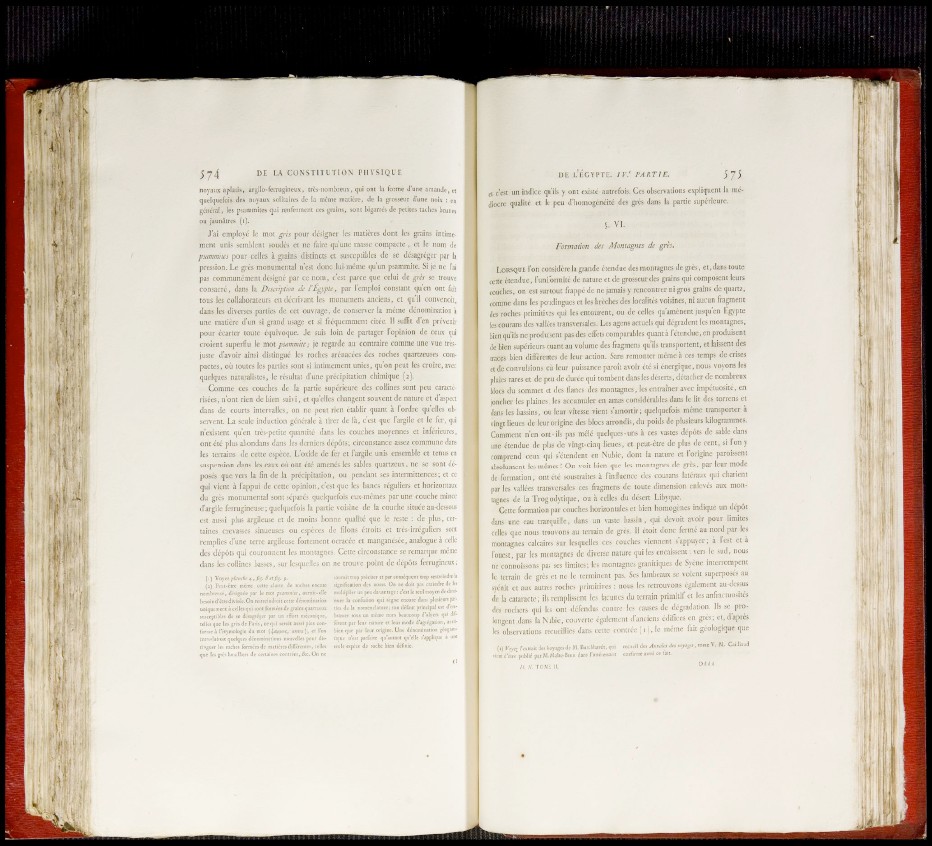
¿ 1;
l ì
•! I ¡m
m •
DE I-A C O N S T I T U T I O N P H Y S I Q U E
noyaux aplaiis, argilo-fernigineiix, trcs-»ombreiix, qui ont la forme d'une amande, et
quelquefois des noyaux solitaires de !a même maiiù-e, de la grosseur d'une noix : en
général, les psammites qui renferment ces grains, sont bigarres de petites taches brunes
ou jaunâtres (i).
J ' a i emp l o y é le m o t grès p o u r de s i g n e r les ma d è r e s t i e n t les grains intimement
uni s s emb l e n t s o u d é s et ne f a i r e q u ' u n e masse c omp a c t e , et le n om de
psaminncs p o u r celles à grains di s t inc t s et susceptibles de se dé s agr ége r par la
pression. Le grès mo n ume n t a l n'est d o n c l u i -même q u ' u n p s ammi t e . Si je ne l'ai
pas c ommu n éme n t dé s igne p a r ce n o m , c'est p a r c e que celui de g n s se trouve
c o n s a c r é , d ans la Description ¿le l'Égypte, pa r l ' emp l o i c o n s t a n t q u ' e n o n t fart
tous les col l abor a t eur s en cîécrivant les mo n ume n s a n c i e n s , et qu'il coavenoi t ,
dans les dive r s es pa r t i e s de cet o u v r a g e , de c o n s e r v e r la m ê m e d é n omi n a t i o n à
une ma t i è r e d ' u n si g r a n d usage et si f r é q u emme n t citée. 11 suffit d' en prévenir
pour é c a r t e r t o u t e é q u i v o q u e . Je suis loin de p a r t a g e r l ' o p i n i o n de ceux qui
c r o i e n t supe r f lu le m o t psammiu ; je r e g a r d e au c o n t r a i r e c o tmn e u n e vue trèsjuste
d ' a v o i r ainsi di s t ingu é les r o c h e s a r éna c é e s des r o c h e s qua r t z eus e s comp
a c t e s , où t o u t e s les pa r t i e s s o n t si i n t imeme n t u n i e s , q u ' o n p e u t les c r o i r e , avec
quelques na tur a l i s t e s , le résultat d ' u n e p r é c i p i t a t i o n c h imi q u e (2).
C o m m e ces c o u c h e s de la p a r t i e s u p é r i e u r e de s collines s o n t p e u caractérisées,
n ' o n t r i en de Lien s u i v i , et qu'elles c h a n g e n t s o u v e n t de n a t u r e et d'aspect
dans de c o u r t s int e rva l l e s , on ne p e u t r i en établir q u a n t <à l ' o r d r e qu'elles observent.
La seule i n d u c t i o n géné r a l e à tirer de là, c'est que l'argile et le f e r , qui
n'existent q u ' e n t r è s -pe t i t e q u a n t i t é dans les c o u c h e s mo y e n n e s et inférieures,
o n t é t é plus a b o n d a n s dans les de rn i e r s d é p ô t s ; c i r c o n s t a n c e assez c ommu n e dans
les terrains de c e t t e e spè c e . L' o x i d e de f e r et l'argile uni s e n s emb l e et tenus en
suspension dans les eaux où o n t é t é ame n é s les sables q u a r t z e u x , ne se sont déposés
q u e vers la fin de la p r é c i p i t a t i o n , ou p e n d a n t ses i n t e rmi t t e n c e s ; et ce
qui vi ent à l ' appu i de c e t t e o p i n i o n , c'est q u e les banc s réguliers et horizontaux
d u grès mo n ume n t a l s o n t séparés que lque foi s e u x -même s p a r u n e c o u c h e mince
d'argile f e r r u g i n e u s e ; q u e l q u e f o i s la p a r t i e voisine de la c o u c h e située au-dessous
est aussi plus argileuse et de mo i n s b o n n e qualité <|ue le reste : de p l u s , certaines
crevasses s inueus e s ou espèces de filons é t roi t s et très-irréguliers sont
remplies d ' u n e t e r r e argileuse f o r t eme n t o c r a c é e et ma n g a n é s é e , a n a l o g u e à celle
des d é p ô t s qui c o u r o n n e n t les mo n t a g n e s . Ce t t e c i r c o n s t a n c e se r ema r q u e même
dans les col l ine s basses, sur lesquelles on ne t r o u v e p o i n t de d é p ô t s f e r rugineux;
( I ) Voyez phnchi - f . f g . S etjig. p.
(2) PCIII-étre même cette classe de roches encore
nombreuse, dfsignce par le mol psammitt, auroit-elie
besoind'ètredivisée. On resireindroit celle dénominaiion
uniquement à celles qui som fornii'es de grains quarireux
susceptibles de se dcsagréger par un efTott mécanique,
telles que les grès de Paris, ce qui seroit aussi plus con-
Ibtnie à l'étymologie du mot (\afif.n;, arend), el l'on
iniroduiroit quelques dénominations nouvelles pour distinguer
les roches fornicEs de matières différentes, telles
que les gre« houilliers de certaines contrées, &c. On ne
sauroit trop préciser cl par conséquent trop restreindre la
signification des noms. On ne doit pas craindre de les
multiplier un peu davantage r c'est ie seul moyen de diminuer
la confusion qui règne encore dans plusieurs parties
de la nomenclature; son défaut principal est d'cmbras.
er sous un même nom beaucoup d'objets qui diffèrent
par leur nature et leur modo d'agrégation, aussibien
que par leur origine. Une dénoniination geognostique
n'est parfaite qu'autant qu'elle s'applique à une
seule espèce de roche bien définie,
DE L É G Y F T E . IV.' PARTIE. J Y J
Cl c'est un indi c e qu'ils y o n t existé aut r e foi s . Ce s obs e rva t ions e x p l i q u e n t la mé -
diocre qualité et le p e u d ' h omo g é n é i t é de s grès dans la pa r t i e s u p é r i e u r e .
V I .
Formation des Montagnes de grès.
LORSQUE l'on c o n s k i è r e la g r a n d e ctencluc de s mo n t a g n e s de g r è s , e t , dans t o u t e
cette é t e n d u e , l ' u n i f o rmi t é de n a t u r e et J e gros s eur de s grains qui c omp o s e n t leurs
couches, on est sur - tout f r a p p é de ne jamais y r e n c o n t r e r ni gros grains de qua r t z ,
comme d ans les p o u d i n g u e s et les br è che s des localités voisines, ni a u c u n f r a gme n t
lies roche s pr imi t ive s qui les e n t o u r e n t , ou de celles q u ' amè n e n t jusqu'en Eg y p t e
les cour ans de s vallées transversales. Le s agens actuels qui d é g r a d e n t les mo n t a g n e s ,
bien qu'ils n e p r o d u i s e n t pas de s effets c omp a r a b l e s q u a n t à l ' é t e n d u e , e n p r o d u i s e n t
de bien supé r i eur s q u a n t au v o l ume de s f r aginens qu'ils t r a n s p o r t e n t , et laissent de s
tracps bi en di f f é r ent e s de leur a c t i o n . Sans r emo n t e r même à ces t emp s de crises
et de c o n v u l s i o n s où leur pui s s anc e p a r o î t avoi r é t é si é n e r g i q u e , n o u s v o y o n s les
pluies rares et de p e u de d u r é e qui t omb e n t dans les d é s e r t s , d é t a c h e r de n omb r e u x
blocs du s omme t et de s flancs de s mo n t a g n e s , les e n t r a î n e r ave c i i r rpé tuos i t é, en
joncher les p l a i n e s , les a c c umu l e r en ama s cons idé r abl e s dans le lit de s t o r r c n s et
dans les bassins, où leur vttesse v i e n t s ' amo r t i r ; tiuelquefois même t r a n s p o r t e r à
vingt lieues de leur o r i g i n e de s blocs a r r o n d i s , du p o i d s de plus i eur s kilograrirmes.
Comment n ' e n o n t - i l s pas mê l é q u e l q u e s - u n s à ces vastes d é p ô t s de sable dans
une é t e n d u e de plus de v i n g t - c i n q l i eue s , et p eut - ê t r e de plus de c e n t , si l'on y
comprend c eux qui s ' é t e n d e n t en Nu b i e , d o n t la n a t u r e et l 'or igine pa roi s s ent
absolument les trrcmes : O n voi t bi en que les mo n t a g n e s de g r è s , pa r leur mo d e
(le f o rma t i o n , o n t é t é soustraites à l ' inf luenc e de s c o u r a n s latéraux qui c h â t i e n t
par les vallées transversales ces f r a gme n s de t o u t e d ime n s i o n enl evé s aux mo n -
tagnes de la T r o g l o d y t i q u e , ou à celles du dé s e r t Libyque .
C e t t e f o rma t i o n pa r c o u c h e s h o r i z o n t a l e s et bien h omo g è n e s i n d i q u e un d é p ô t
clans u n e e au t r a n q u i l l e , dans un vaste bassin , qui d e v o i r a v o i r p o u r limites
celles que n o u s t r o u v o n s au t e r r a in de grès. Il é toi t d o n c f e rmé au n o r d pa r les
montagnes calcaires sur lesquelles ces c o u c h e s v i e n n e n t s ' appuye r ; à l'est et à
l'ouest, pa r les mo n t a g n e s de dive r s e n a t u r e qui les encaissent : vers le s u d , n o u s
ne c o n n o i s s o n s pas ses l imi t e s ; les mo n t a g n e s granitiipies de S \ è n e i n t e r r omp e n t
le terrain de grès et ne le t e rmi n e n t pas. Ses l ambe aux se v o i e n t s u p e r p o s é s au
sycnit et aux autres r o c h e s pr imi t ive s : n o u s les r e t r o u v o n s é g a l eme n t au-dessus
de la c a t a r a c t e ; ils r empl i s s ent les lacunes du terrain p r imi t i f el les anf r a c tuos i t é s
des r o c h e r s qui les o n t d é f e n d u s c o n t r e les causes de d é g r a d a t i o n . Ils se p r o -
longent d ans la Nu b i e , c o u v e r t e é g a l eme n t d ' a n c i e n s édifices en gr è s ; e t , d apr è s
les obs e rva t ions recueillies dans c e t t e c o n t r é e ( i ) . le g é o l o g i q u e q u e
(0 Ki^^f^ 1'eur.nLt des Voyages He M. Burdhai dl, qui
Vieiil d'ciri; publié par .M. Malte-Brun tians I"
recueil des Aimdiis des ,
coiiürme aussi ce fait.
L 1