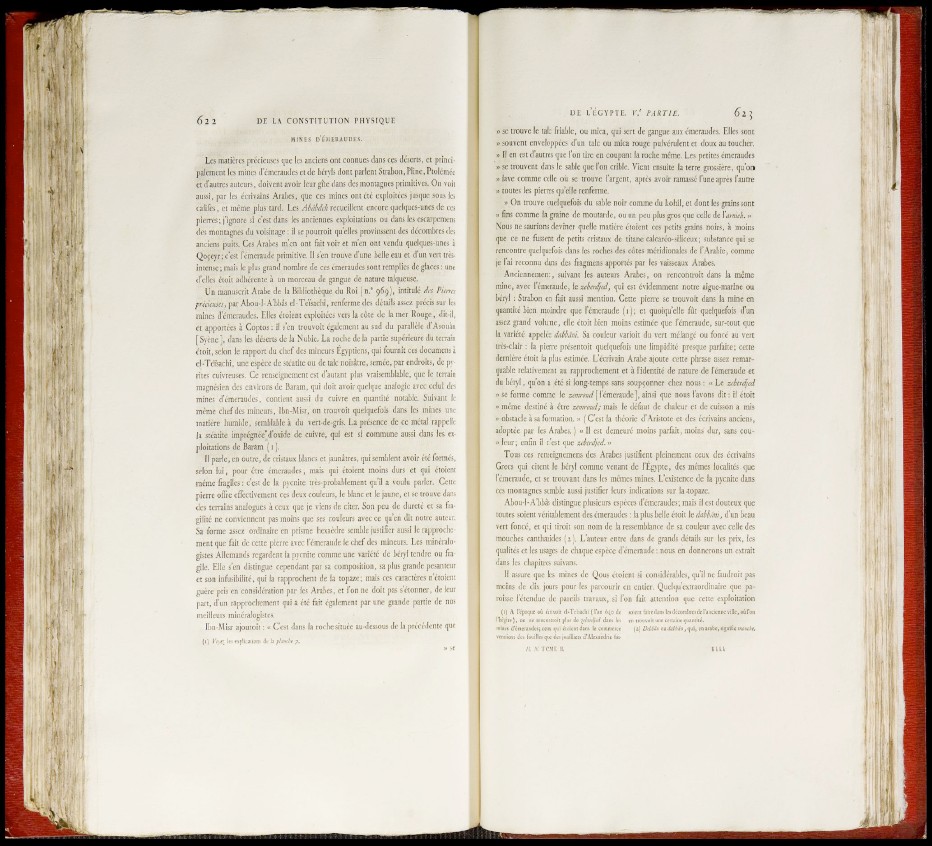
1 ' m
íii'
; r
6 2 2 DE LA C O N S T I T U T I O N P H Y S I Q U E
MINES D'ÉMEBAUDKS.
Les matières prccicuses que les anciens ont connues clans ces déserts, et principalement
les mines d cmeraudes et de bcrvis dont parlent Strabon, Pline, Ptoicmce
et d'autres auteurs, doivent avoir leur gîte dans des montagnes primitives. On voit
aussi, par les écrivains Arabes , cjuc ces mines ont été exploitées jusque sous les
califes, et même plus tai'd. Les Abâbdch recueillent encore quelques-unes de ces
pierres; j'ignore si c'est dans les anciennes exploitations ou dans Jes cscarpcmens
des montagnes du voisinage : il se pourroit qu'elles provinssent des décombres des
anciens puits. Ces Arabes m'en ont fait voi r et m'en ont vendu quelques-unes à
Qo ç e y r ; c'est l'émeraude primitive. II s'en trouve d'une belle eau et d'un vert trèsintense
; mais le plus grand nombre de ces cmeraudes sont remplies de glaces : une
d'elles étoit adhérente à un morceau de gangue de nature talqueuse.
Un manuscrit Arabe de la Bibliothèque du Roi (n.® 9 6 9 ) , intitulé des Pierres
précieuses, par Abou- I -A'bbàs e l -Te ï s a chi , renferme des détails assez précis sur les
mines d'émeraudes. Elles étoient exploitées vers la côte de la mer Roug e , dit-il,
et apportées à Coptos : il s'en trouvoit également au sud du parallèle d'Asouàii
[ S} ène ] , dans les déserts de la Nubie. L a roche de la partie supérieure du terrain
c toi t , selon le rapport du che f des mineurs Égypdens, qui fournit ces documens à
e l -Te ï sachi , une espèce de stéatite ou de talc noirât re, semée, par endroits, de ]n--
rites cuivreuses. Ce renseignement est d'autant plus vraisemblable, que le terrain
magnésien des environs de Baram, qui doit avoir quei<[ue analogie avec celui des
mines d'émeraudes, cont ient aussi du cuivre en quantité notable. Suivant le
même che f des mineur s, Ibn-Misr , on trouvoit quelquefois dans les mines une
matière humide, semblable à du vert-de-gris. L a présence de ce métal rappelle
la stéatite imprégnée'd'oxide de cuivre, qui est si commune aussi dans les exploitations
de Baram ( 1 ).
Il par le, en out re, de cristaux blancs et jaunâtres, qui semblent avoir été formés,
selon lui , pour êt re émeraudes , mais qui étoient moins durs et qui étoient
même fragiles : c'est de la pycnite très-probablement qu'il a voulu parler. Cet te
pierre offre effectivement ces deux couleurs, le blanc et le jaune, et se trouve dans
des terrains analogues à ceux que je viens de citer. Son peu de dureté et sa fragilité
ne conviennent pas moins que ses couleurs avec ce qu'en dit notre auteur.
Sa forme assez ordinaire en prisme hexaèdre semble justifier aussi le rapprochement
que fait de cet te pierre avec l'émeraude le che f des mineurs. Les minéralogistes
Al lemands regardent la pycnite comme une variété de béryl tendre ou fragile.
El le s'en distingue cependant par sa compos i t ion, sa plus grande pesanteur
et son infusibilité, qui la rapprochent de la topaze; mais ces caractères n'étoient
guère pris en considération par les Arabes, et l'on ne doit pas s'étonner , de leur
part, d'un rapprochement qui a été fait également par une grande partie de nos
meilleurs minéralogistes.
Ibn-Misr ajoutoit : « C'est dans la roche située au-dessous de la | )rccé(Iente que
(1) les «xplicadons de l.i phnche 7.
U E L É G Y P T E . V.' PARTIE. 6 2 3
» se trouve le talc friable, ou mi ca, qui sert de gangue aux émeraudes. Elles sont
î> souvent enveloppées d'un talc ou mica rouge pulvérulent et doux au toucher.
« Il en est d'autres que l'on tire en coupant la roche même. Le s petites émeraudes
se trouvent dans le sable que l'on crible. Vient ensuite la terre grossière, qu'or»
» lave comme celle où se trouve l'argent, après avoir ramasse l'une après l'autre
» toutes les pierres qu'elle renferme.
» On trouve quelquefois du sable noi r c omme du koliil, et dont les grains sont
» fins c omme la graine de moutarde, ou un peu plus gros que celle de Karnieh. y
Nous ne saurions deviner quelle matière étoient ces petits grains noirs, à moins
que ce ne fussent de petits cristaux de titane calcaréo-siliceux; substance qui se
rencontre quelquefois dans les roches des côtes méridionales de l 'Arabie, c omme
je l'ai reconnu dans des fragmens apportés par les vaisseaux Arabes.
An c i e n n eme n t , suivant les auteurs Arabes , on rencont roi t dans ia même
raine, avec l'émeraude, le zeberdjed, qui est évidemment not re aigue-marine ou
béryl : Strabon en fait aussi ment ion. Cet te pierre se trouvoit dans la mine en
quantité bien moindre que l'émeraude ( i } ; et quoiqu'elle fût quelquefois cfun
assez grand volume , elle étoit bien moins estimée que l'émeraude, sur-tout que
la variété appelée dabbâni. Sa couleur varioit du vert mélangé ou fonc é au vert
très-clair ; la pierre présentoir quelquefois une limpidité presque parfaite; cet te
dernière étoit la plus estimée. L'écr ivain Arabe ajoute cette phrase assez remar -
quable relativement au rapprochement et à l'identité de nature de l'émeraude et
du béryl , qu'on a été si long-temps sans soupçonner chez nous : « L e zeberdjed
» se forme c omme le zwhw/ / / [ l 'émeraude] , ainsi que nous l'avons di t : il étoi t
» même destiné à être zmroud; mais le défaut de chaleur et de cuisson a mis
» obstacle à sa formation. » ( C'est la théor ie d'Ar istote et des écrivains anciens,
adoptée par les Arabes. ) « Il est demeuré moins parfait, moins dur, sans cou-
» leur ; enfin il n'est que zeberdjed.»
To u s ces renseignemens des Arabes justifient pleinement ceux des écrivains
Grecs qui citent le béryl c omme venant de l 'Égypte, des mêmes localités que
l'émeraude, et se ti-ouvant dans les mêmes mines. L'existence de la pycnite dans
ces montagnes semble aussi justifier leurs indications sur la -topaze.
Abou- I -A'bbàs distingue plusieurs espèces d'émeraudes; mais il est douteux que
toutes soient véritablement des émeraudes : la plus belle étoit le dabbâni, d'un beau
vert fonc é , et qui tiroit son nom de la ressemblance de sa couleur avec celle des
mouches cantharides ( 2 ) . L'auteur entre dans de grands détails sur les prix, les
qualités et les usages de chaque espèce il'émcraude : nous en donnerons un extrait
dans les chapitres suivans.
II assure que les mines de Qous étoient si considérables, qu'il ne faudroit pas
moins de dix jours pour les parcourir en entier. Quclqu'cxtraordinaire que paroisse
l'étendue de pareils travaux, si l'on fait attention que cette exploitation
(:) A répoque ville, oùTon
l'Iicgirc), on ne
cl-Ttisachi ( l'an 6.io de
plus de \eltrdjtd dans les
•meraiidcs; ceux qui éioiont dans lu commcrce
(les fouilles (juc dus joailliers d'Alexandrie fài-
//. .V TOMF. Il,
oreiK faire dans les docombtesdel'
•n irouvoit une certaine quantité.
{1) Delkw ou rfaiWii, qui, en arabe, signifie vioucbe.