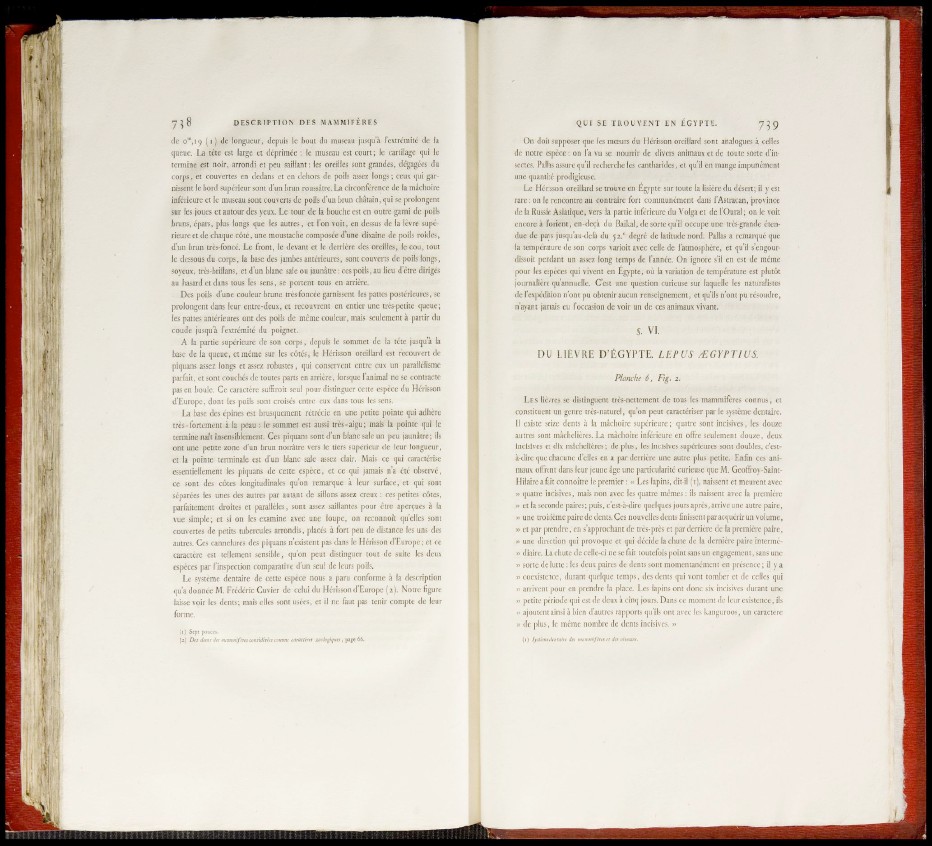
n.i
y ^ S D E S C R I P T I O N D E S M A M M I F È R E S
d e o ' " , i 9 ( I ) de l o n g u e u r , depuis le b o u t du mus e au jusqu'à l'extrcmitc de la
([ueue. La téte est Jarge et d é p r imé e : le mu s e a u est c o u r t ; le cartilage (jui le
termine est n o i r , a r r o n d i et p e u s a i l l ant: les oreilles sont gr ande s , dégagées du
c o r p s , et couve r t e s en d e d a n s et en d e h o r s de poils assez longs ; ceux qui garnissent
le bord supé r i eur sont d'un brun roussàtre. La c i r c o n f é r e n c e de la mâ c h o i r e
inférieure et le mus e au s o n t couve r t s de poils d'un brun châ t a in, qui se p r o l o n g e n t
sur les joues et a u t o u r des yeux. L e tour de la b o u c h e est en o u t r e garni de poils
bruns, cpa r s , plus longs que les a u t r e s , et l'on v o i t , en dessus de la lèvre supérieure
et de c haque c ô t e , u n e mo u s t a c h e c omp o s é e d ' u n e dixaine de poils roide s ,
d ' u n brun très-foncé. Le f r o n t , le d e v a n t et le de r r i è r e des oreilles, le c o u , t o u t
le dessous du c o r p s , la base des jambes ant é r i eur e s , s o n t couve r t s de poils longs ,
soyeux, très-brillans, et d ' u n blanc sale ou jaunâ t re : ces poi l s , au lieu d' ê t r e dirigés
au hasard et dans tous les s ens , se p o r t e n t tous en arrière.
Des poils d ' u n e c o u l e u r b r u n e très-foncée garnissent les pattes pos t é r i eur e s , se
prolongent dans leur e n t r e - d e u x , et r e c o u v r e n t en ent i e r u n e très-petite q u e u e ;
les pa t t e s ant é r i eur es o n t de s poils de même coul eur , mais s e u l eme n t à partir du
coude jusqu'à l'extrémité du p o i g n e t .
A la pa r t i e supé r i eur e de son c o r p s , depui s le s omme t de la t ê t e jusqu'à la
base de la q u e u e , et même sur les c ô t é s , le Hé r i s son oreillard est r e c o u v e r t de
piquans assez longs et assez r o b u s t e s , qui c o n s e r v e n t e n t r e eux un parallélisme
parfait, et sont couché s de tout es parts en a r r i è r e , lorsque l'animal ne se cont r a c t e
pas en boule. Ce caractère suffiroit seul p o u r distinguer c e t t e e spè c e du Hé r i s s o n
d ' E u r o p e , d o n t les poils sont croisés ent r e eux dans tous les sens.
La base des épine s est b r u s q u eme n t r é t r é c i e en u n e pe t i t e p o i n t e qui a d h è r e
t r è s - f o r t e m e n t à la pe au ; le s omme t est aussi t r è s - a i g u ; mais la p o i n t e qui le
termine naît ins ens ibl ement . Ce s piquans s o n t d'un bianc sale un p e u j a unâ t r e ; ils
ont une petite z o n e d'un brun noi r â t r e vers le tiers supé r i eur de leur l o n g u e u r ,
et la p o i n t e t e rmina l e est d'un blanc sale ;issez clair. Ma i s ce qui caractérise
essentiellement les piquans de c e t t e e s p è c e , et ce qui jamais n'a été o b s e r v é ,
ce sont de s côt e s longitudinales q u ' o n r ema r q u e à leur sur f a c e , et qui sont
séparées les une s des autres pa r aut ant de sillons assez creux : ces pe t i t e s côt e s ,
parfaitement droites et parallèles, sont assez saillantes p o u r ê t r e ape r çue s à la
vue s imp l e ; et si on les examine ave c u n e l o u p e , on r e c o n n o î t qu'elles sont
couvertes de petits tubercules a r r o n d i s , placés à f o r t p e u de distance les uns des
autres. Ce s c anne lur e s des piquans n'existent pas dans le Hé r i s son d 'Eu r o p e ; et ce
caractère est t e l l ement sensible , qu'on p e u t distinguer t o u t de suite les deux
espèces par l'inspection c omp a r a t i v e d'un seul de leurs poils.
L e système dent a i r e de cette e spè ce nous a ]}aru c o n f o rme à la de s c r ipt ion
qu'a d o n n é e M. Fr é d é r i c Cu v i e r de celui du Hé r i s son d 'Eu r o p e (2) . No t r e figure
laisse voi r les dent s ; mais elles sont usées, et il ne faut pas tenir c omp t e de leur
forme.
(1) Sept pouces.
(2) Des dénis ties mitminifères considéréts c(.
Q U J SE T R O U V E N T EN E G Y P T E . 7 3 9
O n d o i t s uppos e r que les moeu r s du Hé r i s son oreillard sont analogues à celles
d e not r e espèce : on l'a vu se nour r i r de divers animaux et de tout e sor t e d'insectes.
Pallas assure ((u'il r e c h e r c h e les c antha r ide s , et qu'il en ma ng e imp u n éme n t
une quant i té prodigieuse.
L e Hé r i s son oreillard se t r o u v e en Égypt e sur tout e la lisière du dé s e r t ; il y est
rare: on le r e n c o n t r e au cont r a i r e for t c ommu n éme n t dans l'Astracan, p r o v i n c e
de la Russie As i a t ique , vers la partie inf é r i eur e du Volga et de l 'Our a l ; on le voi t
encore à l ' o r i e n t , e n - d e ç à du Baikal, de sor t e qu'il o c c u p e u n e très-grande étendue
de pays jusqu'au-delà du -yz." degré de latitude n o r d . Pallas a r ema r q u e q u e
la t emp é r a t u r e de son corps varioit ave c celle de l ' a tmosphè r e , et qu'il s'engourdissoit
p e n d a n t un assez long t emp s de l'année. On ignor e s'il en est de même
pour les espèces qui vivent en Ég y p t e , où la variation de t emp é r a t u r e est plutôt
journalière qu'annuelle. C'est u n e que s t ion curieuse sur laquelle les naturalistes
d e l'expédition n ' o n t pu obt eni r a u c u n r e n s e i g n eme n t , et qu'ils n ' o n t pu r é s o u d r e ,
n'a)ant jamais eu l'occasion de voir un de ces aniinaux vivant.
S. VI .
D U L I È V R E D ' É G Y P T E . LEPUS ^ G Y P T I U S .
Planche 6. Fig. 2.
LES lièvres se di s t inguent t r è s - n e t t eme n t de tous les mammi f è r e s c o n n u s , et
constituent un genr e t r è s -na tur e l , qu'on p e u t caractériser par le système dent a i r e .
Il existe seize dent s à la mâ c h o i r e s u p é r i e u r e ; quatre sont incisives, les douz e
autres sont màchelières. La mâ c h o i r e inf é r i eur e en of f r e s e u l eme n t d o u z e , deux
incisives et dix mà che l i è r e s ; de p l u s , les incisives supé r i eur e s sont doubl e s , c'està
dire que c h a c u ne d'elles en a par de r r i è r e u n e aut r e plus petite. En f i n ces ani -
maux o f f r e n t dans leur j eune âge u n e particularité curieuse que M. Geof f roy-Sa int -
Hilaire a fait c o n n o i t r e le p r emi e r : « Le s lapins, dit-il (i), naissent et me u r e n t ave c
« quatre incisives, mais n o n avec les quatre même s : ils naissent ave c la p r emi è r e
» et la s e c o n d e paires; j)uis, c'est-à-dire quelques jours apr è s , arrive u n e aut r e pa i r e ,
« u n e troisième paire de dents. Ce s nouve l le s dent s finissent par acquérir un v o l ume ,
« et ])ar p r e n d r e , en s ' approchan t de très-près et par d emè r e de la p r emi è r e pa i r e ,
» u n e di r e c t ion qui ¡provoque et qui dé c ide la c h u t e de la de rni è r e paire i n t e rmé -
» diaire. La chut e de celle-ci ne se fait tout e foi s p o i n t sans un e n g a g eme n t , sans u n e
» sor t e de lutte : les deux paires de dent s sont mome n t a n éme n t en pr é s enc e ; il y a
» coexi s t enc e, d u r a n t (juelque t emp s , ties dent s qui v o n t t omb e r et de celles qui
» arrivent j)our en j î r endr e la place. Les lapins o n t d o n c six incisives d u r a n t u n e
» pe t i t e p é r i o d e qui est de deux à cin(| jours. Da n s ce mome n t de leur exi s t enc e , ils
» a jout ent ainsi à bien d'autres r appor t s qu'ils ont avec les ka ngur oos , un caractere
» de plus , le même n omb r e de dent s incisives. »
nracthts zoologiijiies, page 66. ( I ) Syslhne dailaire des u