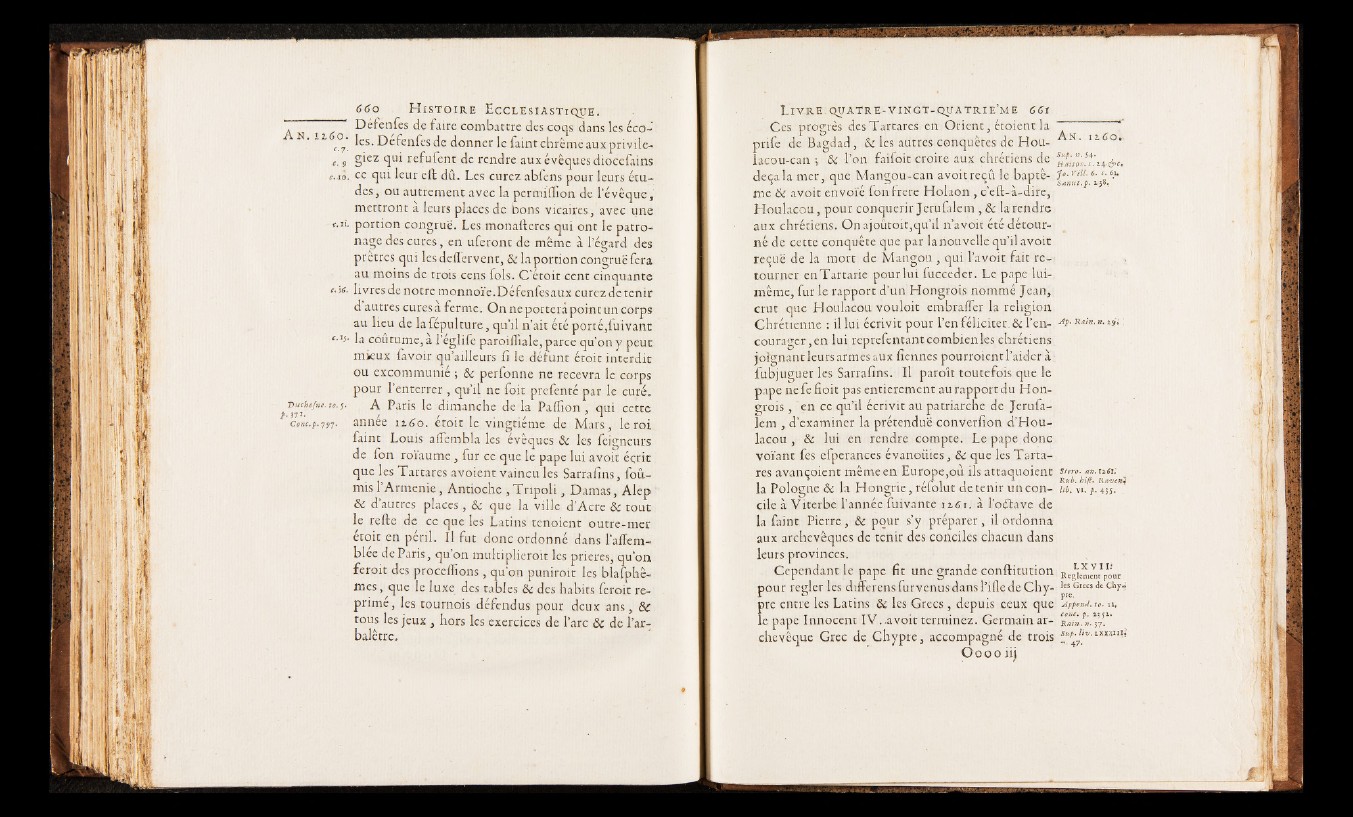
A n . i i 6 o .
c. 7 .
c. 9
C .S & .
Duchefne. to. $
P° 37*•
C o n c .p .7 9 7 .
6 6 o H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
Défenfes de faire combattre des coqs dans les écoles.
Défenfes de donner le faint chrême aux privilégiez
qui refufent de rendre aux évêques diocefains
ce qui leur eft dû. Les curez abfens pour leurs études,
ou autrement avec la permiffion de l’évêque,
mettront a leurs places de bons vicaires, avec une
g», portion congrue. Les.monafteres qui ont le patronage
des cures, en uferont de même à l’égard des
prêtres qui les deilervent, Sc la portion congrue fera
au moins de trois cens fols. C'étoit cent cinquante
><• livres de notre monnoïe.Défenfesaux curez de tenir
dautres curesaferme. Onneporterâpointun corps
au lieu de la fépulture, qu’il n’ait été porté,fuivant
c-‘s- la coutume, à l ’églife paroiffiale, parce qu’on y peut
mieux favoir qu’ailleurs fi le défunt étoit interdit
ou excommunié -, Sc perfonne ne recevra le corps
pour l ’enterrer , qu’il ne foit prefenté par le curé.
A Paris le dimanche de la Paffion , qui cette
année 1160. étoit le vingtième de Mars, le roi
faint Louis aflembla les évêques Si les feigneurs
de fon roiaume, fur ce que le pape lui avoir écrit
que les Tartares avoient vaincu les Sarrafins, fournis
l’Arménie, Antioche , T r ip o li, Damas, Alep
& d’autres places , Sc que la ville d’Acre & tout
le refte de ce que les Latins tenoient outre-mer
etoit en péril. Il fut donc ordonné dans l’affem-
blee de Paris, qu on multiplieroit les prières, qu’on
feroit des procédions, qu’on puniroit les blafphê-
ines, que le luxe des tables Sc des habits feroit reprime,
les tournois défendus pour deux ans, Sc
tous les jeux , hors les exercices de l’arc & de l’ar-
balêtre.
L i v r e q u a t r e - v i n g t - . q u a t r i e ’m e 6 6 1
Ces progrès des Tartares en Orient, étoient la ~ ! 1
prife de Bagdad, & les autres conquêtes de Hou- N' l l 6 °*
lacou-can ; Sc l’on faifoit croire aux chrétiens d^
deçalamer, que Mangou-can avoitreçû le baptê- 6-H ^
. H i H r c r 1 1 " B n. I m smut.f. 138, me & avoir envoie ion rrere H o laon , c elt-a-dire,
Houlacou, pour conquérir Jeruialem ,Sc la rendre
aux chrétiens. On ajoûtoit,qu’il n’avoit été détour-i
né de cette conquête que par la nouvelle qu’il avoit
reçue de la mort de Mangou , qui l’avoit fait re-;
tourner enTartarie pour lui fucceder. Le pape lui-
même, fur le rapport d’un Hongrois nommé Jean,
crut que Houlacou vouloit embraifer la religion
Chrétienne : il lui écrivit pour l’en féliciter. & l’en- At- R*<».
courager,en lui reprefentant combien les chrétiens
joignant leurs armes aux fiennes pourroient l’aider a
fubjuguer les Sarrafins. Il paroît toutefois que le
papenefefioit pas entièrement au rapport du Hongrois
, en ce qu’il écrivit au patriarche de Jerufa-
lem , d’examiner la prétendue converfion d’Hou-
lacou , Sc lui en rendre compte. Le pape donc
voïant fes efperances évanouies, Sc que les Tartares
avançoient même en Europe,où ils attaquoient H f l “».nér.
t 1 n i t t mm 1 1 • Rub. h iß . Raven} la Pologne & la Hongrie, reloluc détenir uncon- ub. n. p. 435.
cile à Viterbe l’année fui vante i z 6 i. à l’oètave de
la faint Pierre, Sc pour s’y préparer, il ordonna
aux archevêques de tenir des conciles chacun dans
leurs provinces.
Cependant le pape fit une grande conftitution.
pour regier les differensfurvenusdansl’ifledeChy- lcs Grecs de chn;
pre kentre les Latins Sc les Grecs, depuis ceux que uippend. il, * T rxr . ^ cone. p. xjji.
to. pape Innocent IV.-avoit terminez. Germain ar- 37.
chevêque Grec de Chypre, accompagné de trois lup^ 'v' iXI7‘11-
O o o o iij