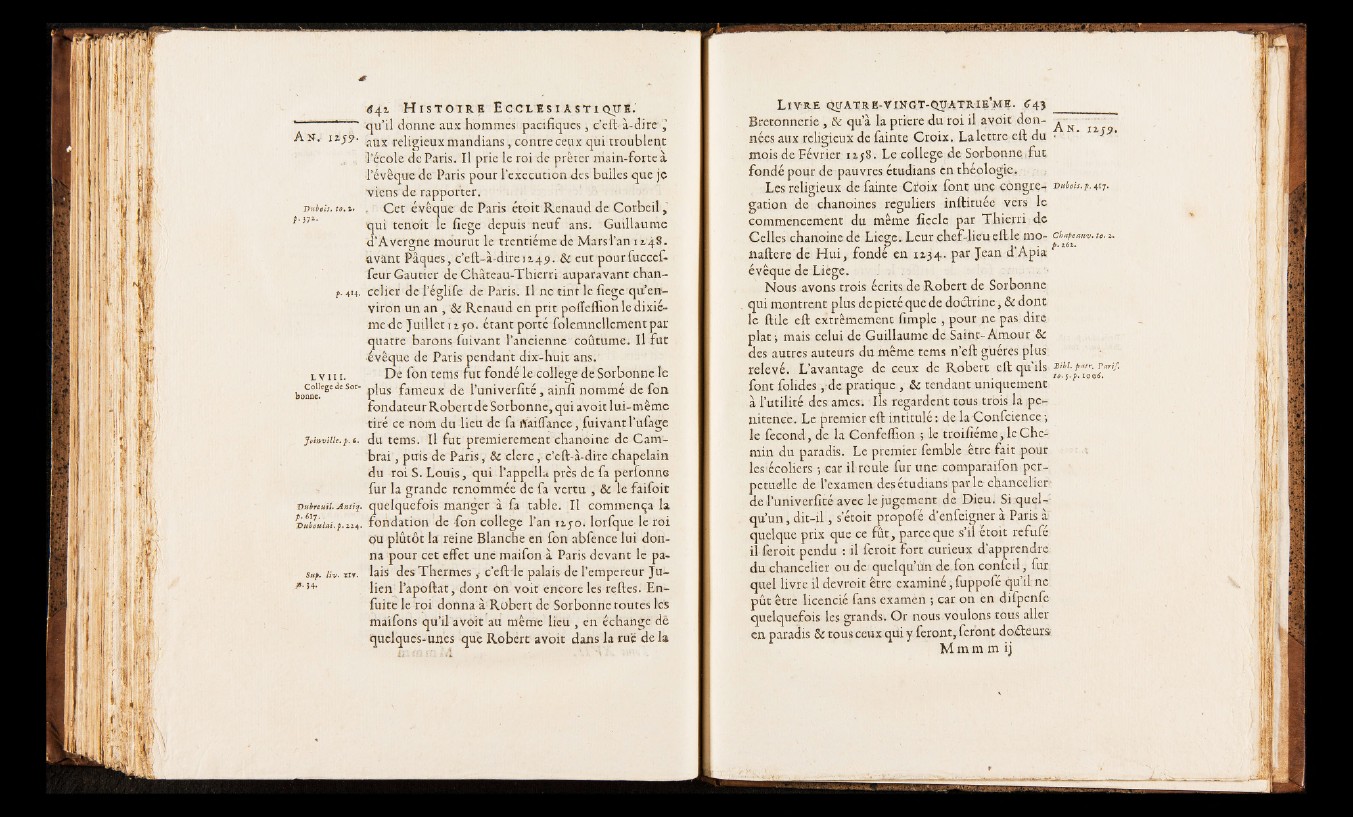
H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
' q u ’il donne aux hommes: pacifiques, c’e i t à-dire ,’
A n . HJ9. ;aux religieux mandians, contre ceux qui troublent
l ’école de Paris. I l prie le roi de prêter main-forte a
i’évêque de Paris pour l’execution des bulles que je
"viens d e rapporter.
vubds.n. ». . C e t évêque de Paris étoit Renaud de C o r b e i l ,
q u i tenoit le fiege depuis n eu f ans. Guillaume
d ’A v e rgn e mourut le trentième de Ma r s l’an 1 14 8 .
a vànt Pâques, ceft-à-dire 12.49. Sc eut pourfuccef-
feur Gautier de Château-Thierri auparavant chan-
}. 414. celier de l’églife de Paris. Il ne tint le fiege qu'env
iron un an , 8c Renaud en prit po ile ilion le dixie-
m ed e Juillet 1240. étant porté folemnellementpar
quatre barons fuivant l’ancienne coutume. Il fu t
■évêque de Paris pendant d ix -h u it ans.
l v 111. D e f ° n tems fu t fondé le collège de Sorbonne le
bonMcgcdcS°r" P^us fameux de l’u n iv e r fité , ainfi nommé de fo n
fondateur R o b e r t de Sorbonne, qui avoir lui-même
tiré ce nom du lieu de fa ftaiffance, fu ivant l’ufagc
Joinville. p. 6. du tems. Il fu t premièrement chanoine de C am b
r a i , puis de P ar is, 8c c le r c , c’eft-à-dirc chapelain
du roi S. L o u is , q u i l’appella près de fa perfonne
fur la grande renommée de fa ve rtu , & le fa ifo it
vubreuit. Antiq. quelquefois manger à fa table. Il commença la
vZbluUi.t-ii4. fond ation de fo n collège l’an 1240. lorfque le roi
du plutôt la reine Blartche en fon abfencc lui donna
pour cet effet une maifon à Paris devant le pa-
s»f. Uv. «y. lais des T h e rm e s ,- c’e iH e palais de l’empereur Ju-
-JM4‘ lien l’ap o fta t, dont ôn v o it encore les reftes. Enfuite
le roi donna à Robert de Sorbonne toutes les
maifons qu’il aVdit au même lieu , en échange de
quelques-unes que Ro b e r t a voit dans la rue de la
L i v r e q u a t r e - V i n g t - q u a t r i e ’m e . 6 4 3 __________
Bretonnerie , 8c qu’à la priere du roi il a vo it d on - jpwi ~ "
nées aux religieux de fainte C ro ix . La lettre eft du ■ W;
mois de Février 1158. Le collège de Sorbonne b u t
fondé pour de pauvres étudians en théologie.
Les religieux de fainte C ïo ix font une congre-. D«bns.?.v7.
gation de chanoines réguliers inftituée vers le
commencement du même fiecle par Thierri de
Celles chanoine de Liege. Leur chef-lieu eft le mo- chat'«»*- '»■ I
n 1» A ptZ6%»
naftere de H u i, fondé en 1134- par Jean d Apia
évêque de Liege.
Nous avons trois écrits de Ro b er t de Sorbonne
qui montrent plus de pieté que de d o c tr in e, 8c dont
le ftile eft extrêmement fimple , pour ne pas dire
plat y mais celui de Guillaume de Saint-Amour 8c
des autres auteurs du même tems n’eft g'uéres plus
relevé . L ’avantage de ceux de Ro b e r t eft qu’ils
font fo lid e s , de pratique , & tendant uniquement
à fu t ilité des atnes; Ils regardent tous trois la pénitence.
Le premier eft intitulé: de la C on fid ence v
le fécon d , de la C on feffion ; le troifiéme, le C h e min
du paradis. Le premier femble être fait pour
lesxcoliers ; car il roule fur une comparaifon per-!
petuellc de l’examen des étudians par le chancelier •
de l’univerfité avec le jugement de Dieu. Si quelqu’u
n , dit-il , s’étoit propofé d’enfeigner à Paris à:
quelque prix que ce fû t , parce que s’il etoit refufé
il feroit pendu : il feroit fort curieux d’apprendre
du chancelier ou de quelqu’un de fon c o n fe il, fur
quel livre il devroit être ex aminé, fuppofé qu’iln e
pût être licencié fans examen ; car on en difpenfe
quelquefois les grands. O r nous voulons tous aller
en paradis 5c tous ceux qui y feront, feront doéteursi
M m m m ij