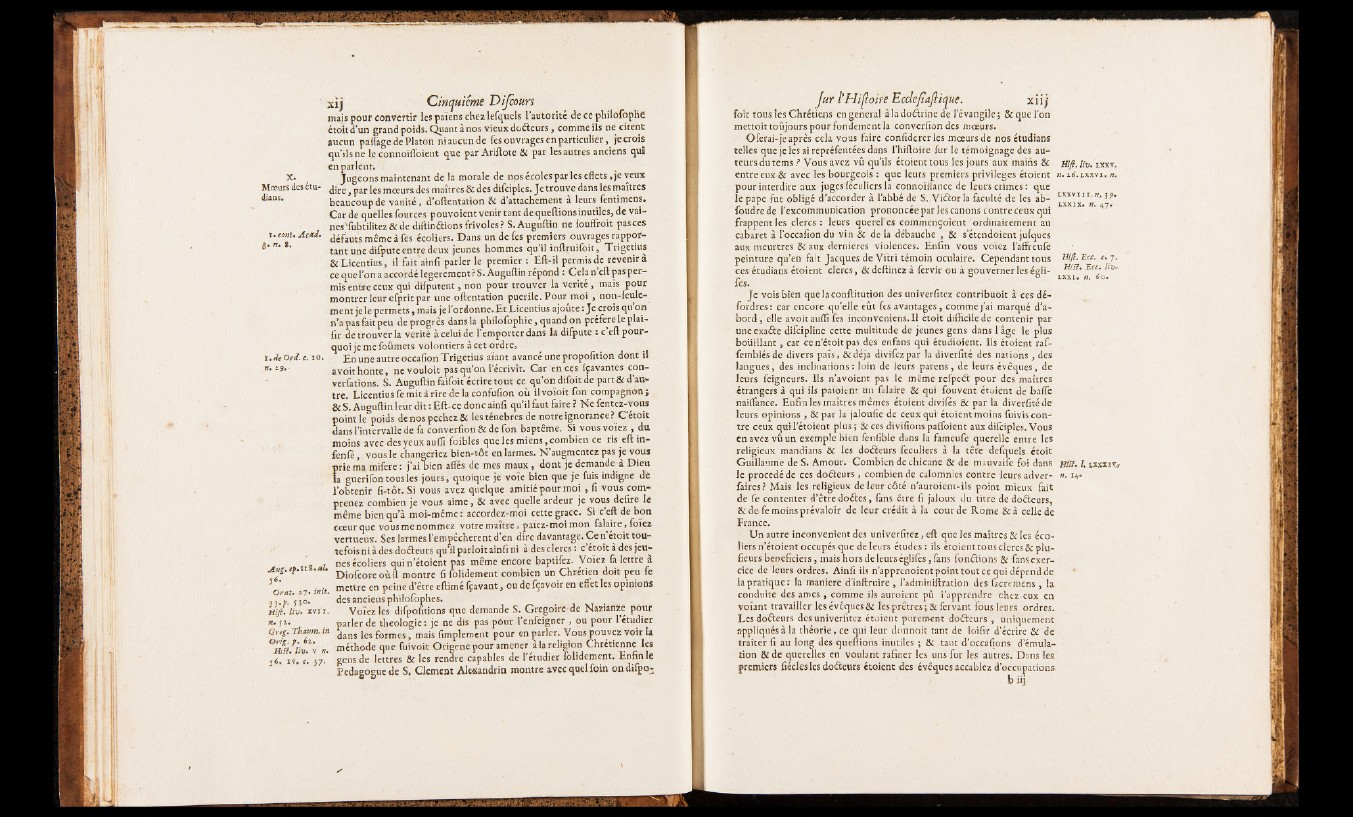
X.
Moeurs des étu-
dians.
i . coni. Acftd.
$• ». 2.
ï»deOrd. c. 10.
n» 2.9.
mais pour convertir les païens chezlefquels l'autorité de cê philofophÊ
étoit d’un grand poids. Quant à nos vieux d c â eu r s , comme ils ne citent
aucun paflàge de Platon ni aucun de Tes ouvrages en particulier, je crois
qu’ils ne le connoiffoient que par Ariftote & par les autres anciens qui
en parlent.
Jugeons maintenant de la morale de nos ecoles par les effets »je yeux
dire, par les moeurs des maîtres & des difciples. Je trouve dans les maîtres
beaucoup de vanité, d’oftentation 8c d attachement a leurs fentimens.
Car de quelles fources pouvoient venir tant de queftions inutiles, de vai-
nesTubtilitez 8cde diftin&ions frivoles? S. Auguftin ne ioufFroit pasces
défauts même à fes écoliers. Dans un de fes premiers ouvrages rapportant
A-ug,ef»u%»aU
56.
Orat. z y . init*.
33.p. 550.
iiift. liv . X V I I .
». $ z .
Qreg. Tha.um.in
©rig. p. 6z,
Hisf• liv. v ».
5 $ . i f * c . 3 7 .
une difpute entre deux jeunes hommes qu il inftj’u ifoit, Trigetius
8c Licentius, il fait'ainfi parler le premier : Eft-il permis de revenir a
ce que l’on a accordé legerement ? S. Auguftin répond : Cela n eft pas permis
entre ceux qui difputent, non pour trouver la vérité, mais pour
montrer leur efprit par une oftentation puerile. Pour moi , non-feulement
je le permets, mais je l’ordonne. E t Licentius ajoute : Je crois qu on
n’a pas fait peu de progrès dans la philofophie, quand on préféré le plai-
fir de trouver la vérité à celui de l’emporter dans la difpute : c’eft pourquoi
je me foûmets volontiers à cet ordre,
En une autre occafion Trigetius aïant avancé une propofition dont il
avoit honte, nevouloit pas qu’on 1 écrivit. Car en ces içavantes con-
verfations. S. Auguftin faifoit écrire tout ce qu’on difoit de part & d’au*-
tre. Licentius fe mit à rire de la confufion ou il voïoit fon compagnon ;
8c S. Auguftin leur dit : Eft-ce donc ainfi qu’il faut faire ? Ne fentez-yous
point le poids de nos pechez& lesténebres de notre ignorance ? C etoit
dans l’intervalle de fa converfion 8c de fon bapteme. Si vous voiez , du
moins avec des yeux auiïi foibles que les miens,combien ce ris eft in*-
fenfé, vous le changeriez bien-tôt en larmes. N ’augmentez pas je vous
prie ma mifere : j’ai bien ailés de mes maux , dont je demande à Dieu
la guéri fon tous les jours, quoique je voie bien que je fuis indigne dè
l ’obtenir fi-tôt. Si vous avez quelque amitié pour moi , fi vous comprenez
combien je vous aime, 8c avec quelle ardeur je vous defire le
même bien qu’à moi-même: accordez-moi cette grâce. Si c’eft de bon
coeur que vous me nommez votre maître, paiez-moimon falaire, foiez
vertueux. Ses larmes l’empêcherent d’en dire davantage. Ce n’étoit toutefois
ni à des do&eur s qu’il parloit ainfi ni à des clercs : c’étoit à des jeunes
écoliers qui n’étoient pas même encore baptifez. Voiez la lettre a
Diofcore où il montre fi folidement combien un Chrétien doit peu fe
mettre en peine d’être eftimé fçavant, ou de fçavoir en effet les opinions
des anciens philofophes.
Voiez les difpofitions que demande S. Gregoire de Nazianze pour
parler de théologie : je ne dis pas pôur l’enfeigner , qu pour 1 étudier
dans les formes, mais fimplement pour en parler. Vous pouvez voir la
méthode que fuivoit Origcne pour amener a la religion Chrétienne les
gens de lettres 8c les rendre capables de l’étudier folidement. Enfin le
Pédagogue de S, Clement Alexandrin montre avec quel foin ondifpo^
fait tous les Chrétiens en général à la doétrine de l’évangile; & que l’on
mettoit toûjours pour fondement la converfion des moeurs.
Oferai-je après cela vous faire confidererles moeurs de nos étudians
telles que je lésai repréfentées dans l’hiftoire fur le témoignage des auteurs
du tems Vous avez vû qu’ils étoienttous les jours aux mains 8c
entre eux-8c avec les bourgeois : que leurs premiers privilèges étoient ,
pour interdire aux juges féculiers la connoifiànce de leurs crimes : que
le pape fut obligé d’accorder à l’abbé de S.,Vi6torla faculté de les ab-
foudre de l ’excommunication prononcée par les canons contre ceux qui
frappent les clercs : leurs querel’es commençoient ordinairement au
cabaret à l’occafion du vin 8c de la débauche , 8c s etendoient jufques
aux meurtres 8c aux dernieres violences. Enfin vous voiez l’affreufe
peinture qu’en fait Jacques de V itri témoin oculaire. Cependant tous
ces étudians étoient clercs, 8c deftinez à fervir ou à gouverner les égli-
fes.
Je vois bien quelaconftitution des univerfitez contribuoit à ces dé-
fordres : car encore qu’elle eût fes avantages, comme j’ai marqué d’abord,
elle avoit auffi fes inconveniens.il étoit difficile de contenir par
une exaéte difeipline cette multitude de jeunes gens dans 1 âge le plus
bouillant, car cen’étoitpas des enfans qui étudioient. Us étoient raf-
femblésde divers pars, & déjà divifezpar la diverfité des nations , des
langues, des inclinations : loin de leurs parens, de leurs évêques, de
leurs feigneurs. Ils n’avoient pas le même refpeâ pour des maîtres
étrangers à qui ils païoient un falaire 8c qui fouvent étoient de baffe
naiffance. Enfin les maîtres mêmes étoient divifés & par la diverfité de
leurs opinions , 8c par la jaloufie de ceux qui étoient moins fuivis contre
ceux qui l’étoient plus ; 8c ces divifiorcs paffoient aux difciples. Vous
ênavez vûun exemple bien fenfible dans la fameufe querelle entre les
religieux mandians 8c les doéfceurs feculiers à la tête defquels étoit
Guillaume de S. Amour. Combien de chicane 8c de mauvaife foi dans
le procédé de ces doéleurs, combien de calomnies contre leurs adver-
faires? Mais les religieux de leur côté n auroient-ils point mieux fait
de fe contenter d’être doéies, fans être fi jaloux du titre de doéfceurs,
& de fe moins prévaloir de leur crédit à la cour de Rome 8c à celle de
France.
Un autre inconvénient des univerfitez, eft que les maîtres 8c les écoliers
n’étoient occupés que de leurs études : ils étoient tous clercs 8c plu-
fieursbeneficiers, mais hors de leurs églifes, fans fondions 8c fans exercice
de leurs ordres. Ainfi ils n’apprenoient point tout ce qui dépend de
la pratiquer la maniéré d’inftruire , l’adminiftration des facremens , la
conduite des ames , comme ils auroient pu l ’apprendre chez-eux en
voïant travailler les évêques 8c les prêtres; & fervant fous leurs ordres.
Les doéteurs des univerfitez étoient purement doéteurs , uniquement
appliqués à la théorie, ce qui leur donnoit tant de loifir d’écrire 8c de
traiter fi au long des queftions inutiles ; & tant d’occafions d’émulation
8c de querelles en voulant rafiner les uns fur les autres. Dans les
premiers fiédeslesdoéfceurs étoient des évêques accablez d’occupations
b i i i
Bifi. liv» LXXV.
». z 6. LXXVI. ».
L X X Y I I I .» , J 9 ,
lxxix. ». 47»
Hifi. Ecc. c. 7.
Hifï. Ecc. liv»
LXXI • », 6 0 .
B î ï ï . I. LXXXI'Yor
». 14.