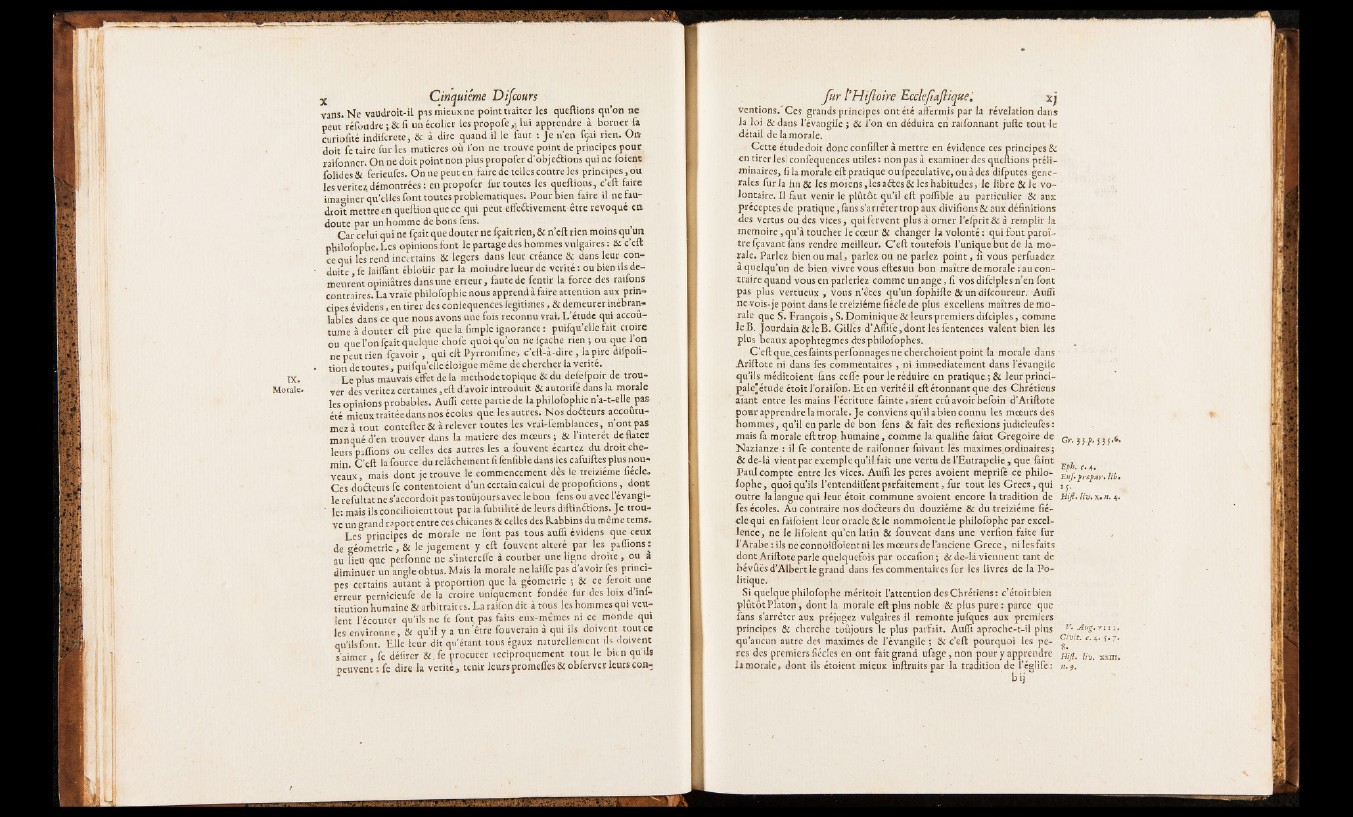
vans. N e vaudrait-il pas mieux ne point traiter les queftions qu’on né
peut réfoudre ;& f t un écolier les propofe ,j lui apprendre à borner fa
curiofité indifcrete, & à dire quand il le faut : Je tien fçai rien. On
doit fe taire fur les matières où l'on ne trouve point de principes pour
raifonner. On ne doit point non plus propofer d’objedtions qui ne foienü
folides & ferieufes. On ne peut en faire de telles contre les principes, ou
les veritez démontrées : en propofer fur toutes les queftions, c’eft faire
im a g i n e r qu’elles font toutes problématiques. Pour bien faire il ne faudrait
mettre en queftion que ce qui peut effeélivement être révoqué en
doute par un homme de bons fens. _
Car celui qui ne fçait que douter ne fçait rien, & n’cft rien moins qu’un
philofophe. Les opinions font le partage des hommes vulgaires : 8i c’eft
ce qui les rend incertains 8c légers dans leur créance & dans leur conduite
, fe laiflànt éblouir par la moindre lueur de vérité : ou bien ils demeurent
opiniâtres dans une erreur, faute de fentir la force des raifons
contraires. La vraie philofophie nous apprend à faire attention aux principes
évidens, en tirer des coniequences légitimés, & demeurer inébranlables
dans ce que nous avons une fois reconnu vrai. L ’étude qui accoû-
tume à douter efl pire que la fimple ignorance: puifqu’elle fait croire
ou que l'on fçait quelque chofe quoiqu’on nefçache rien ; ou que l’on
ne peut rien fçavoir , qui eft Pyrronifmes c eft-a-dire,. la pire difpoii-
tjon de toutes, puifqu’elle éloigne même de chercher la vérité.
Le plus mauvais effet de la méthode topique & du defefpoir de trouver
d e s v e r i t e z ce r ta in e s,e ft d'avoir introduit Scautotifé dans la morale
les opinions probables. Audi cette partie de la philofophie n’a-t-elle: pas
été m i e u x traitée dans nos écoles que les autres. Nosdoaeurs accoutumez
à tout contefter & à relever toutes les vrai-femblances, n'ont pas
manqué d'en trouver dans la matière des moeurs ; & l’intérêt de fiâtes
leurs psflions ou celles des autres les a fouvent écartez du droit chemin.
C ’eft lafource du relâchement fi fenfible dans les cafuiftes plus nouveaux,
mais dont je trouve le commencement dès le treizième fiécle.
Ces doâeursfe contentoient d’un certain calcul de propofitions, dont
le refultat ne s’accordoit pas touùjours avec le bon fens ou avec l'évangi-
' le: mais ils concilioient tout parlafubtilitédeleursdiftinâions. Je trouve
un grand raport entre ces chicanes & celles des Rabbins du même tems.
Les principes de morale ne font pas tous auffi évidens que ceux
de géométrie , & le jugement y eft fouvent altéré par les paffions:
au lieu que perfonne ne s’intereffe à courber une ligne droite, ou a
diminuer un angle obtus. Mais la morale ne laiffe pas d avoir fes principes
certains autant à proportion que la geometrie ; 8£ ce ferait une
erreur pernicieufe de la croire uniquement fondée lur des loix d’inf-
titution humaine 8c arbitraires. La railon dit à tous les hommes qui veulent
l’écouter qu’ils ne fe font, pas faits eux-mêmes ni ce monde qui
les environne, 8r qu’il y a un'être fouverain à qui ils doivent tout ce
qu’ils font. Elle leur dit quêtant tous égaux naturellement ils doivent
s’aimer , fe délirer 8c.fe procurer réciproquement tout le bien qu'ils
peuvent: fe dire la vér ité, tenir leurs promeffes 8c obferver leurs conventions/
Ces grands principes ont été affermis par la révélation dans
la loi & dans levangile ; 8c l’on en déduira en raifonnant jufte tout le
détail de la morale.
Cette étude doit donc confifter à mettre en évidence ces principes&
en tirer les; confequences utiles : non pas à examiner des queftions préliminaires,
fi la morale eft: pratique ouipeculative, ou à des difputes generales
furia fin& les moiens,lesa<5le s& les habitudes, le libre & le v o lontaire.
Il faut venir le plutôt qu’il elt poflible au particulier & aux
préceptes de pratique, fans s’arrêter trop aux divifions 8c aux définitions
des vertus ou des vices, qui fervent plus à orner l’efprit& à remplir la
mémoire, qu’à toucher le coeur 8c changer la volonté : qui font paroî-
tre fçavant fans rendre meilleur. C ’eft: toutefois l ’unique but de la morale.
Parlez bien ou mal, parlez ou ne parlez p o in t, fi vous perfuadez
a quelqu’un de bien vivre vous elles un bon maître demórale : au contraire
quand vous en parleriez comme un ange, fi vos difciples fi*en font
pas plus vertueux , vous n’êtes qu’un fophifte & un diieoureur. Aufli
ne-vois-je point dans le treizième fiécle de plus excellens maîtres de morale
que S. François, S. Dominique 8c leurs premiers difciples, comme
leB . Jourdain & le B. Gilles d’Aifife,dont les fentences valent bien les
plus beaux apophtegmes des philofophes.
C ’eíl quesees faints perfonnages ne cherchoient point la morale dans
Arillote ni dans fes commentaires , ni immédiatement dans levangile
qu’ils méditoient fans ceife pour le réduire en pratique ;& leurprinci-
pale^étude étoit l’oraifon. Et en vérité il eft étonnant que des Chrétiens
aïant entre les mains l ’écriture fainte, aient crû avoir befoin d’Ariftote
pour apprendre la morale. Je conviens qu’il a bien connu les moeurs des
hommes, qu’il en parie de bon fens 8c fait des reflexions judicieufes':
mais fa morale eft trop humaine, comme la qualifie faint Grégoire de
Nazianze : il fe contente de rationner fuivant lés maximes ordinaires ;
8c de-là vient par exemple qu’il fait une vertu de l’Eutrapelie, que faint
Paul compte entre les vices. Aufli les peres avoient meprifé ce philo-
io p h e , quoiqu’ils l’entendiffentparfaitement, fur tout les Grec s , qui
outre la langue qui leur étoit commune avoient encore la tradition de
fes écoles. Au contraire nos doêleurs du douzième 8c du treizième fiécle
qui enfaifoient leur oracle & le nommoientle philofophe par excellence,
ne le lifoient qu’en latin 8c fouvent dans une verfion faite fur
l ’Arabe : ils ne connoifloient ni les moeurs de l’anciene G r e c e , ni les faits
dont Ariftote parle quelquefois par occafion ; 8c de-lâ viennent tant de
bévûës d’Albert le grand dans fes commentaires fur les livres de la Politique.
Si quelque philofophe méritoit l’attention des Chrétiens: c’étoit bien
plutôt Platon , dont la morale eft plus noble 8c plus pure : parce que
fans s’arrêter aux préjugez vulgaires il remoftte jufques aux premiers
principes 8c cherche toujours le plus parfait. Aufli aproche-t-il plus
qu’aucun autre des maximes de l’évangile ; 8c c’eft pourquoi les peres
des premiers fiécles en ont Fait grand ufage,non pour y apprendre
la morale, dont iis étoient mieux inftruits par la tradition de l’églife;
Gr. 3 3 A- 5 3 5 «6*
2Iph. c. 4.
Euf.frApar» lib•
Hifi* liv. x. ». 4.
V. Aug. v i n ,
Civit. c. 4. f . p;
8.
Bifi. lii). x xni.
n .9 .