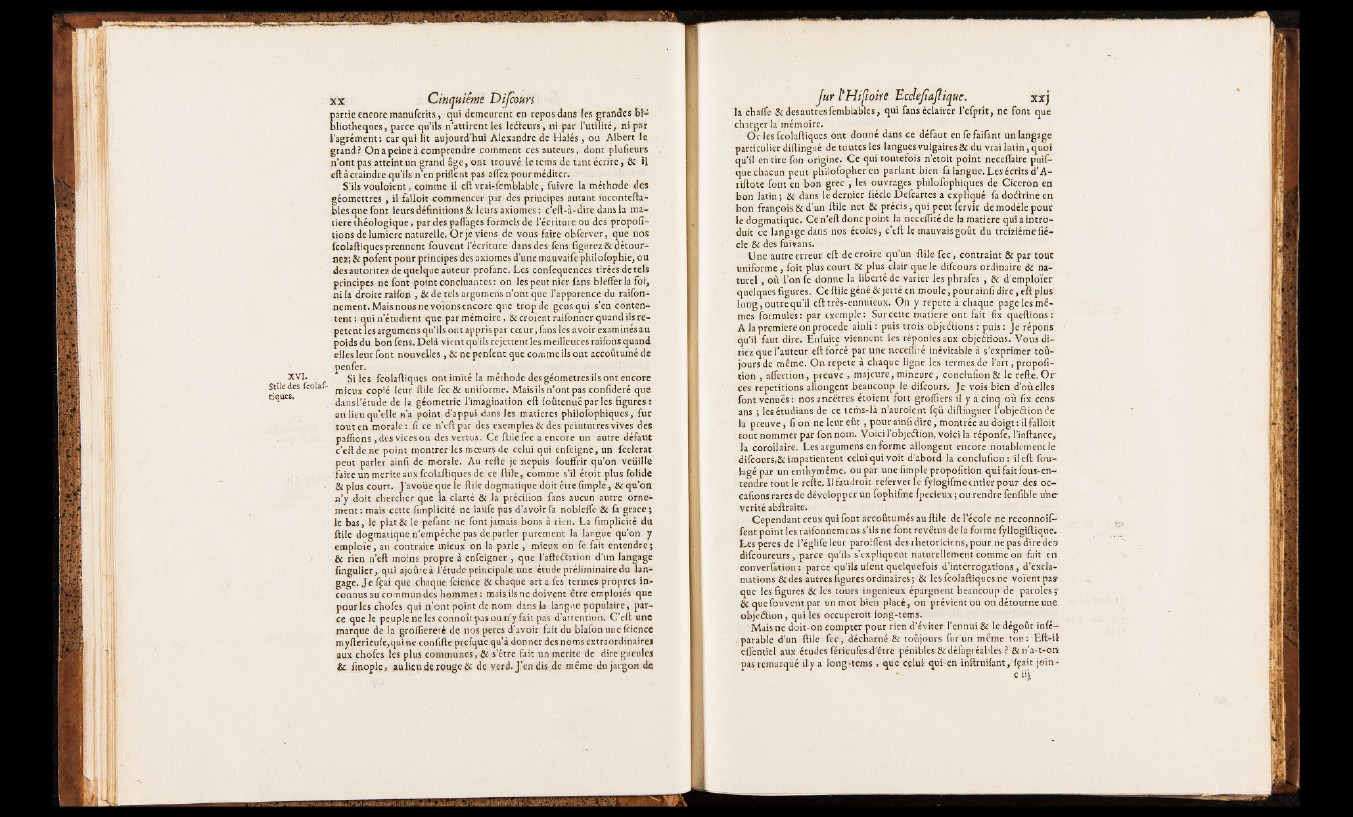
partie encore manufcrits, qui demeurent en repos dans les grandes bibliothèques,
parce qu’ils n'attirent les leâ eurs , ni par l’u tilité, ni par
l ’agrément: car qui lit aujourd’hui Alexandre de Halés , ou Albert le
grandi On a peine à comprendre comment ces auteurs, dont plufieurs
n’ont pas atteint un grand âge, ont trouvé le tems de tant écrire, & il
eft à craindre qu’ils n’en priflent pas allez pour méditer:
S’ils vouloient, comme il eft vrai-femblable, fuivre la méthode des
géomettres , il falloit commencer par des principes autant incontefta-
bles que font leurs définitions & leurs axiomes: c’eft-à-dire dans la matière
théologique, par des partages formels de l’écriture ou des propofi-
tions de lumière naturelle. O r je viens de vous faire obferver, que nos
fcolaftiques prennent fouvent l’écriture dans des fens figurez & détournez;
& pofent pour principes des axiomes d’une mauvaife philofophie, ou
des autoritez de quelque auteur profane. Les confequences tirées de tels
principes ne font point concluantes: on les peut nier fans bleflerla foi,
ni la droite raifop , & de tels argumens n’ont que l’apparence du raifon-
nement. Mais nous ne voïons encore que trop de gens qui s’en contentent:
qui n’étudient que par mémoire, & croient raifonner quand ilsre-
petent lesargumens qu’ils ont appris par coeur, fans les avoir examinés au
poids du bon fens. Delà vient qu’ils rejettent les meilleures raifons quand
elles leur font nouvelles ,&n ep en fcn tq ue comme ils ont accoutumé de
penfer.
Si les fcolaftiques ont imité la méthode des géomètres ils ont encore
a mieux copié leur ftile fec & uniforme. Mais ils n’ont pas confideré que
dans l’étude de la géométrie l’imagination eft foûtenuëparles figures:
au lieu qu’elle n’a point d’appui dans les matières philofophiques, fur
tout en morale: fi ce n’eftpar des exemples & des peintutres vives des
partions, des vices ou des vertus. Ce ftile fec a encore un autre défaut
c’eftdene point montrer les moeurs de celui qui enfeigne, un feelerat
peut parler ainfi de morale. Au refte je nepuis fouffrir qu’on veuille
faire un mérité aux fcolaftiques de ce ftile, comme s’il étoit plus folide
& plus court. J’avoüe que le ftile dogmatique doit être fimple, & qu’on
n’y doit chercher que la clarté & la préçilïon fans aucun autre ornement
: mais cette fimplicité ne laiife pas d’avoir fa nobleffe & fa grâce ;
le bas, le plat & le pefant ne font jamais bons à rien. La fimplicité du
ftile dogmatique n’empêche pas de parler purement la langue qu’on y
emploie, au contraire mieux on la parle , mieux on fe fait entendre;
& rien n’eft moins propre à enfeigner , que l’afteâation d’un langage
fingulier, qui ajoute à l’étude principale une étude préliminaire du langage.
Je fpai que chaque fcience & chaque art a fes termes propres inconnus
au commun des hommes: mais ils ne doivent être emploies que
pour les chofes qui n’ont point de nom dans la langue populaire, parce
que le peuple ne les connoîtpas ou n’y fait pas d’attention. C ’eft une
marque de la grofliereté de nos peres d’avoir fait du blafon une fcience
myfterieufe,qui ne confifte prefque qu’à donner des noms extraordinaires
aux chofes les plus communes, & s’être fait un mérité de dire gueules
& finople, au lieu de rouge & de verd. J’en dis de même du jargon de
la charte & des autres femblables, qui fans éclairer l’efprit, ne font que
charger la mémoire.
Or les fcolaftiques ont donné dans ce défaut en fe faifant un langage
particulier diftingué de toutes les langues vulgaires & du vrai latin, quoi
qu’il en tire fon origine. Ce qui toutefois n’étoit point neceflaire puif-
que chacun p e u t philofopheren parlant bien fa langue. Les écrits d’A -
riftote font en bon grec , les ouvrages philofophiques de Ciceron en
bon latin; & dans le dernier fiéde Defcartes a expliqué fa doéfrine en
bon françois & d'un ftile net & précis, qui peut fervir de modèle pour
le dogmatique. Ce n’eft donc point la neceftité de la matière qui a introduit
ce langage dans nos écoles, c’eft le mauvais goût du treizième fié-
cle & des fuivans.
Une autre erreur eft de croire qu’un ftile fe c , contraint & par tout
uniforme, foit plus court & plus clair que le difcours ordinaire de naturel
, où l ’on fe donne la liberté de varier les phrafes , Se d emploïer
quelques figures. Ceftilegénéôt jetté en moule ¿pour ainfi dire, eft plus
lo n g , outre qu’il efttrès-ennuieux. On y répété à chaque pagelesmê-
mes formules: par exemple: Sur cette matière ont fait fix queftionsr
A la première on procédé ainfi : puis trois objections : puis : Je répons
qu’il faut dire. Enfuite viennent les réponfesaux objeâions. Vous diriez
que l’auteur eft forcé par une neceflité inévitable à s'exprimer toû-
joursde même. O n répété à chaque ligne les termes de l’art, propofi-
tion , aflertion, preuve , majeure, mineure, conclufion8c le re fte .O r
ces répétitions allongent beaucoup le difcours. Je vois bien d’où elles
font venues: nos ancêtres étoient fort groflïers il y a cinq où fix cens
ans ; lesétudians de ce tems-là n’auroient fçû diftinguer l’objea:on de
la preuve, fi on ne leur eût , pour ainfi dire, montrée au doigt : il falloit
tout nommer par fon nom. Voici l’objection, voici la réponfe, l’inftance,
la corollaire. Les argumens en forme allongent encore notablement le
difcours,& impatientent celui qui voit d'abord la condufion : il eft fou-
lagépar un enthymême, ou par une fimple propofition qui fait fous-entendre
tout le refte. Il faudroit referver le fylogifmeentier pour des oc-
cafions rares de développer un fophifme fpecieux ; ou rendre fenfible une
vérité abftraite.
Cependant ceux qui font accoûtumés au ftile de l’école ne reconnoif-
fent point les raifonnemens s’ils ne font revêtus de la forme fyllogiftique.
Les peres de l’églife leur paroiflent des rhetoriciens, pour ne pas dire des
difeoureurs, parce qu’ils s’expliquent naturellement comme on fait en
eonverfation : parce qu’ils ufent quelquefois d’interrogations, d’exclamations
&des autres figures ordinaires ; & les fcolaftiques ne voient pas-
que les figures & les tours ingénieux épargnent beaucoup de paroles;
& que fouvent par un mot bien placé, on prévient ou cm détourne une
o b je â ion , qui les occuperoit iong-tems.
Mais ne doit-on compter pour rien d’éviter l’ennui & le dégoût infé-
. parable d’un ftile fe c , décharné & toûjours fur un même ton: Eft-il
eflentiel aux études férieufes d'être pénibles & défagréables ? & n’a-t-on-
pas remarqué il y a long-tems , que celui qur-en ihftruifant, içait jeinci'j: