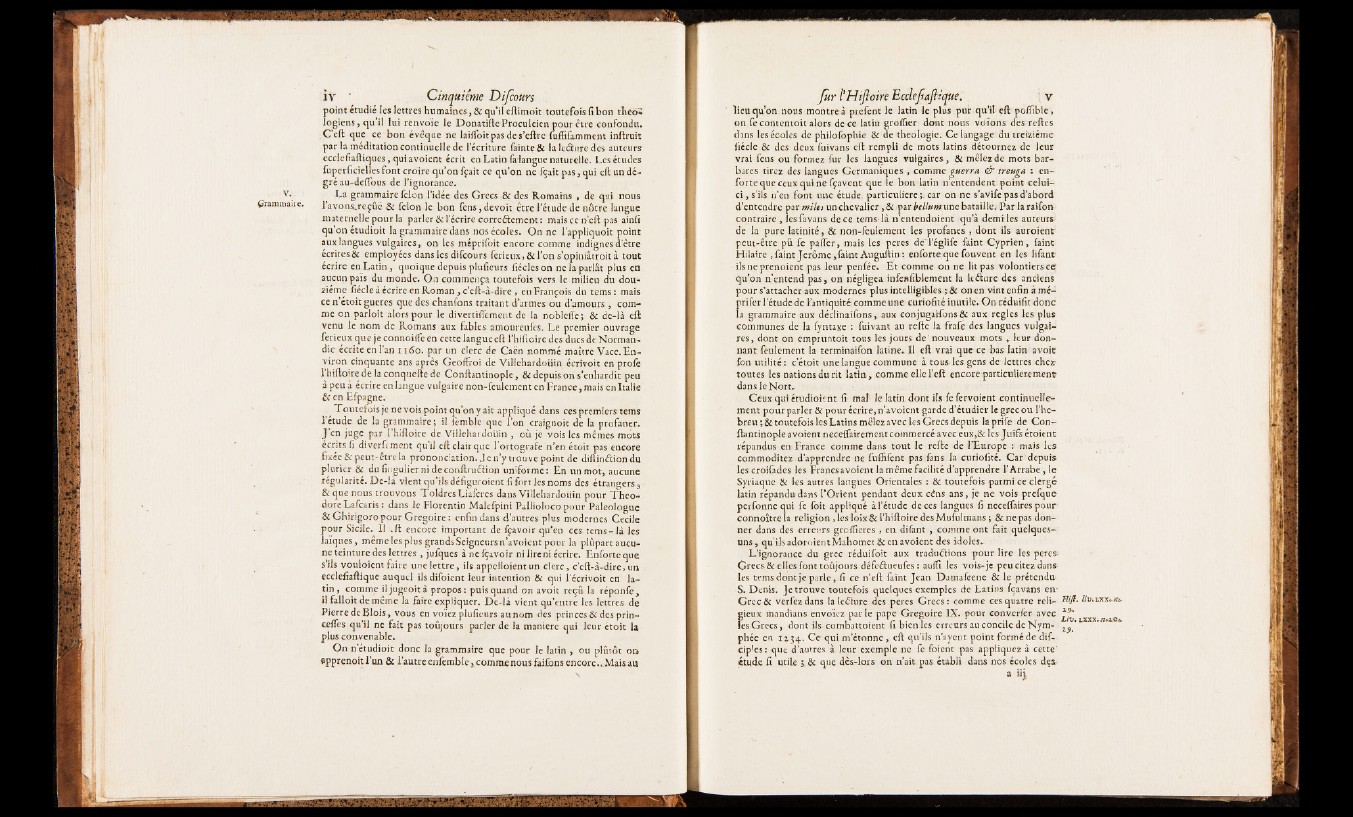
point étudié les lettres humaines, & qu’il eftimoit toutefois fi bon théoï
logiens, qu’il lui renvoie le Donatiile Proculeien pour être confondu.
C ’eft que ce bon évêque ne laiifoitpasdes’eftre fufïifamment inftruit
par la méditation continuelle de l'écriture fainte& la leâure des auteur?
eedefiaftiques, qui avoient écrit en Latin fa langue naturelle. Les études
fuperficielles font croire qu’on fçait ce qu’on ne fçait pas, qui eft un dé-
gré au-deflous de l’ignorance.
La grammaire ièlon l’idée des Grecs & des Romains , de qui nous
1 avons.reçûë & félon le bon fens,devoit être l’étude de nôtre langue
maternelle pour la parler & l’écrire correctement : mais ce n’eft pas ainiï
qu’on étudioit la grammaire dans nos écoles. On ne l ’appliquoit point
aux langues vulgaires, on les méprifoit encore comme indignes d’être
écrites & employées dans les difcours ferieux, & l’on s’opiniâtroit à tout
écrire en L atin, quoique depuis plufieurs fiécles on ne la parlât plus en
aucun pais du monde. On commença toutefois vers le milieu du douzième
fiecle a écrire en Roman, c’eil-à-dire > en François du tems : mais
ce n etoit gueres que des chanfons traitant d’armes ou d’amours , comme
on parloit alors pour le divertiifement de la nobleife; & de-là eft
venu le nom de Romans aux fables amoureufes. Le premier ouvrage
ferieux que je connoiife en cette langue eil l’hiftoire des ducs de Normandie
écrite en l’an 1160. par un clerc de Caen nommé maître Vace. En viron
cinquante ans après GeofFroi de Villehardoüin écrivoit en proie
1 hiiloire de la conquefte de Conftantinople, & depuis on s’enhardit peu
a peu à écrire en langue vulgaire non-feulement en France, mais en Italie
& en Efpagne.
Toutefois je ne vois point qu’on y ait appliqué dans ces premiers tems
1 etude de la grammaire ; il femble que l ’on cr^ignoit de la profaner.
J ’en juge par Thiiloire de Villehardoüin , où je vois les mêmes mots
écrits fi diverfement qu’il eft clair que l ’ortografe n’en étoit pas encore
fixée & peut-être la prononciation. J e n’y trouve point de diitinCtion du
plurier & du fingulier ni deconftruélion uniforme: En un mot, aucune
régularité. D e-là vient qu’ils défiguroient fi fort les noms des étrangers a
& que nous trouvons ToldresLiafcrcs dans Villehardoüin pour T h éo dore
Lafcaris : dans le Florentin Malefpini Pallioloco pour Paleologue
& Ghirîgoro pour Grégoire : enfin dans d’autres plus modernes Cecile
pour Sicile. Il vil encore important de fçavoir qu’en ces. tems-là les
laïques, mêmelesplus grands Seigneurs n’a voient pour la plûpart aucune
teinture des lettres , jufques à neiçavoir ni lire ni écrire. Enforteque
s’ils vouloient faire une lettre, ils appclloientun clerc, c’eil-à-dire, un
ecclefiaflique auquel ils difoient leur intention & qui ¡’écrivoit en latin
, comme iljugeoità propos: puis quand on avoit reçu la réponfe,
il faUoitdemême la faire expliquer. De-là vient qu’entre les lettres de
Pierre de Blois, vous en voïez plufieurs au nom des princes & des prin-
cefles qu’il ne fait pas toûjours parler de la maniéré qui leur étoit la
plus convenable.
On n’étudioit donc la grammaire que pour le latin , ou plûtôt on
apprenoitl’un & l ’autre cnfemblej,comme nous faifbns encore...Mais au
lieu qu'on nous montre à piefent le latin le plus pur qu’il eft pofiible.
on fe contentoit alors de ce latin groflier dont nous votons des relies
dins les écoles de philofophie & de théologie. Ce langage du treizième
liécle & des deux fuivans eft rempli de mots latins détournez de leur
vrai fens ou formez fur les langues vulgaires, & mêlez de mots barbares
tirez des langues Germaniques , comme guerra & treuga : en-
forte que ceux qui ne fçav.ent que le bon latin n’entendent point celui-
ci , s’ils n’en font une étude particulière car on ne s’avife pas d’abord
d’entendre par miles un chevalier, & par hélium une bataille. Par la raifom
contraire, lesfavans de ce tems-là n’entendoient qu’à demi les auteurs
de la pure latinité, & non-feulement les profanes , dont ils auroient
peut-être pû fe paffer, mais les peres deTéglife faint Cyprien, faint
Hilaire , faint Jerôme,, faint Auguftin : enforte que fouvent en les lifànt
ils ne prenoient pas leur penfée. Et comme on ne lit pas volontiers ce?
qu’on n’entend pas, on négligea infenfiblement la leâiure des anciens
pour s’attacher aux modernes plus intelligibles on en vint enfin à mé-
prifer l ’étude de 1 antiquité comme une curiofité inutile. On réduifit donc
la grammaire aux dédinaifons, aux conjugaifons & aux réglés les plus
communes de la fyntaxe : fuivant au relie la frafe des langues vulgaires,
dont on empruntoit tous les jours de' nouveaux mots r leur donnant
feulement la terminaifon latine. Il eft vrai que ce bas latin avoit
fon utilité: c etoit une langue commune à tous-les gens de lettres chez
toutes les nations du rit latin, comme elle l’eft encore particulièrement
dans le Nort.
Ceux qui étudioient fi mal le latin dont ils fe fervoient continuellement
pour parler & pour écrire, n’avoient garde d’étudier le grec ou Fhe-
b reu ;& toutefois les Latins mêlez avec les Grecs depuis laprife de C on-
ilantinople a voient neceiTairement commercé avec eux,& les Juifs étoient
répandus en France comme dans tout le relie de l’Europe gj mais les
commoditez d’apprendre ne fuffifent pas fans la curiofité. Car depuis
les croifades les Francs avoient la même facilité d’apprendre l’Arrabe, le
Syriaque & les autres langues Orientales : & toutefois parmi ce clergé
latin répandu dans l’Orient pendant deux céns ans, je ne vois prefque
perfonnequi fe foit appliqué à l’étude de ces langues fi necelfaires pour
connoître la religion , les loix & l’hiftoire des Mulülmans ; & ne pas donner
dans des erreurs grclfieres , en difant , comme ont fait quelques-
uns, qu’ils adoroient Mahomet & en avoient des idoles-
L ’ignorance du grec réduifoit aux traduélions pour lire les peres;
Grecs & elles font toujours défeâueufes : aufli les vois-je peu citez dans-
les tems dont je parle, fi ce n’ell faint Jean Damafeene & le prétendu
S. Denis. Je trouve toutefois quelques exemples de Latins fçavans eiv
G r c c& verfezdans la leéfcure des peres Grecs : comme ces quatre re ligieux
üiandians envoi.cz parle pape Grégoire IX. pour converfer avec
les Grecs, dont ils combattoient fi bien les erreurs au concile de N ym-
phée en 1234. Ce qui m’étonne, eft qu’ils n’ayent point formé de dif-
cipies: que d’autres à leur exemple ne fe foient pas appliquez à cette'
étude fi utile & que dès-lors on n’ait pas établi dans nos écoles dei-
Hifi. Uv'.
x%
LiVt LXXX. ff'&Ov
1^.