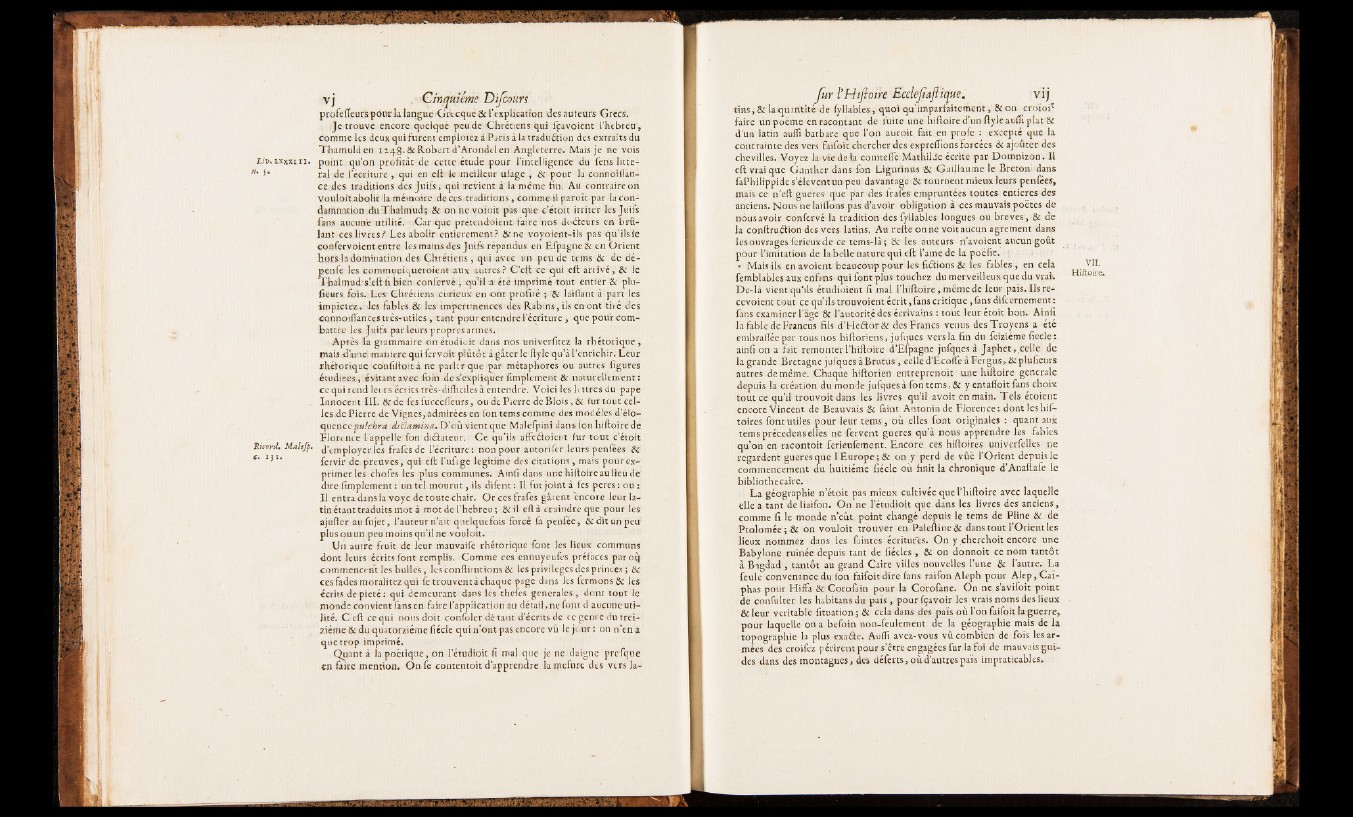
Liv . LXXXIII.
K. J.
Ricord, Malefp.
(. 131.
profeiTeurÿ pour la langue Griecqué & l'explication des auteurs Grecs.
Je trouve encore,quelque peu de 'Chrétiens qui fçavoient l’hebreu,
comme les deux qui furent employiez à Paris à la traduction des extraits du
Thamulden 1248» & Robert d’Arondd en Angleterre. Mais je ne vois
point quon profitât de cette étude pour l'intelligence du fens littéral
de l’écriture , qui en eft: ■ le «meilleur ufage , & pour la connoiflan-
ce .des traditions des Juifs, qui revient à la même fin. Au contraire011
vouloïtabolir la -mémoire de ces. traditions, comme il paroît par la condamnation
du Thalmudi; & on ne voioit pas que c’étoit irriter les Juifs
fans aucune utilité. Car que prétendoient-faire nos doâeurs-en brûlant
ces livres/ Les abolir entièrement? & n e voyoient-ils pas q u ’ilsle
confervoient entre les mains des Juifs répandus en Efpagne& en Orient
hors la domination, des; Chrétiens, qui avec un peu de tems & de dé-
penfe les tommuciqueroient aux autres? C ’eft ce qui eft: arrivé, & le
Tfialmud s-eft fi bien confervé, qu’il a été imprimé tout entier & plu-
fieurs fois.'Les-Chrétiens curieux en ont profité ; & laiilant à part les
impietez, les fables & les impertinences des Rab.ns, ils en ont tiré des
connoiflânces très-utiles , tant pour entendre l’écriture , que pour combattre
les Juifs par leurs propres armes.
Après la grammaire on étudioit dans nos univerfitez la rhétorique,
mais dxine; maniéré qui fervo'it plutôt à gâter le ilyle qu’à l'enrichir. Leur
rhétorique confiftoità ne parler que par métaphores ou autres figures
étudiées,, évitant avec foin de s’expliquer Amplement & naturellement:
ce qui rend leurs écrits très-difficiles à entendre. Voici les lettres du pape
Innocent III. & d c fes fuccefleurs, o u d eP ie r red eB lo is ,& fur tout celles
de Pierre de Vignes,admirées en fon tems comme des modèles d’éloquencepulchra
diBamina. D ’où vient que Malefpini dans ion hiftoire de
Florence l ’appelle fon diâateur. Ce qu’ils affeèloient fur tout c’étoit
d’employer les frafesde l’écriture: non pour âutorifer leurs penfées 6c
fervir de. preuves, qui eft l'ufage légitimé des citations, mais pour exprimer
les chofes les plus communes. Ainfi dans une hiftoire au lieu de
dire fimplement : un tel mourut, ils difent : Il fut joint à fes peres : ou :
Il entra dans la voye de toute chair. Orcesfrafes gâtent encore leur latin
étant traduits mot à mot de l’hebreu ; & il eft à craindre que pour les
ajufter aufujet, l'auteur n’ait quelquefois forcé fa penfée, & dit un peu
plus ou un peu moins qu’il ne vouloit.
Un autre fruit de leur mauvaife rhétorique font les lieux communs
dont leurs écrits font remplis. Comme ces ennuyeufes préfaces par 011
commencent les bulles, lesconftirutions& les privilèges des princes ; &
ces fades moralitez qui fe trouvent à chaque page dans les fermons & les
écrits de pieté : qui demeurant dans les thefes générales, dont tout le
monde convient fans en faire l’application au détail, ne font d aucune utilité.
C ’eft ce qui nous doit confoler dè tant d’écrits de ce genre du treizième
& du quatorzième fiécle qui n’ont pas encore vû le jour : on n’en a
que trop imprimé.
Quant à la poétique, on l’étudioit fi mal que je ne daigne prefque
en faire mention. O n fe contentoit d’apprendre lamefure des vers la
« J " ;
tins, & la quantité de fyllables, quoi qu'imparfaitement, & on cro-ioi*
faire un poeme en racontant de fuite une hiftoire d’un ftyleauffi plat &
d’un latin auffi barbare que l’on auroit fait .en proie : excepté que la
contrainte des vers faifoit chercher des expreftions forcées 6c ajouter des
chevilles. Voyez la-vie de la comteife Mathilie écrite par Domnizon. Il
eft vrai que Gunther dans fon Ligutinus & Guillaume le Breton' dans
faPhilippide s’élèvent un peu davantage & tournent mieux leurs penfées,
mais ce n’eft gueres que par des fraies empruntées toutes entières des
anciens. Nous ne laiflons pas d?avoir obligation à ces mauvais poètes dé
nous avoir conftrvé la tradition des fyllables longues ou brèves , & de
la conftruâion des vers latins. Au refte on ne voit aucun agrément dans
les ouvrages ferieux de ce tems-là; 6c les auteurs n’avoient aucun goût
pour l’imitation de la belle nature qui eft: l’ame de la poëfie. ;
• Mais ils en av oient beaucoup pour les fièlions & les fables, en cela
femblables aux erlfans qui font plus touchez du merveilleux que du vrai»
De-là vient qu’ils étudioient fi mal l’hiftoire, même de leur pais. Ils re-
cevoient tout ce qu’ils trouvoient écrit, fans critique, fans difeernement :
fans examiner l’âge & l ’autorité des écrivains : tout leur étoit bon. Ainfi
la fable de Francus fils d’H e d o r& des Francs venus desTroyens a été
embraffée par tous nos hiftoriens, jufques vers la fin du feiziéme fiecle:
ainfi on a fait remonter l’hiftoire d’Efpagne jufques à Japhet,.celle de
la grande Bretagne jufques à Brutus, celle d’Ecoffe à Fcrgus, & plufieurs
autres de même. Chaque hiftorien entreprenoit une hiftoire générale
depuis la création du monde jufques à fon tems, & y entafloit fans choix
tout ce qu’il trouvoitdans les livres qu’il avoit en main. Tels étoienr
encore Vincent de Beauvais & faint Antoninde Florence: dont les histoires
font utiles pour leur tems, où elles font originales : quant aux
tems précedenselles né fervent gueres qu’à nous apprendre les fables
qu’on en racontoit ferieufement. Encore ces hiftoires univerfelles ne
regardent gueres que l ’Europe; & On y perd de vûe l’Orient depuis le
commencement du huitième fiécle où finit la chronique d’Anaftafe le
bibliothécaire.
La géographie n’étoit pas mieux cultivée que l’hiftoire avec laquelle
elle a tant de liaifon. On ne l ’étudioit que dans les livres des'anciens,
comme fi le monde n’eût point changé depuis le tems de Pline & de
Pto lom é e ;& on vouloit trouver en Paleftine& dans tout l’Orient les
lieux nommez dans les laintes écritures. On y cherchoit encore une
Babylone ruinée depuis tant de iiécles , 6c on donnoit ce nom tantôt
à Bagdad, tantôt au grand Caire villes nouvelles l’une & l’autre. La
feule convenance du fon faifoit dire fans raifon Aleph pour Alep, Cai-
phas pour Hiffa & Corofain pour la Corofane. On ne s’avifoit point
de confulter les habitansdu pais, pourfçavoir les vrais noms des lieux
& leu r véritable fituation; & cela dans des pais où l’on faifoit la guerre,
pour laquelle on a befoin non-feulement de la géographie mais de la
topographie la plus exa&e. Auifi avez-vous vu combien de fois les armées
des croifez périrent pour s’être engagées fur la foi de mauvais guides
dans des montagues, des déferts, où d’autres païs impraticables.
VII.
Hiftoire.