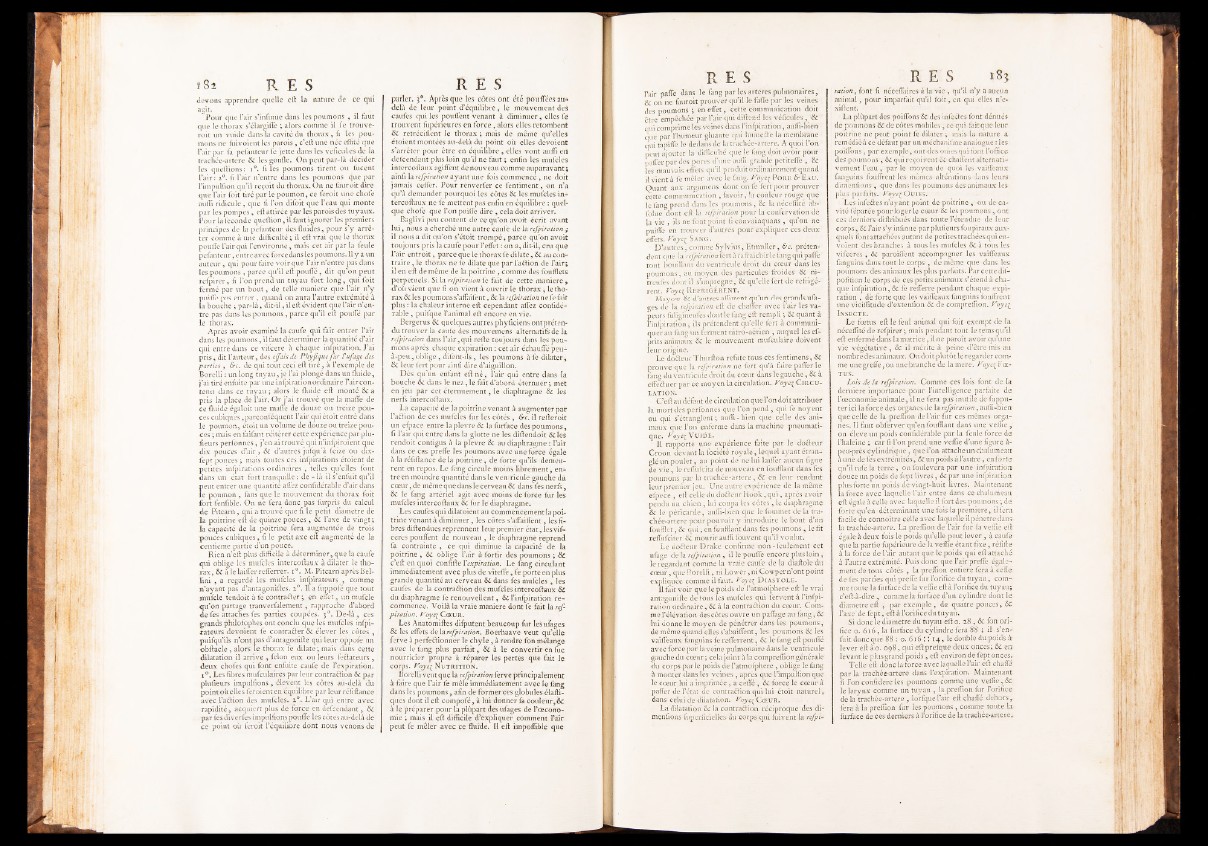
devons apprendre quelle eft la nature de ce qui
agit.
Pour que l’air s’infinue dans les poumons , il faut
que le thorax s’élargiffe ; alors comme il i e trouveront
un vuide dans la cavité du thorax, II les poumons
ne fuivoient les parois , c’eft une née eflité que
l’air par fa pefanteur fe jette dans les veficiilës de la
trachée-artere & les gonfle. On peut par-là décider
les queftions: i°. li les poumons tirent ou fucent
l’air : 20. fi l’air n’entre dans les poumons <jue par
l’impidfion qu’il reçoit du thorax. On ne fauroit dire
que l’air foit tiré par le poumon, ce feroit une chofe
aufli ridicule, que fl l’on difoit que l’eau qui monte
par les pompes, eft attirée par les parois des tuyaux.
Pour la fécondé queftion, il faut ignorer les premiers
principes de la pefanteur des fluides, pour s’y arrêter
comme à une difficulté ; il eft vrai que le thorax
poulie l’air qui l’environne, mais cet air par la feule
pefanteur, entre avec force dans les poumons. Il y a un
auteur, qui pour faire voir que l’air n’entre pas dans
les poumons , parce qu’il eft pouffe, dit qu’on peut
refpirer, fi l ’on prend un tuyau fort long, qui foit
fermé par un bout, de telle maniéré que l’air n’y
puiffe pas entrer , quand on aura l’autre extrémité à
la bouche ; par-là, dit-il, il eft évident que l’air n’entre
pas dans les poumons, parce qu’il eft pouffe par
le thorax.
Après avoir examiné la caufe qui fait entrer l’air
dans les poumons, il faut déterminer la quantité d’air
qui entre dans ce vifeere à chaque inspiration. J’ai
pris, dit l’auteur, des eff'ais de Phyfîque fur Puf âge des
parties , &c. de qui tout ceci eft tiré, à l’exemple de
Borelli : un long tuyau, je l’ai plongé dans un fluide,
j’ai tiré enfuite par une infpiration ordinaire l’air contenu
dans ce tuyau ; alors le fluide eft monté & a
pris la place de l’air. Or j’ai trouvé que la mafle de
ce fluide égaloit une mafle de douze ou treize pouces
cubiques ,parconféquent l’air qui étoit entré dans
le poumon, étoit un volume de douze ou treize pouces
; mais en faifant réitérer cette expérience par plu-
fieurs performes, j’en ai trouvé qui n’infpiroient que
dix pouces d’a ir , & d’autres jufqu’à feize ou cüx-
fept pouces ; mais toutes ces infpirations étoient de
petites infpirations ordinaires , telles qu’elles font
dans un état fort tranquille : de - là il s’enfuit qu’il
peut entrer une quantité afl'ez confidérable d’air dans
le poumon , fans que le mouvement du thorax foit
fort fenfible. On ne fera donc pas furpris du calcul
de Pitcarn, qui a trouvé que fi le petit diametré de
la poitrine eft de quinze pouces , 6c l’axe de vingt ;
la capacité de la poitrine fera augmentée de trois
pouces cubiques, fi le petit axe eft: augmenté de la
centième partie d’un pouce.
Rien n’eft plus difficile à déterminer, que là caufe
qui oblige les mufcles intercoftaux à dilater le thorax,
& à le laiffer refferrer. i° . M. Pitcarn après Bel-
lini , a regardé les mufcles infpirateurs , comme
n’ayant pas d’antagoniftes. 2°. Il a fuppofé que tout
mufcle tendoit à fe contrafter ; en effet, un mufcle
qu’on partage tranverfalement, rapproche d’abord
de fes attaches fes parties coupées. 30. De-là, ces
grands philofophes ont conclu que les mufcles infpirateurs
dévoient fe contracter 6c élever les, côtes ,
puifqu’ils n’ont pas d’antagonifte qui leur oppofe un
obftade , alors le thorax fe dilate ; mais dans cette
dilatation il arrive , félon eux ou leurs feclateurs ,
deux chofes qui font enfuite caufe de l’expiration.
i ° . Les fibres mufculaires par leur contraction 6c par
plufièurs impulfions, élevent les côtes au-delà du
point où elles feroient en équilibre par leur réfiftance
avec l’a'Ction des mufcles., 20. L’air qui entre avec
rapidité, acquiert plus de force en defeendant, 6c
par fes diverfes impulfions pouffe les côtes au-delà de
ce point où feroit l’équilibre dont nous venons de
parler. 30. Après que les côtes ont été pouffées au*
delà de leur point d’équilibre,- lé mouvement deà
caufes qui les pouffent venant à diminuer, elles fë
trouvent fupérieures en forc e , alors elles retombent
6c retrécifl'ent le thorax ; niais de même qu’elles
étoient montées au-delà du point où elles dévoient
s’arrêter pour être en équilibre , elles vont aufli eri
defeendant plus loin qu’il ne faut ; enfin les mufcles
intercoftaux agiffent de nouveau comme auparavant;
ainfi la refpiration ayant une fois commence , ne doit
jamais ceffer. Pour renverfer ce fentimerit, on n’a
qu’à demander pourquoi les côtes 6c les miifcles in*
tëreoftaux ne fe mettent pas enfin en équilibre : quel*
que chofe que l’on puiffe dire , cela doit arriver.
Baglivi peu content de ce qu’on avoit écrit avant
lui, nous a cherché une autre caufe de là refpiration ;
il nous a dit qu’on s’étoit trompé * parce qu’on avoit
toujours pris la caufe pour l’effet : on a, dit-il, cru que
l’air entroit, parce que le thorax fe dilate, 6c au con*
traire, le thorax ne le dilate que par l’aéHon de l’air;
il en eft de même de la poitrine, comme des foufflets
perpétuels. Si la refpiration fe fait de cette maniéré ;
d’où vient que fi on vient à ouvrir le thorax ; le thorax
6c les poumons s’aflaifent, & la refpiration ne fe fait
plus : la chaleur interne eft cependant affez confidérable
, puifque l’animal eft encore en vie.
Bergerus 6c quelques autres phyficiens ontpréten-
du trouver la caulè des mouvemens alternatifs de la
refpiration dans l’air, qui refte toujours dans les poumons
après chaque expiration : cet air échauffé peu*
à-peu, oblige , dilent-ils, les poumons à fe dilater 9
6c leur fert pour ainfi dire d’aiguillon.
Dès qu’un enfant eft n é , l’air qui entre dans la
bouche & dans le nez, le fait d’abord éternuer ; met
en jeu par cet éternuement, le diaphragme 6c les
ne rfs intercoftaux.
La Capacité de la poitrine venant à augmenter par
fa c t io n de ces mufcles fur le s côtés , &c. il refteroit
un éfpace entre la plevre & la furface des poumons,
fi l’air qui entre dans la glotte ne les diftendoit & le s
rendoit contigus à la plevre 6c au diaphragme : l’ait
dans ce cas preffe les poumons avec une forée égale
à la réfiftance de la poitrine, de forte qu’ils demeurent
en repos. Le fang circule moins librement, en*
tre en moindre quantité dans le ven;ricule gauche du
coeur, de même que dans le cerveau & dans fes nerfs ,
6c le fang artériel agit avec moins de force fur les
mufcles intercoftaux 6c fur le diaphragme.
Les caufes qui dilatoient au commencement la poitrine
venant à diminuer, les côtes s’affaiflënt, les fibres
diftendues reprennent leur premier état, les vif-
ceres pouffent de nouveau , le diaphragmé reprend
fa contrainte , ce qui diminue la capacité de la
poitrine , 6c oblige l’air à fortir des poumons ; &
c’eft en quoi confine l’expiration. Le fang circulant
immédiatement avec plus de vîteffe, fe porte en plus
grande quantité au cerveau 6c dans fes mufcles , les
caules de la contraftion des mufcles intercoftaux 6c
du diaphragme fe renouvellent, 6c l’infpiration recommence.
Voilà la vraie maniéré dont fe fait la refpiration.
Voye\ C oeur.
Les Anatomiftes difputent beaucoup fur lesufages
6c les effets delà refpiration. Boerhaave veut qu’elle
ferve à perfeélionner le ch y le , à rendre fon mélangé
avec le firng plus parfait, & à le cônvërtirëhfiic
nourricier propre à réparer les pertes que fait le
côrps. Voye[ Nu trit ion.
Borèlli veut que la refpiration ferve pfincipalemeht
à faire que l’air fe mêle immédiateiffiënt avec le fang
dans les poumons, afin de formerées globules élafti-
quès dont il eft compofé, à lui donner fa couleur,ôc
à le préparer pour la plupart des ufages de l’oeconb-
mie ; mais il eft difficile d’expliquer comment l’àir
peut fe mêler avec ce fluide. Il eft impoflïble que
l’air paffe dans le fang par les artères pulmonaires,
6c on ne fauroit prouver qu’il le faffe par les veines
des poumons ; en effet, cette communication doit
être empêchée par l’air qui diftend les véficules, 6c
qui comprime les veines dans l’infpiration, aiiffi-bien
que par l’humeur gluante qui humefte la membrane
qui tapiffe le dedans de' la trachée-artere. A quoi l’on
peut ajouter la difficulté que le fang doit avoir pour
paffer par des pores d’une aufli grande petiteffe , 6c
les mauvais effets qu’il produit ordinairement quand
il vient à fe mêler avec le fang. Voye^ Pore & Eau.
Quant aux argumens dont on fe fert pour prouver
cette communication , favoir,ila couleur rouge que
le fang prend dans les poumons, 6c la néceffite àb-’
folue dont eft la refpiration pour la confervation dé
là vie , ils ne font point fi convainquans , qu’on ne
puiffe en trouver d’autres pour expliquer ces deux
effets. Foye^ San g . ..
D ’autres, comme Sylvius, Etmuller, &c. prétendent
que la refpiration lert à rafraîchir le fang qui paffe
tout bouillant du ventricule droit du coeur dans les
poumons , au moyen des particules froides 6c ni-
treufes dont il s’imprégne, 6c qu’elle fert de réfrigèrent.
Voye\ Réfrigèrent.
Mayow 6c d’autres affurent qu’un des grands ufages
de la refpiration eft de chafler avec l’air les vapeurs
fuligineufes dont le fang eft rempli ; 6c quant à
l’infpiration, ils prétendent qu’elle fert à communiquer
au fang un ferment nitro-aërien , auquel les ef-
prits animaux 6c le mouvement mufculaire doivent
leur origine.
Le doûeur Thurfton réfuté tous cès fentimens, 6c
prouve que la refpiration ne fert qu’à faire paffer le
fang du ventricule droit du coeur dans le gauche, 6c à
effeftuer par ce moyen la circulation. Voye^ C ircula
t ion .
C’eft au défaut de circulation que l’on doit attribuer
la mort des perfonnes que l’on pend , qui fe noyent
ou qui s’étranglent; aufli-bien que celle des animaux
que l’on enferme dans la machine pneumatique.
VoyefV uide.
Il rapporte une expérience faite par le doâeur
Croon devant la fociété royale, lequel ayant étranglé
un poulet, au point de ne lui laiffer aucun figne
de v ie , le reffufeita de nouveaii en foufflant dans fes
poumons par la trachée-artere, 6c en leur rendant
leur premier jeu. Une autre expérience de la même
efpece , eft celle du doûeur H ook, q ui, après avoir
pendu un chien, lui coupa les côtes , le diaphragme
& le péricarde, auffi-bien que le fommet de la trachée
artere pour pouvoir y introduire le bout d’un
foufflet, 6c qui, en foufflant dans fes poumons , le fit
refl'ufciter 6c mourir aufli fouvent qu’il voulut.
Le dofteur Drake confirme non - feulement cet
ufage de la refpiration, il le pouffe encore plus loin,
le regardant comme la vraie caufe de la diaftole du
coeur, que Borelli, niLower, ni Covpern’ont point
expliquée comme il faut. Voye% D ia sto le .
Il fait voir que le poids de l’atmofphere eft le vrai
antagonifte de tous les mufcles qui fervent à l’infpiration
ordinaire, 6c à la contrattion du coeur. Comme
l’élévation des côtes ouvre un paffage au fang, 6c
lui donne le moyen de pénétrer dans les poumons ,
de même quand elles s’abaiffent, les poumons 6c les
vaiffeaux fanguins fe refferrent, 6c le fang eft pouffé
avec force par la veine pulmonaire dans le ventricule
gauche du coeur ; cela joint à la compreflion générale
du corps par le poids de l’atmofphere , oblige le fang
à monter dans les veines , après que l’impulfion que
le coeur lui a imprimée, a ceffé , 6c force le coeur à
paffer de l’état de contra&ion qui lui étoit naturel,
dans celui de dilatation. Voye^ C oeur.
La dilatation 6c la contraction réciproque des di-
menfions fuperficielles du corps qui fuivent la refpiration,
font fi néceffaires à la vie , qu’il n’y a aucun
animal, pour imparfait qu’il fo u , en qui elles n’e*
xiftent.
La plûpart des poiffons 6c des infeéles font dénués
de poumons 6c de côtes mobiles, ce qui fairque leur
poitrine ne peut point fe dilater ; mais la nature a
remédié à ce défaut par un méchanil'me analogue : les
poifl’ons, par exemple, ont des ouïes qui font l’office
des poumons , 6c qui reçoivent 6c chaffent alternativement
l’eau , par le moyen de quoi les vaiffeaux
fanguins fouffrent les memes altérations dans leurs
dimenfions , que dans les poumons des animaux les
plus parfaits. Voye{ O uïes.
Les infeétes n’ayant point de poitrine , ou de cavité
féparée pour loger le coeur 6c les poumons, ont
ces derniers diftribués dans toute l’étendue de leur
corps, 6c l’air s’y infinue par plufièurs foupiraux auxquels
font attachées autant de petites trachées qui envoient
des branches à tous les mufcles 6c à tous les
vifeeres , 6c paroifl'ent accompagner les vaiffeaux
fanguins dans tout le corps , de même que dans les
poumons des animaux les plus parfaits. Par cette dif-
pofition le corps de ces petits animaux s’étend à chaque
infpiration, 6c fe refferre pendant chaque expiration
, dè forte que les vaiffeaux fanguins fouffrent
une viciffitude d’extenfion 6c de compreflion. Voyc{
Insecte.
Le foetus eft le feul animal qui foit exempt de la
néceflité de refpirer ; mais pendant tout le tems qu’il
eft enfermé dans la matrice, il ne paroît avoir qu’une
vie végétative , 6c il mérite à peine d’être mis au
nombre des animaux. On doit plutôt le regarder comme
une greffe, ou une branche de la mere. Voye^ Foetu
s .
Lois de la refpiration. Comme Ces lois font de la
derniere importance pour l’intelligence parfaite de
l’oeconomie animale, il ne fera pas inutile de fuppu-
ter ici la force des organes de la refpiration, auffi-bien
que celle de la preflion de l’air fur ces mêmes orga-
nes. Il faut obferver qu’en foufflant dans une veflie ,
on éleve un poids confidérable par la feule force de
l’haleine ; car fi l’on prend une veflie d’une figure à-
peu-près cylindrique, que l’on attache un chalumeau
à une de fes extrémités, 6c un poids à l’autre, en forte
qu’il rafe la terre , on foulevera par une infpiration
douce un poids de fept livres, 6c par une infpiration
plus forte un poids de vingt-huit livres. Maintenant
la force avec laquelle l’ air entre dans ce chalumeau
eft égale à celle avec laquelle il fort des poumons ; dé
forte qu’en déterminant une fois la première, il fera
facile de connoître celle avec laquelle il pénétré dans
la trachée-artere. La preflion de l’air fur la veflie eft
égale, à deux fois le poids qu’elle peut lever, à caufe
que la partie fupérieure de la veflie étant fixe, réfifte
à la force de l’air autant que le poids qui eft attaché
à l’autre extrémité. Puis donc que l’air preffe également
de tous côtés , la preflion entière fera à celle
de fes parties qui preffe fur lforifice du tuyau, comme
toute la furface de la veflie eft à l’orifice du tuyau;
c’eft-à-dire , comme la furface d’un cylindre dont le
! diamètre eft , par exemple, de quatre pouces, 6c
l’axe' de fept, eft à l’orifice du tuyau.
Si donc le diamètre du tuyau eft o. 2 8 ,6c fon orifice
o. 616, la furface du cylindre fera 88 ; il s’enfuit
donc que 88 : 0. 616 VI 14 , le double du poids à-
lever eft ào. 098, qui eftprefque deux onces; 6c err
levant le plus grand poids , eft environ de fept onces.
Telle eft donc la force avec laquelle l’air eft chaffé
par la trachée-artere dans l’expiration. Maintenant
fi l’on confidere les poumons comme une veflie, 6c
le larynx comme lin tuyau , la preflion fur l’orifice
de la trachée-artere , lorfque l’air eft chafl’é dehors y
fera à la preflion fur les poumons , comme toute la
furface de ces derniers à l’orifice de la trachée-artere.