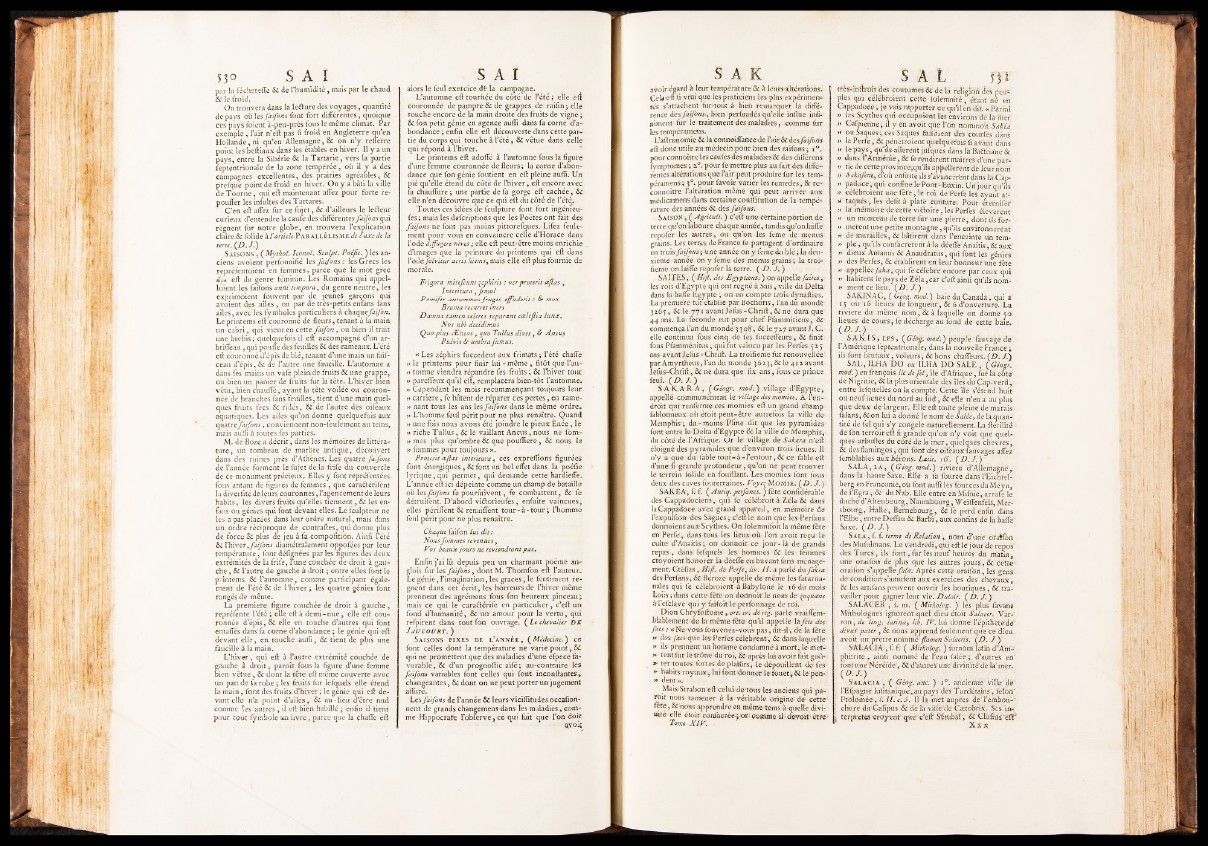
par la féchereffe & de l’humidité, mais par le chaud
& le froid.
On trouvera dans la leûure des voyages, quantité
de pays oii les faifons {ont fort différentes , quoique
ces pays foient à-peu-près fous le même climat. Par
exemple , l’air n’eft pas fi froid en Angleterre qu’en
Hollande, ni qu’en Allemagne, & on n’y refferre
point les beftiaux dans les étables en hiver. Il y a un
pays, entre la Sibérie & la Tartarie, vers la partie
feptentrionale de la zóne temperde, où il y a des
campagnes excellentes, des prairies agréables, St
prefque point de froid en hiver. On y a bâti la ville
de Toorne, qui eft maintenant affez pour forte repouffer
les iniultes des Tartares.
C ’en eft affez fur ce fujet, 8t d’ailleurs le Ieéleur
curieux d’entendre la caufe des différentes faifons qui
régnent fur notre globe, en trouvera l’explication
claire St folide à l'article PARALLÉLISME de l'axe de la
terre. {D . J .) ^
Saisons , (Mythol. Iconol. Sculpt. Pocjîe. ) les anciens
avoient perfonnifïé les faifons : les Grecs les
repréfentoient en femmes, parce que le mot grec
apa. eft du genre féminin. Les Romains qui appel-
loient les faifons anni tempora, du genre neutre, les
exprimoient fouvent par de jeunes garçons qui
avoient des ailes, ou par de très-petits enfans fans
ailes, avec les fymboles particuliers à chaquefaifon.
Le printems eft couronne de fleurs, tefiant à la main
un cabri, qui vient en cette faifon, ou bien il trait
une brebis ; quelquefois il eft accompagné d’un ar-
briffeau, qui pouffe des feuilles St des rameaux. L’été
eft couronné d’épis de blé, tenant d’une main un faif-
ceau d’épis, St de l’autre une faucille. L’automne a
dans fes mains un vafe plein de fruits & une grappe,
ou bien un panier de fruits fur la tête. L’hiver bien
vêtu, bien chauffé, ayant la tête voilée ou couronnée
de branches fans feuilles, tient d’une main quelques
fruits fecs St ridés, St de l’autre des oifeaux
aquatiques. Les ailes qu’on donne quelquefois aux
quatrefaifons, conviennent non-feulement au tems,
mais aufli à toutes fes parties.
M. de Boze a décrit, dans les mémoires de littérature,
un tombeau de marbre antique, découvert
dans des ruines près d’Athènes. Les quatre faifons
de l’année forment le fujet de la frife du couvercle
de ce monument précieux. Elles y font reprél'entées.
fous autant de figures de femmes , que cara&érilent
la diveifitéde leurs couronnes, l’agencement de leurs
habits, les divers fruits qu’elles tiennent, St les en-
fans ou génies qui font devant elles. Le fculpteur ne
les a pas placées dans leur ordre naturel, mais dans
un ordre réciproque de contraftes, qui donne plus
de force St plus de jeu à fa compofition. Ainfi l’été
St l’hiver, faifons diamétralement oppofées par leur
température, font défignées parles figures des deux
extrémités de la frife, l’une couchée de droit à gauche
, St l’autre de gauche à droit ; entre elles font le
printems 8t l’automne, comme participant également
de l’été St de l ’hiver ; les quatre génies font
rangés de même.
La première figure couchée de droit à gauche',
repréfente l’été ; elle eft à demi-nue, elle eft couronnée
d’épis, St elle en touche d’autres qui font
entaffés dans fa corne d’abondance ; le génie qui eft
devant elle, en touche aufli, St tient de plus une
faucille à la main.
L’hiver', qui eft à l’autre extrémité couchée de
gauche à droit, parôît fous la figure d’une femme
bien vêtue , St dont la tête eft même couverte avec
un pan de fa robe ; les fruits fur lefquels elle étend
la main, font des fruits d’hiver ; le génie qui eft devant
elle n’a point d’aîles, St au-lieu d’être nud
comme les autres , il eft bien habillé ; enfin il tient
pour tout fymbole un livre, parce que la çhaffe eft
alors le feul exercice dé la campagne.
L’automne eft tourhée du côté de l’été ; elle eft
couronnée de pampre St de grappes de raifin ; elle
touche encore de la main droite des fruits de vigne ;
St fon petit génie en agence aufli daiis fa corne d’abondance
; enfin elle eft découverte dans cètte partie
du corps qui touche à l’é té, St vêtue dâris celle
qui répond à l’hiver.
Le printems eft adoffé à l’automne fous la figure
d’une femme couronnée de fleurs ; la corne d’abondance
que fon génie foutient en eft pleine aufli. Un
pié qu’elle étend du côté de l’hiver, eft encore avec
fa chauffure ; une partie de fa gorge eft cachée, St
elle n’en découvre que ce qui eft du côté de l’été.
Toutes ces idées de fculpture font fort ingémeu-
fes ; mais les deferiptions que les Poètes ont Fait des
faifons ne font pas moins pittorefques. Lifez feulement
pour vous en convaincre celle d’Horace dans
l’ode diffugere nives; elle eft peut-être moins enrichie
d’images que la peinture du printems qui eft dans
l’ode Jolviiur acris hiems, mais elle eft plus fournie de
morale.
Frigora mitefeunt [ephiris : ver proterit cejlas ,
Inte ritura, Jimul
Pomifer autummus fruges effuderit : & mox
Bruina recurret iners
Damna tamen celeres réparant coeleflia lunce.
Nos ubï decidimus
Quopins Æneas, quo Tullus dives , & Ancus
Pulvis & umbra fumus.
« Les zéphirs fuccedent aux frimats ; l’été chaflë
» le printems pour finir lui - même , fitôt que l’au-
>> tomne viendra répandre fes fruits ; 8t l’hiver tout
» pareffeux qu'il eft, remplacera bien-tôt l’automne.
» Cependant les mois recommençant toujours leur
» carrière, fe hâtent de réparer ces pertes, en rame-
» nant tous les ans les faifons dans le même ordre.
» L’homme feul périt pour ne plus renaître. Quand
» une fois nous avons été joindre le pieux Enée, lé
» riche Tullus, St le vaillant Ancus, nous ne fom-
» mes plus qu’ombre St que poufliere, St nous le
» fommes pour toujours ».
Proterit cejlas interitura, ces expreflions figurées
font énergiques , St font un bel effet dans la poéfie
lyrique, qui-permet, qui demande cette hardieffe.
L’année eft ici dépeinte comme un champ de bataille
oii les faifons fe pourfuivent, fe combattent, & fe
détruifent. D ’abord viftorieufes, enfuite vaincues,
elles périffent St renaiffent tou r -à -tou r ; l’homme
feul périt pour ne plus renaître.
Chaque faifon lui dit :
Nous fommes revenues,
Vis beaux jours ne reviendront pas.
Enfin j’ai lu depuis- peu un charmant poème an--
glois fur les faifons, dont M. Thomfon eft l’auteur.
Le génie, l’imagination, les grâces, le fentiment régnent
dans cet écrit, les horreurs de l’hiver même
prennent des agrémens fous fon heureux pinceau;
mais ce qui le cara&érife en particulier, c’eft un
fond d’humanité, & un amour pour la vertu, qui
refpirent dans tout fon ouvrage. ( Le chevalier DE
Ja u c o u r t . y
Saisons fixes de l’a n n é e , ( Médecine.) ce
font celles dont la température ne varie point
qui ne promettent que des maladies d’une efpece favorable,
St d’un prognoftic aifé; au-contraire les
faifons variables font celles qui font inconftantes,
changeantes, St dont on ne peut porter un jugement
affure.
Les faifons de l’année & leurs vicîflïtudes occafion-
nent de grands chansemens dans les maladies, comme
Hippocrate l’obferve, ce qui fait que l’on doit
ayoic
avoir égard à1 leur température'& à lévifs-altéràtions.
Cela eft fe viffi>que les praticiens les pltts expérhh entés
s’attachent fur-tout à; bien remarquer la différence
dès faifensi, bïen petfqàdés qu’elle influe infi^
niment fur ' le traitement des maladies, comme fin*
les tempéramèns.
L’aftronomie & la ,èonnoiffaircé'de l’airStdes faifons
eft donc utile au médecin'pour bien dès raifens ; i °.
pour coimoître les caufes'desmaladies& desdifférens
fymptomes ; z°. pour fe mettre plus au fait des diffé--
rentes altérations que l’air peut produire fur les tempérament;
30. pour favofc varier les remedes, & re-
connoître l’altération mêftiè qui peut arrivér aux
médicamens dans certaineeonffitution de la température
des années Se des-fetifonsi
Saison:, ( Àgrituk; ),c’eft unccertaine pbrtion de
terre qu’on laboure chaque année, tandis qufonlaiffe'
repofer les autres , ou> qu’on les feme de menus:
grains. Les ternes de France fe partagent d’ordinaire
en troisyài/ô/25; Uiieannéeon y feme du blé ; la; deuxieme
année on y feme des- menus grains ; la trote
fieme on laiffe repofer la terre. ( D . J. )
SALEES , QHiJt. des Egyptiens. ) on appelle faites^
les rois d’Egypte qui ont régné à Sais, ville du Delta
dans lâ'baffe'Égypte ; on-, en compté trois dynàftiès.
La première’fut établie par Bochoris, l’an du monde
3265, St le 771 avant Jefus - Chrift, St ne dura que
44 ans. La féconde eut pour chef Pfammiticus, St
commença l’an du monde'3-308 ; & -le 727 avant J. G;'
elle continua fous cinq de fes fucceffeurs , & finit
fous Pfamménitus, qui fut: vaincu par les PérfeS y i 5
ans avant J,efùs:-Chrift. La troifieme fut renouvellée’
par Amyrtheus, l’an du monde 3623, êc le 412 avant
Jefus-Chfift , & né dura que ftx ans, fous ce prince
feul. ( D . J. )
S A K A R A y ( Géogr. mod: ) village d’Egypte,
appellé communément le village des momies. N V en-
droit qui renferme ces momies eft un grand champ
fablortneux: oif'étoit peut-êtfe autrefois la-ville de-
Memphis'; du-moins-Pline dit que les pyramides
font entre le Delta-d’Egy pt e & la ville de Memphis,
du côté de l’Afrique. Or le' village de Sahara n’eft
éloigné des pyramides que d’environ trois'lieues-. Il
n’y a-que du fable tout - à - l’entour, & ce fable eft
d’une fi grande1 profondeur, qu’on ne peut trouver
lé tei f èin folide en fouillant. Les momies font fotts:
deux des caves fouterraines. Voye^ Momie. (D . /. )->
SARÉA-, fv f . ( Antitfi ptrfa ms ; ) fête confidérahle
des Cappadociens, qui fe oélébroit à Zéla ôd dans
laCappâdOee avec grand appareil, en mémoire de
l’expuifiort des- Sâgues; c-eft le; nom que les Perfàns
donnoient au?p Scythes. On folemnifok la même fête
en Pètfe; dans'tous les lieux'oîi l’on avoit reçu-le
culte d’Anaïtis1;-cas donnoit- ce jou r-là de grands
repas-, dans- lefquels: les hommes & les- fenwnes'
erbyoient honorer la déefteen buvant fans ménagé1-
ment. Gtéftas , Hifi. dé Perfe^ liv. 11. a! parlé^ dn^ fakèa
des PerfariS’, Béroze- appelle de' même les fatùrna-
nales qui fe célébroient à Bàbylone le 16* du mois-
Loüs ; dans cëtte: fête on donnoit le noai'de’ ^0quant
à l’efclave qui y faifoit le perfonnage dé rOk
Dion Chtyfoftome ,-ore. iv. dértg. parle vraiffem-*
blab'lement’de la1 même-fête qu’il appelle h fête dus
fies : «'Ne’VonsLbUvenez^vous pas, dit-il, de la fête-
»> des’/àés1 que lêS!Perfes: célèbrent , & dans laqivellèj
>f ils prennent un honvme condamné à^mort ÿ le1 met-1
» tentftir le’trône- du- roi, £&après1 lui avoir- fait goft*
»■ ter toutes: fortes1 de plaifirs , le dépouillent de1 féS-'
» habits!royaux', lui1 font 'dortner-lefouet1, & le pehu
>r dent'»:
Mais1 Strabon'eft: celui-' de'tous les anciensfqiiLpâ-
t’oit nous ramener à la véritable origine de cette
fête , & Uqus-apprendre en même tems-à quelle divi-
nité elle étoir eonlàerée-;^ 1 eo»«ne il- devoit1 êt-rèj
Tome X IP .
ttè^ ihfcfifd és coutumes & de la reiigi'ôiî d'éS pèü=-
plës qui e'élébtoi'én't cette foléfnriitë , éVànt ne eii
Gappadoce ; jé vais rapporter ce qu’il eh dit; « Pàrmi
* fes'ScÿthéS qui oeciipoîent lès envifons'dê là ifièr
>► Gafpienne , il y èh aVôit que Ton riortimit Sakéà
* ouSaqùès-; cës Saques fàifoiênt dés cOUtfe's' dànS'
» la Perle, & pénétroient quelquefois fi àVân't dans
>r lé p'àyS ; qu'ils allèrent jüiques dans là BàétHane &
>r dansTArménie, & fe rehcliféfit maîtres d’uhé par-
» de de cetté province,qu’il^ âppéllërént d'é léiit nord'
« Sàkafehé, d^oli enfuite îls s’aVàrteefeht dans lâ Câp-
» padoeevqui confiné léPont'iEüxin.Urtjoüf qu’ils
» célébroiem uneTêtë, lé roi de'Pbrfe ie'S ayant àt-
>* taqué‘s f, lès défit à plate ebuture; Pour éternifèr
» la niëkbirfe de eettè!viéïoiré ; :leS Pè'rfëS éfevèrënt
» un monéeàu de terre fur une pierre, dont iis for-
» mërent une petite montagne, qu’ils enitironnerènt
» dè muràillèS , & bâtirent dans l’eiicêirttè uh tém-
» pie, qu’ils confacrërènt à la dcéffë Anàïtis, & aux
» dieux Amaniis & Anatidfàfüs, qui font les génies'*
y des Perfes; & établirent ert leur honneùr Une fête
» appel!èéjaka-, qui-fé célèbre encore par ceux qui
» Habitent le pays de Zéla , car c’eft ainfi qu’ils nom-
» meht ee lieu. (D . / ;)
SAKINAÇ, ( Géogf mod.") baie du Canada, qui à
15 ou 16 lieues de longueur, & 6 d’ouvérturé. La
rivière dit niênie nom, & à laqüelle ori dortné 50'
lieues de cours, fe décharge au fond dé cette baie.
S A K I S , L-Ës, (^Gcog. mod'.) peuple faüvagë dé
l’Amérique feptentrionale, dans la nouvelle France ;
ils font brutaux, voleurs, dèboïis chafTeurs. (D . J.)
SA L , IL HA D O ou ILHA D Ô SALE , ( Géogr.
mod. ) en françois île de fé t, île d’Afrique, fur la côte'
dé Nigritie, êc la plus orientale dès îlès diVCa'p-verd,
entre lelquelles on la compté. Cetfe îïè s’éfeh'd hùit
otPnëüf lieôéS du nôrdau.' fud, & elle n’en a ait plus
que deux de largeur. Elle eft toute pleine de niafais1
fàlâns,& on lui a donné le nom de Salée, de là quantité
de fel qui s’y congèle naturellement. La ftérilité -
dé fon térfcfir eft fi grânde qu’on" n’y voit qiïe qùel-
ques arbuftès du côté de la mer, qUelqüéS ch'èVréS,
& dés flaffiingos ; qui font dès oïfeailx faiïvâges aflez'
femblâbles aux hérons. Latit. 16. J
SALA-, la , ( Géog: rdod. ) riviere' d’Àllemagrië,
: dâris-la' haute Saxê. Elle a là foUrce dâiiSl’Ëich'tèl-
berg en Franconiè, oit font aiiflî lés fôirrces du Nïéÿn,
: deTEgra; &- duNab. Ellè elitre en'Mifhie, arrôïe le
i duché d’Altenb'ourg, NaumfcroUrg, Weiffenfëls, Mèr-
sbourg, Halle', Bernebburg, & fé perd’ enfin dans
j l’Elbe, entré Deffau & Barbi, aux confins de lâ baffé'
! Saxe. (D . J.)
Sa l a , f. f. terme de R e la t io n ffom d’unè' oratfôn
des Mufulmans. Le vendredi, qui eft l e jour dle repos“
: deS Titres', ils font fur tes neuf heures dû mâtin,
: urië otaifon' de plus que leS aütres' joUfS, & cette4
| oraifon' s’appelle faitr: Après cette o'raifôiî, les gens'-
! de1 condition* s^amuferiï aux exercices dés chèvaux ,
j & les artifans peuvent ouVrir les boutiqUes, & trâ-
: vaillerpbUr gagher leur' vie; Èuloif. [D . J. )
SALA'CER , f. m. ( Mltkblog. ) lésplus fàvans
Mithologuës - igiibrerit iqUéf dieir étbif Salaccn Var-'
i ron, de ling. latinâi lib. lit. lui donne TépLthëtedë’
' divus patet, St riôùs' apprend fèülémënt que'cé dièiL-
I avoit un prêtre nbitittié’ fhirrlën Salacrïs. (Z), ƒ.)
SA'LAGIAI, fi fi ( Mïth'olbg.i )'fùrnôm latin d*Ahf»
: phitrite , ainfi nommé de' l’eau faléë ; d’autres" en1
! fontLmë’lNiëréïde,,-& ‘d*làUtte'îfUne'divinité^dé la* mër*. n ^ , I j S a l a ci’A , Giôgs. une. ) î°. ancienfnè' Ville' dë‘
j TEfpagne lufîtànique',.au payS dés Turdëtairis, felbii'
j P'tblbmée1, /. II. ci S. Il ia met 'auprès dë' Tembbü^*
i churé dtt'Gâlipus St dèlâJvillè'dé' CætbbfiX! Ses in-;
! terpretes'crbyènt' qtre' e’eft1 SéttibâT, St'CltifîüS'eft^
X x x