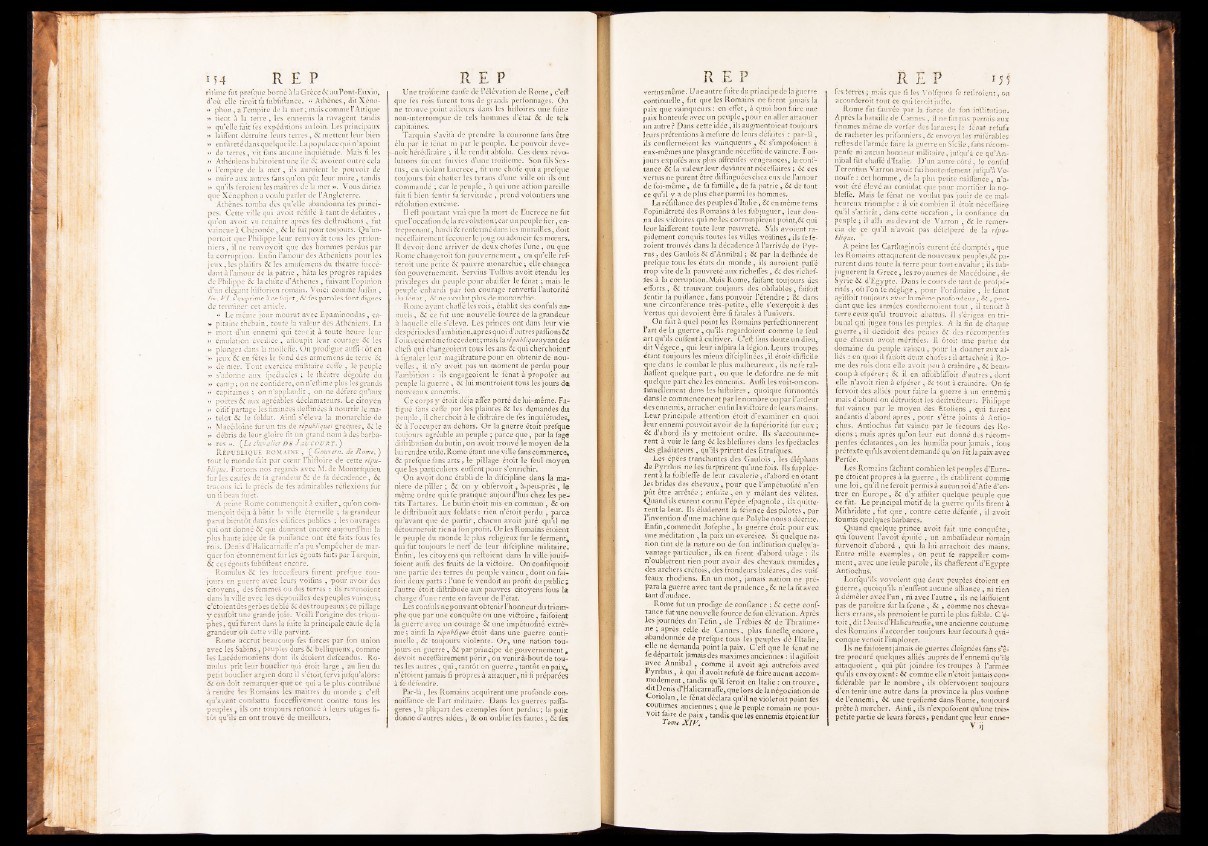
rititne flit prefque borné à laGrèce&auPont-Euxin,
d’où elle tirait fa fubfiftance. « Athènes, dit Xéno-
» phon, a l’empire de la mer ; mais comme l’Attique
>> tient à la terre, les ennemis la ravagent tandis
» qu’elle fait fes expéditions au loin. Les principaux
» Iaiffent détruire leurs terres, 6c mettent leur bien
» enlùretédans quelqueîle. La populace qui n’a point
» de terres, vit fans aucune inquiétude. Mais fi les
» Athéniens habitoient une île & avoient outre cela
» l’empire de la mer, ils auroient le pouvoir de
yt nuire aux autres fans qu’on pût leur nuire, tandis
» qu’ils feroient les maîtres de la mer ». Vous diriez
que Xénophon a voulu parler de l’Angleterre.
Athènes tomba dès qu’elle abandonna fes principes.
Cette ville qui avoit réfifté à tant de défaites ,
qu’on avoit vu renaître" après les deftru&ions, fut
vaincue à Chéronée, & le fut pour toujours. Qu’irn-
portoit que Philippe leur renvoyât tous les prifon-
niers , il ne renvoyoit que des hommes perdus par
la corruption. Enfin l’amour des Athéniens pour les
jeux, les plaifirs & les amufemens du théâtre fuccé-
dant à l’amour de la patrie , hâta les progrès rapides
de Philippe & la chùte d’Athènes , fuivant l’opinion
d’un élégant hiftori en romain. Voici comme Jullin ,
liv. yi. s’exprime à ce lu jet, 6c fes paroles font dignes
de terminer cet article.
« Le même jour mourut avec Epaminondas, ca-
» pitaine thébain, toute la valeur des Athéniens. La
» mort d’un ennemi qui tencit à toute heure leur
» émulation éveillée, alloupit leur courage 6c les
» plongea dans la molleffe. On prodigue aufîi-rôt en
» jeux 6c en fêtes le fond des armemens de terre 6c
» de mer. Tout exercice militaire ceffe , le peuple
» s’adonne aux fpe&acles ; le théâtre dégoûte du
» camp ; on ne confidere, on n’efiime plus les grands
» capitaines ; on n’applaudit, on ne déféré qu’aux
» poètes 6c aux agréables déclamateurs. Le citoyen
» oifif partage les finances deftinées à nourrir le ma-
» telot & le foldat. Ainfi s’éleva la monarchie de
» Macédoine fur un tas de républiques greques, 6c le
» débris de leur gloire fit un grand nom à des barba-
» res». (Le chevalier BE JAU COU RT. )
R é pu b l iq u e r om a in e , ( Gouvem. de Rome. )
tout le monde fait par coeur l’hiftoire de cette république.
Portons nos regards avec M. de Montefquieu
fur les caufes de fa grandeur & de fa décadence, &
traçons ici le précis de fes admirables réflexions fur
un fi beau fu jet.
A peine Rome commençoit à exifter, qu’on com-
mençoit déjà à bâtir la ville éternelle ; fa grandeur
parut bientôt dans fes édifices publics ; les ouvrages
qui ont donné 6c qui donnent encore aujourd’hui la
plus haute idée de fa puiffance ont été faits fous fes
rois. Denis d’Halicarnaffe n’a pu s’empêcher de marquer
fon étonnement fur les égouts faits parTarquin,
& ces égouts fubfiftent encore.
Romulus 6c fes fucceffeurs furent prefque toujours
en guerre avec leurs voifins , -pour avoir des
citoyens, des femmes ou des terres : ils revenoient
dans la ville avec les dépouilles des peuples vaincus;
c’étoient des gerbes de blé & dès troupeaux; ce pillage
y caufoit une grande joie. Voilà l’origine des triomphes
, qui furent dans la fuite la principale caufe de la
grandeur où cette ville parvint.
Rome accrut beaucoup fes forces par fon union
avec les Sabins, peuples durs 6c belliqueux, comme
les Lacédémoniens dont ils étoient defcendus. Ro-
mulus prit leur bouclier qui étoit large , au lieu du
petit bouclier argien dont il s’étoit^fervi jufqu’alôrs:
6c on doit remarquer que ce qui a le plus contribué
à rendre les Romains les maîtres du monde ; c’eft
qu’ayant combattu fucceffivement contre tous les
peuples, ils ont toujours renoncé à leurs ufages fi-
tôt qu’ils en ont trouvé de meilleurs.
Une troifîeme caufe de l’élévation de Rome, c’eft
que fes rois frirent tous de grands perfonnages. On
ne trouve point ailleurs dans les hiftoires une fuite
non-interrompue de tels hommes d’état 6c de tels
capitaines.
Tarquin s’avifa de prendre la couronne fans être
élu par le fénat ni par le peitple. Le pouvoir deve-
-noit héréditaire ; il le rendit abfolu. Ces deux révolutions
furent fuivies d’une troifieme. Son fils Sex-
tus, en violant Lucrèce, fit une chofe qui a prefque
toujours fait chaffer les tyrans d’une ville où ils ont
commandé ; car le peuple, à qui une aftion pareille
fait fi bien fentir fa fervitude , prend volontiers une
réfolution extrême.
Il eft pourtant vrai que la mort de Eucrece ne fut
que l’occafion de la révolution ; car un peuple fier, entreprenant
, hardi 6c renfermé dans fes murailles, doit
néceflairement fècouer le joug ou adoucir fes moeurs.
Il devoit donc arriver de deux chofes l’une, ou que
Rome changeroit fon gouvernement, ou qu’elle refi
teroit une petite 6c pauvre monarchie ; elle changea
fon gouvernement. Servius Tullius avoit étendu les
privilèges du peuple pour abaiffer le fénat ; mais le
peuple enhardi par fon courage renverfa l’autorité
du fénat, 6c ne voulut plus de monarchie.
Rome ayant chaffé les rois, établit des confuls an*
nuels, 6c ce fut une nouvelle fource de la grandeur
à laquelle elle s’éleva. Les princes ont dans leur vie
des périodes d’ambition,après quoi d’autrespafïions 6c
l’oiiiveté même fuccedent; mais la république ayant des
chefs qui changeoient tous les ans 6c qui cherchoienr
à fignaler leur magiftrature pour en obtenir de nouvelles
, il n’y avoit pas un moment de perdu pour
l’ambition : ils engageoient le fénat à propofer au
peuple la guerre , 6c lui montraient tous les jours d<c
nouveaux ennemis. '
Ce corps y étoit déjà affez porté de lui-même. Fatigué
fans ceffe par les plaintes 6c les demandes du
peuple, il cherchoit à le diftraire de fes inquiétudes,
& à l’occuper au-dehors. Or la guerre étoit prefque
toujours agréable au peuple ; parce que, par la fage
diftribution du butin, on avoit trouvé le moyen delà
lui rendre utile. Rome étant une ville fans commerce,
& prefque fans arts , le pillage étoit le feul moyen
que les particuliers euffentpour s’enrichir.
On avoit donc établi de la difcipline dans la maniéré
de piller ; 6c on y obfervoit, à-peu-près , le
même ordre qui fe pratique aujourd’hui chez les petits
Tartares. Le butin étoit mis en commun, 6c on
le diftribuôit aux foldats : rien n’étoit perdu , parce
qu’avant que de partir, chacun avoit juré qu’il ne
détournerait rien à fon profit. O r les Romains étoient
le peuple du monde le plus religieux fur le ferment,
qui fut toujours le nerf de leur difcipline militaire.
Enfin, les citoyens qui reftoient dans la v ille jouif-
foient auffi des fruits de la victoire. On confifquoit
une partie des terres du peuple vaincu, dont on fai-
foit deux parts : l’une fe vendoit au profit du public^
l’autre étoit diftribuée aux pauvres citoyens fous la
charge d’une rente en faveur de l’état.
Les confuls ne pouvant obtenir l’honneur du triomphe
que par une conquête ou une viftoire , faifoient
la guerre avec un courage & une impétuofité extrême
; ainfi la république etoit dans une guerre continuelle,
6c toujours violente. O r , une nation toujours
en guerre , 6c par principe de gouvernement,
devoit neceffairement périr, ou venir à-bout de toutes
les autres , qui, tantôt en guerre, tantôt en paix,
n’étoient jamais fi propres à attaquer, ni fi préparées
à fe défendrë.
Par-là, les Romains acquirent une profonde con-
noiffance de l’art militaire. Dans les guerres paffa-
geres , la plupart des exemples font perdus ; la paix
donne d’autres idées , 6c on oublie fes fautes, 6c fef
vertus rfiême. Une autre fuite du principe de la guerre
continuelle, fut que les Romains ne firent jamais la
paix que vainqueurs : en effet, à quoi bon faire une
paix honteufe avec un peuple, pour en aller attaquer
un autre ? Dans cette idée, ils augmentoient toujours
leurs prétentions à mefure de leurs défaites : par-là,
ils confternoient les vainqueurs , 6c s’impoloient à
eux-mêmes une plus grande néceffité de vaincre. Tou-
jours expofés aux plus affreufes vengeances, laconf-
tance 6c la valeur leur devinrent néceffaires ; 6c ces
vertus ne purent être diftinguées chez eux de l’amour
de foi-même , de fa famille, de fa patrie, 6c de tout
ce qu’il y a de plus cher parmi les hommes.
La réfiftance des peuples d’Italie-, 6c en même tems
l’opiniâtreté des Romains à les fubjuguer, leur donna
des viûoires qui ne les corrompirent point,& qui
leur laifferent toute leur pauvreté. S’ils avoient rapidement
conquis toutes les villes voifines, ils fe feroient
trouvés dans la décadence à l’arrivée de Pyr-
rus, des Gaulois 6c d’Annibal ; 6c par la deftinée de
prefque tous les états du monde, ils auroient paffé
trop vîte de la pauvreté aux richeffes, 6c des richef-
fes à la corruption. Mais Rome, faifant toujours des
efforts , 6c trouvant toujours des obftables, faifoit
fentir fa puiffance, fans pouvoir l’étendre ; 6c dans
une circonférence très-petite, elle s’exerçoit à des
vertus qui dévoient être fi fatales à l’univefs.
On fait à quel point les Romains perfectionnèrent
l’art de la guerre, qu’ils regardoient comme le feul
art qu’ils euffent à cultiver. C’eft fans doute un dieu,
dit Végece, qui leur infpira la légion. Leurs troupes
étant toujours les mieux difeiplinées, il étoit difficile
que dans le combat le plus malheureux, ils ne fe ral-
liaffent quelque part, ou que le defordre ne fe mît
quelque part chez les ennemis. Auffi les voit-on continuellement
dans les hiftoires, quoique furmontés
dans le commencement par le nombre ou par l’ardeur
des ennemis, arracher enfin la victoire de leurs mains.
Leur principale attention étoit d'examiner en quoi
leur ennemi pouvoit avoir de la fupériorité fur eux ;
6c d’abord ils y mettoient ordre. Ils s’accoutumèrent
à voir le lang 6c les bleffures dans les fpeCtaeles
des gladiateurs , qu’ils prirent des Etrufques.
Les épées tranchantes des Gaulois , les éJéphans
de Pyrrhus ne les furprirent qu’une fois. Ils fupplée-
rentà la foibleffe de leur cavalerie ; d’abord en ôtant
.les brides des chevaux, pour que l’impétuofité n’en
put être arrêtée ; en fuite, en y mêlant des vélites.
Quand ils eurent connu l’épée efpagnole, ils quittèrent
la leur; Ils éludèrent la fcience des pilotes, par
l ’invention d’une machine que Polybe nous a décrite;
Enfin,comme dit Jofephe, la guerre étoit pour eux
une méditation, la paix un exercice; Si quelque nation
tint de la nature ou de fori inftitùtion quelqu’a-
vantage particulier, iis en firent d’abord ufage : ils
n’oublierent rien pour avoir des chevaux numides ,
des archers crétois, des frondeurs baléaresdes vaif
féaux rhodiens; En .un mot, jamais nation ne prépara
la guerre avec tant de prudence, 6c ne la fit avec
tant d’audace.
Rome fut un prodige de confiance ; 6c cette confiance
fut une nouvelle fource de fon élévation. Après
Jes journées du Téfin , de Trébies 6c de Thrafime-
me ; après^ celle de Cannes, plus funefte encore,
abandonnée de prefque tous les peuples de l’Italie
«Ile ne demanda point la paix. C ’eft que le fénat ne
fe departoit jamais des maximes anciennes : il agiffoit
avec Annibal , comme il avoit agi autrefois avec
Pyrrhus, à qui il avoit refufé de faire aucun accommodement
, tandis qu’il ferait en Italie : on trouve,
,'5.ltP enîS d’Halicarnaffe, que lors de la négociation de
Coriolan, le fénat déclara qu’il ne violerait point lès
coutumes anciennes ; que le peuple romain ne pou-
voit faire de paix, tandis que les ennemis étoient fur
Tome X I r .
fes terres; mais que fi les Volfques fc retiraient, on
accorderait tout ce qui ferait jufte.
Rome fut fauvée par la force de fort inftitùtion.
Après la bataille de Cannes, il ne fut pas permis aux
femmes même de verfer des larmes; le fénat refufa
de rachéter les prifonniers, 6c envoya les miférables
reftesde l’armée faire la guerre en Sicile, fans récom-
penfe ni aucun honneur militaire, jufqu’à ce qu’An-
njbal fut chaffé d’Italie. D ’un autre côté, le conful
Terentius Varron avoit fui honteufernent jufqu’à Ve-
noufe : cet homme, de la plus petite naiffance, n’a-
voit été élevé au confulat que pour mortifier la no-
bleffe. Mais le fénat ne voulut pas jouir de ce malheureux
triomphe : il vit combien il étoit néceffaire
qu’il s’attirât, dans cette occafion , la confiance du
peuplé ; il alla au devant de Varron , 6c le remercia
de ce qu’il n’avoit pas délefperé de la république.
*
A peine les Carthaginois eurent été domptés, que
les Romains attaquèrent de nouveaux peuples,& parurent
dans foute la terre pour tout envahir ; ils lûb-
juguerent la Grece, les royaumes de Macédoine, de
Syrie & d’Egypte. Dans le cours de tant de profpé-
rités, où l’on fe néglige , pour l’ordinaire , le fénat
agiflbit toujours avec la même profondeur, 6c, pendant
que les armées confternoient tou t , il tenoit à
terre ceux qu’il trouvoit abattus. Il s’érigea en tribunal
qui jugea tous les peuples. A la fin de chaque
guerre, il décidoit des peines 6c des récompenfes
que chacun avoit méritées; II ôtoit une partie du
domaine du peuple vaincu, pour la donner aux alliés
: en quoi il faifoit deux chofes : il attachait à Rome
des rois dont elle avoit peu à craindre , 6c beaucoup
à efpérer ; & il en affoibliffoit d’autres, dont
elle n’avoit rien à efpérer , 6c tout à craindre. On fe
fervoit des alliés pour faire la guerre à un ennêmi ;
mais d’abord on détruifoit les deftrûôeurs: Philippe
fut vaincu par le moyen des Etoliens , qui furent
anéantis d’abord après , pour s’être joints à Antio-
chus. Antiochus fut vaincu par le fecours des Ro-
diens ; mais après qu’on leur eut donné des féeom-
penfes éclatantes, on les humilia pour jamais, fous
prétexte qu’ils avoient demandé qu’on fît la paix avec
Perfée.
Les Romains fâchant combien leS peuples d’Europe
étoient propres à la guerre , ils établirent comme
une lo i, qu’il ne ferait permis à aueun roi d’Afie d’em
trer en Europe, 6c d’y affifter quelque peuple que
ce fut. Le principal motif de la guerre qu’ils firent à
Mithridate , fut que , contre cette défenfe , il avoit
fournis quelques barbares.
Quand quelque prince âvôit fait Une conquête ;
qui louvent l’avoit épuifé , un ambaffadeur romain
fiirvenoit d’abord , qui la lui arrachoit des mains.
Entre mille exemples ,• on peut fe rappeller comment
, avec une feule parole, ils chafferent d’Egypte
Antiochus.
Lorfqu’ils voyoierit que deux peuples étoient eri
guerre, quoiqu’ils n’euffent aucune alliance , ni rieri
à démêler avec l’un, ni avec l’autre, ils ne Iaiffoient
pas de paraître fur la feene , & , comme nos chevaliers
errans, ils prenoient le parti le plus foible. C ’é-
to it , dit Denis d’Halicarnaffe,une ancienne coutume
des Romains d’accorder toujours leur fecours à qui-1
conque venoit l’implorer.
Ils ne faifoient jamais de guerres éloignées fans s’ê*
tre procuré quelques alliés auprès de l’ennemi qu’ils
attaquoient, qui pût joindre les troupes à l’armée
qu’ils envoyoient : & comme elle n’étoit jamais con-*
fidérable par le nombre, ils obfervoient toujours
d’en tenir une autre dans la province la plus voifine
de l’ennemi, 6c une troifieme dans Rome, toujours
prête à marcher. Ainfi, ils n’èxpofoient qu’une très-
petite partie de leurs forces, pendant que leur enne-*
V i j