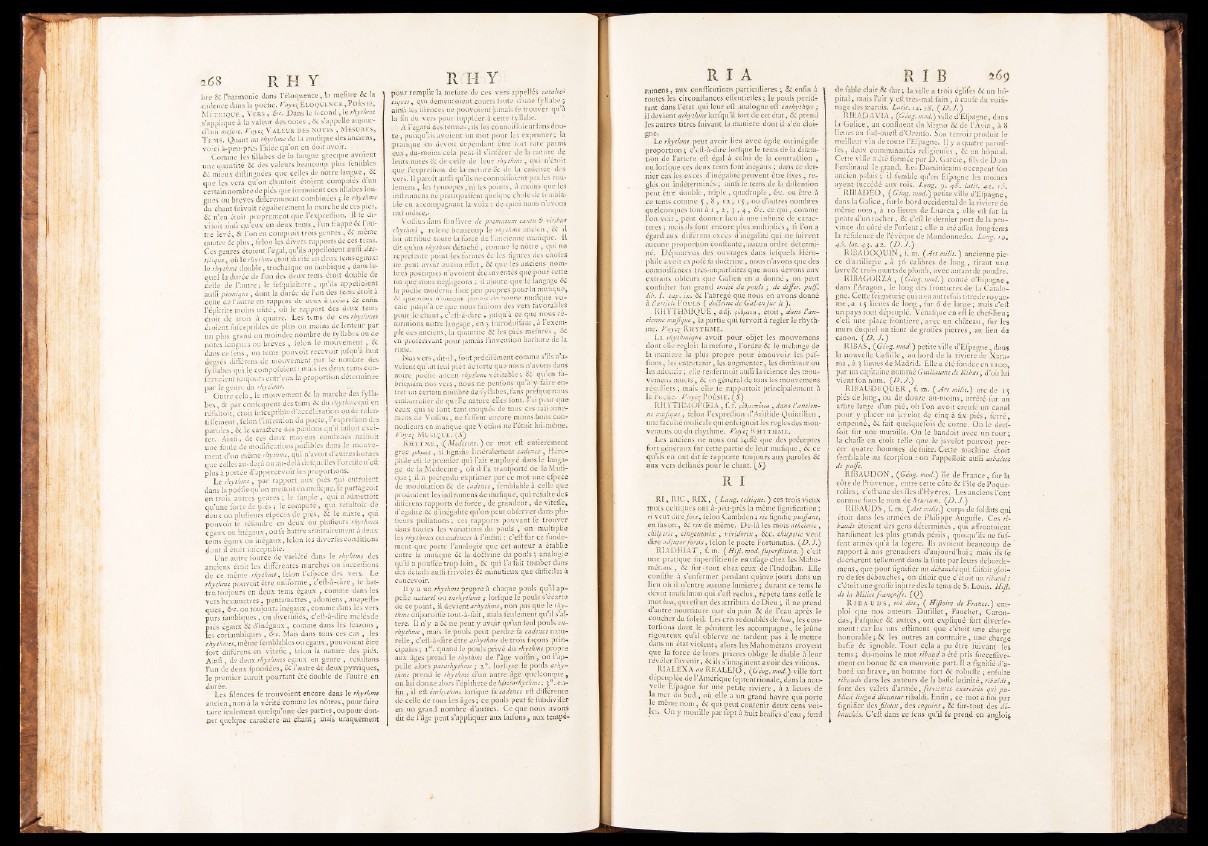
bre & l’harmonie dans l’éloquence, la .mefure 6c la |
cadence dans la poélie. Voy*{ Éloquen ce , P o ésie, J
Mé triq ue , V ers , &c. Dans le fécond, le
s’applique à la valeur,dgs, notes , 6c s’appelle aujour- !
d’hui mefurc. Voye^V ALEUR DES NOTES , MESURES, :
T e MS. Quant au rhythme de la mulique des anciens,
voici à-peu-près l’idée qu’on .en.doit avoir. , _ j
Comme les iillabes. de la langue grecque avoient
une quantité & des valeurs beaucoup plus fenfibles |
6c mieux diftinguées que celles de notre langue ,6 c ■
que les vers qu’on chantoit étoient compotes d’un
certain nombre de piés que formoient ces Iillabes longues
ou brèves différemment combinées ; le rhythme
' du chant fuivoit régulièrement la marche de ces piés,
6c n’en étoit proprement que l’expreffipn. Il le di- •
viloit ainli qu’eux en deux tems, l’un frappe 6c I^au-
tre levé , &.l’on en comptoit trois genres , 6c meme ;
quatre 6c plus, félon les divers rapports de ces tems.
Ces genres étoient l’égal, qu’ils appelloient auffi dac-
tiliquc, où le rhythme étoit.divilé en deux temségaux :
le rhythme double, trochaïque ou ïambique , dans le- .
quel la durée de l’un des deux tems étoit double de ;
celle de l’autre ; le fefqujaltere , qu’ils appelloient
aulïi ptonique, dont la durée de l’un des tem.s .étoit à •
celle de l’autre en rapport de deux à trois ; 6c enfin
l’épiîrite moins ufité , où le; rapport des deux tems J
étoit de trois à quatre. Les tems de ces rhythmes ■
étoient fufceptibles.de plus ou moins de, lenteur par
un plus grand ou moindre nombre de fyllab.es ou de :
notes longues ou brèves., félon le mouvement ,6 c
danscedens, un tems pouvoit recevoir jufqiï’à huit
degrés différons,de mouvement par le nombre, des
fyllabes qui le compofoicnt : mais les deux tems con-
lervcient toujours entr’eux la proportion déterminée
par le genre du rhythme. . . . i --■ y • >
Outre, cela, le mouvement & la marche des fyllabes
, & par conféquent des tems 6c du rhythme qui en ■
réfultoit, étoit fulceptible d’accélération ou,de ralen-
tiffement, félon l’intention du poète, l’exprelîion des ■
paroles, 6c le caractère des paiiions qu’il, falloit exci- :
ter. Ainli, de ces deux moyens combines naiffoit
une foule de modifications po.ffibies dans le mouvement
d’un même rhythme, qui n’avoit d’autres bornes
que celles au-deçà ou au-delà,defquelles l’oreille n eft
plus à portée d’appercevoir les proportions.
Le rhythme , par rapport, aux piés qui entroient
dans la poéfie qu’on mettoit en mufique, fe partageoit
en trois autres genres ; le fimple , qui n’admettoit
qu’une forte de piés ; le compoié , qui rélultoit de
deux ou pluiieurs elpeçes de pies, oi le mixte, qui
pouvoit le réfoudre en deux ou plufieurs rhythmes
e^aux ou inégaux, ou fe battre arbitrairement à deux
tems é^aux ou inégaux, félon les diverfesconditions
dont il étoit fuiceptible. . . '
Une autre fource de variété dans le rhyhtmt des
anciens étoit les différentes marches.ou lucceffions
de ce même rhythme, lelon lelpece des vers. Le
rhythme pouvoir être .uniforme, c’ eft-à-dire , fe battra
toujours en deux tems égaux , comme dans les
vers hexamètres , pentamètres, adoniens , anapefti-
ques, &c. ou toujours inégaux, comme dans les vers
purs iambiques, ou diveriifiés, c’ eft-à-dire melesde
piés égaux 6c d’inégaux , comme dans les feazons ,
les coriambiques^ &c. Mais dans tous ces cas , les
rhythmes, même femblables ou égaux, pouvoient être
fort différens en vîteffe , félon la nature des piés.
Ainfi, de deux rhythmes égaux en genre , réfultans
l ’un de deux fpondées, 6c l’autre de deux pyrriques,
le premier auroit pourtant été double de l’autre en
durée. ,. x ;• .
Les filences fe trouvoient encore dans le rhythme
ancien j non à la vérité comme les nôtres, pour faire
taire feulement quelqu’une des parties, ou pour donner
quelque caraétere au chant ; mais uniquement
pour remplir la mefure, de ces vers-appelles cntalec-
tiques, qui demeuroient .courts faute d’une fyllabe ;
ainli .les lilences: ne pouvoient jamais fe trouver qu’a
la fin du vers pour luppléer à cette fyllabe.
■ '1 A l’égard desjenuès ,-.ils les connoiffoient fans dout
e , puiiqu’iis avoient un mot pour les exprimer; là
pratique en devoit. cependant être fort rare parmi
eux ,■ du-moins cela peut-il s’inférer de la nature de
leurs\notes 6c de celle, de leur rhythme, qui n’étoit
;que, l’exprefîion de la .mefure 6c de la cadence des
vers. Il paroît auffi qu’ils ne connoiffoient pas les rou-
lemens , les lyncopes, ni les points, à moins que les
inftrumenSine pratiquafterit qùelque choie de Icmblà-
.ble en.accompagnant la voix-: de*quoi nous n’avons
nul indice,-
Voffius dans fon livre de poematum cantu & viribus
rhythvfi , releve beaucoup le rhythme ancien, 6c il
lui, attribué;, jo.ute la force de l’ancienne mulique. Il
dit qu’un rhythme détaché , comme le nôtre , qui ne
repré lente point les formes 6c les figures des choies
ne peut avoir aucun effet, 6c que les anciens nombres
poétiques n’avoient été inventés que pour cette
fin que nous négligeons ; il ajoute que; le langage 6c
la poéfie moderne font peu propres pour la mulique,
6c que nous n’aurQns jamais de-bonne mufique vocale
julqu’à ce que nous falîions des vers favorables
pour le chant, c’ eft-à-dire » julqu’à ce que nous reformions
notre langage, eny introduilant, à l’exenir
pie cles_anciens, la quantité 6c les piés mefures , 6c
en prolcrivant pour, jamais l’invention barbare de la
rime.
Nos vers, dit-il, font précifément comme s’ils n’avoient
qu’un ieul pié : de forte que nous n’avons dans
notr.e. poélie aucun rhythme véritable ; 6c qu en fabriquant
nos. vers, nous ne penfons qu’iriy faire entrer
uq .certain nombre de fyllabes, fans prefque nous
embarraller de quelle nature elles font. J’ai peur que
ceux qui fe font tant moqués de tous ces railonne-
mçnsde Vofîius, ne fuflènt encore moins .bons con-
noiffeurs en mufique-que Voffius ne l’étoit lui-meme.
yoye{ Musique. (S)
Kh y tm e , {(Médecine. ) ce mot eft entièrement
grec pubpoç ,;;il..lignifie littéralement cadencé, Héro-
phile eft le premier qui l’ait employé dans’le langage
de la Médecine , où il l’a tranfporté de la M ufi-
que ; il a prétendu exprimer par ce mot une efpece
de modulation 6c de cadence, femblable à celle que
produifent les inftrumens de mufique, qui réiulte des
différens rapports de force, de grandeur, de vîtefle,
d’égalité.ôc d’inégalité qu’on peut obferver dans plufieurs
pullations ; ces rapports pouvant fe trouver
dans toutes les variations du pouls , on. multiplie
les rhythmes ou cadences à l’infini : c’ eft fur ce fondement
que porte l’analogie que cet auteur a établie
entre la mulique 6c la do&rine du pouls ; analogie
qu’il a pouflee trop loin, 6c qui l’a Fait tomber dans
des détails auffi frivoles 6c minutieux que difficiles à
concevoir. . .
Il y a un rhythme propre à chaque pouls qu’il appelle
naturel ou enrkythme ; lorfque le pouls s’écarte
de ce point, il devient arhythme, non pas que le rhythme
difparoiffe tout-à-fait, mais feulement qu’il s’al-
tere. 11 n’y a 6c ne peut y avoir qu’un feul pouls en-
rhythme , mais le pouls peut perdre fa cadence naturelle
, c’eft-à-dire être arhythme de trois façons prin-.
tipales.; i°. quand le pouls privé du rhythme propre
aux âges prend le rhythme de l’âge voifin , on l’appelle
alors par arhythme ; z.°. lorkfUe le pouls arhythme
prend le rhythme d’un autre âge quelconque ,
on lui donne alors l’épithete de héterorhythme; 30. enfin
, il eft cnrhythmt lorfque fa cadence eft différente
de celle de tous les âges ; ce pouls peut fe fubdivifer
en un grand nombre d’autres. Ce que nous avons
dit de l ’âge peut s’appliquer aux faifons, aux temperamens,
aux eonftitutions particulières ; 6c enfin à J
toutes les circonftapces effentielles ; le pouls perfift I
tant dans l’état qui leur eft analogue eft enrhythrpe ; 1
il devient arhythme lorfqu’il fort de cet état, 6c prend
les autres titres ftiivant la maniéré dont il s’en éloit
jgne.
Le rhythme peut avoir lieu avec égale oujnégale
proportion.; c’ eft-à-dire lorfque:le tems delà dilata- ’
tion cle l’artere eft égal à celui de la contraûion ,
ou,lorfque ces deux tems font inégaux ; dans/.c.e detr
nier cas, les excès d’inégalité peuvent être.fixes., réglés
qu;. indéterminés ; ajnfi le.tems de la eliftention
peut être double, triple, quadruple, &c. ou .être, à
ce tems-comme, 5 ., 8 , 12 , 15 ,;ôu d^aqtres nombres
qiielconques font à 1 , 2, 3 , 4 , &c. ce qui.,.comme
,1’on v o it , .peut donner lieu ,à une infinité de caractères
; mais ils font encore plus multipliés, fi l’on a
égard aux ditférens excès d’inégalité qyi ne fuivent
aucune proportion confiante,.aucun ordre ; déterminé.
Dépourvus, des ouvrages dans lefquels Héro-:
phile avoit expofé fit doélrine ,.nous n’avons que des
connoiflances très-imparfaites que nous devons aux
extraits obfcurs que Galien en a donné, on peut
eonfulter fon grand traité du pouls ; de dijfer. pulf.
lib. I. cap, ix. 6ç l’abrégé que nous en avons donné
à l'article. Pou LS ( doctrine de Galien fur le ).
RHYTHMIQUE, adj. pvû/x/r.», étoit, dans l'ancienne
mufique , la partie qui fervoit à regler le rhythme.
yoyé^ Rh ythm e. ,
La rhyihmique avoit pour objet les mouvemens
dont elle regloit la mefure, l’ordre & le mélange de
la manière .la,plus propre.pour émouvoir les parlions
, les entretenir, les. augmenter, les diminuer ou
les adoucir ; elle renfermoit auffi la fcience des mouvemens
muets , 6c en général de tous les mouvemens
réguliers ; mais elle le rapportoit principalement à
la Poélie., t'oyez PoÉSïE. (S)
RHYTHMOPCEIA , f. f. pûù/xcnèita. , dans l'ancien-
ne mufique , félon l’exprefîion d’Ariftide Quintilien ,
une faculté muficale qui enfeignoit les réglés des mouvemens
ou du r\\yt)\mQfyçye[ Rh y thm e .
Les anciens ne nous ont l^iffé que des préceptes
fort généraux fur cette partie de leur mufique, & ce
qu’ils en ont dit fe rapporte toujours aux paroles 6c
aux vers deftinés pour le chant, ( i 1)
R I
R I , R IC , ,RIX, ( Lang, celtique. ) ces trois vieux
mots celtiques .ont à-peu-près la même fignification ;
ri veut dire fort , félon Cambden ; rie lignifie puiffant,
en faxon, 6c rix de même, De-là les mots atheleric,
chilperic, cingentprix , vividorix, 6cc. chilperic veut
dire adjujorforcis, félon le poète Fortunatus. (D. J.)
RIADHIAT, f. m. (Hifl. mod.fuperfitiond) c’eft
une pratique fuperftitieufe en ufage chez les Maho-
métans , 6c fur-tout chez ceux de l’Indoftan. Elle
confifte à s’enfermer pendant quinze jours dans un
lieu où il n’entre aucune lumière.; durant ce tems le
dévot mufulman qui s’eft reclus, répété fans ceffe le
mot Aok, qui eft un des att ributs de Dieu ; il ne prend
d’autre nourriture que du pain & de l’eau après le
coucher du foleil. Les cris redoublés de hou, les con-
..torfions dont le pénitent les accompagne, le jeûne
rigoureux qu’il obferve ne tardent pas à le mettre
dans un état violent ; alors les Mahométans croyent
que la force de leurs prières oblige le diable ;à leur
reveler l’avenir, & ils s’imaginent avoir des vifions.
RIALÉXA ou RÉALEJO , (Géog. modf ville fort
depeuplee de l ’Amérique feptentrionale, dans la nouvelle
Efpagne fur une petite riviere, à 2 lieues de
la mer du Sud ,. où elle a un grand havre qui porte
Je meme nom, & qui peut contenir deux cens Voiles,
On y mouille par fept à huit braflçs d’eau, fond
dé fable, clair & dur ; la ville a trois églifes & un hôpital
, mais l’air y eft très-mal fain , à caufc du voifi*
nage des tnarais. Latit. 12.28.. ( D. J. j)
R 1BADAV1A , (Géog, mod.) ville d’Efpagne, dans
la Galice, au confluent du Migno 6c de l’Avia , à 8
lieues au fud-oueft d’Orenfo. Son terroir produit le
meilleur vin de toute l’Efpâgne, Il y a quatre paroif-
fes, deux communautés religieufes , & un hôffital.
Cette ville a été formée pur D . Gaixle, fils de Dom
Ferdinand le grand. Les Dominicains occupent fon
aorien palais ; il femble qu’en Efpagne les moines
ayént füccédé aux rois. Long. $■ , 48. latit. 42. iS.
RIBADÉO , (Géog. mod.') petite ville d’Efpagne,
dans la Galice, fur le. bord occidental de la riviere de
même nom,.à 10 lieues de Luar.ca ; elle eft fur la
pente d’un rocher, 6c c’eft le dernier port de la province
du côté de l’orient ; elle a été affez long-tems
la réfîdence de l’évêque de Mondonnedo, Lonp. 10.
■ 4J. lat. 43 , 42. (D. J.)
RTRADOQUIN, 1. m. (Art milit. ) ancienne pièce
d’artillçrie , à 36 calibres de long, tirant une
livre & trois quarts de plomb, avec autant de poudre^
RIBAGORZA , f Géog. mod.') comté d’Eipagne ,
dans!’Aragon, le long des frontières de la Catalogne.
Cette feigneuric qui a eu autrefois titre de royaume
, a 15 lieues de long , fur 6 de large ; mais c’eft
un pays .tout dépeuplé. Vénafque en eft le chef-lieu ;
c’eft une place frontière, avec un château, fur les
mur« duquel on tient de groiîes pierres, au lieu de
canon. ( D. J, )
RIBAS, (Gcog. mod.') petite ville d’Efpagne, dans
la nouvelle Caftille, au bord de la riviere de Xara-
rda, à 3 lieues de Madrid. Elle a été fondée en 1100,
par un capitaine nommé Guillaume de Ribas, d’où lui
vient fon nom. (D. Jd)
RIBAUDEQUER, f. m. (Art milit.') arc de 15
piés dé,long, ou de douze au-moins, arrêté fur un
arbre large d’un pié, où l’on avoit Creufé un canal
pour y placer un javelot de cinq à fix piés, ferré,
empenné, 6c fait quelquefois de corne. On le drei*
foit fur une muraille. On lé bandoit avec un tour ;
la chaffe en étoit telle que le javelot pouvoit percer.
quatre hommes de fuite. Cette machine etoit
femblable au feorpion : on l’appelloit auffi arbalète
de paffe.
RIBAUDON, (Géog. mod.') île de France, fur la
côte de Provence, entre cette côte 6c l’île de Poque-
rolles ; c’eft une des îles d’Hyeres. Les anciens i’ont
connue fous le nç>m de Sturium. (D. J.)
RIBAUDS, f. m. (Art milit.) corps de foldats qui
etoit dans les armées de Philippe Augufte. Ces ri»
bauds étoient des gens déterminés , qui affrontoient
hardiment les plus grands périls, quoiqu’ils ne fuf-
fent armés qu’à la légère, Ils avoient beaucoup de
rapport à nos grenadiers d’aujourd’hui; mais ils fe
décrièrent tellement dans la fuite par leurs déborde-
mens, que pour lignifier un débauché qui faifoit gloire
de fes débauches, on diloit que C’étoit un ribaud:
c’étoit une groffe injure dès le tems de SP Louis. Hiß,
de la Milice françoife. (Q)
R iB A UDS, roi des, ( Rißoire de France.) emploi
que nos auteurs Dutillet, Fauchet, Caron*
das, Pafquier 6c autres, ont expliqué fort diverfe-
ment : car les uns eftiment que c’etoit une charge
hpnorable ; & les autres au contraire, une charge
baffe & ignoble. Tout cela a pu être fuivant les
tems ; du-moins le mot ribaud a été pris fucceffive-
ment en bonne 6c en mauvaife part. Il a ffgnifié d’abord
un brave,-un homme fort & robufte ; enfuite
ribauds dans les auteurs de la baffe latinité, ribaldi,
font des Valets d’armée, fetvichtes excrcitùs qui publica
linguâ dicufuuf ribaldi. Enfin, ce mot a fini pat*
fignifier des filoiix, des coquins, & fur-tout des débauchés,
C’eft dans ce fens qu’il fe pren,d en angloi$