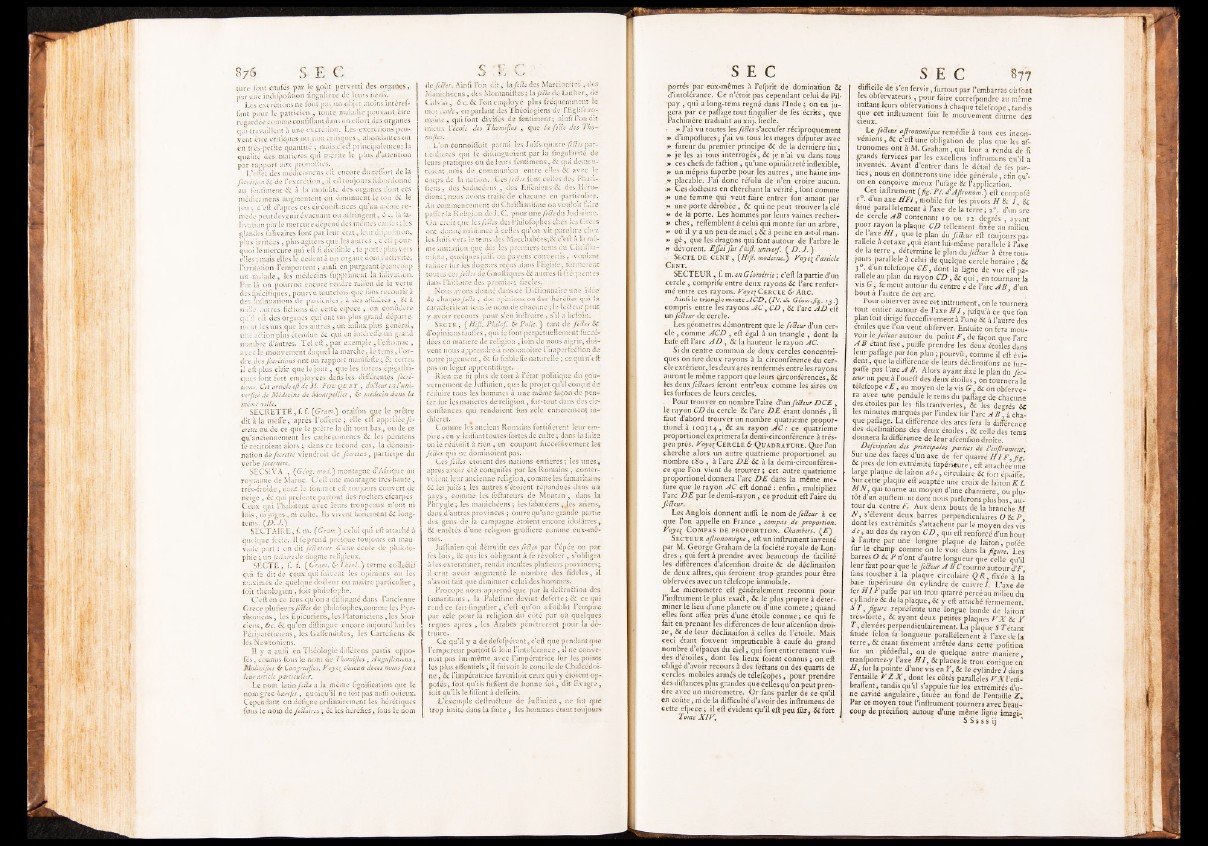
ture font caufés par le goût perverti des organes,
par une indilpofition fingulvere de leurs,nerfs.
Les e*crétions ne font pas, un objet moins intéref-
fant pour le patricien , toute maladie pouvant être
regardée comme confiftant dans un effort.ctes organes
qui travaillent à une excrétion. Les excrétions peuvent
être critiques,ou .non critiques , abondantes,ou
en très-petite quantité ; mais c’eft principalement la
qualité des matières qui mé.rite le plus d’attention
par rapport airx p r o n o f r i ç s . _,_v, -ur- _ •
L’effet clés médicamens eïS encore dureffort delà
fecrétion&C de l'excrétion,, il eft toujours ftibordonné
au fentiment 8c à la mobilité des organes ooiit ces
médicamens augmentent ou diminuent le ton &c le
jeu ; c’eft d’apres ces circonftances qu’un même re-
mede peut devenir évacuant ou allringent, Gc. la la-
livation par le mercure dépend des mêmes caufes ; les
glandes falivaires font parleur état, leur üiipofition,
plus irritées , plus agitées que les autres , c’ eft pourquoi
le mercure qui eft fi divifible , fe porte plus yers
elles ; mais elles le cedent à un organe dont l’atlivité,
l’irritation l’emportent ; ainfx en purgeant beaucoup
un malade ,- les niée ceins fuppi nnci t la falh >n.
Pai EH on pourroit encore rendre raifon de la vei tu
des fpécifiques, pourvu toutefois que lans rec ou ri
des infinuations de- larticu es, des affinités i l
mi ie autres fierions de ce te eîpeçe on co ffitk re
qu il eft des organes qui ont un plus grand d pai
hic fit les uns que les autres , un :nflux plus gc nerfij
un aöion plus étendue 8c qui en intGreffe un grand
no libre d’autres. T el e f t , par e <em) le , l’eft ornac >
avec le mouvement duquel la marche, le tems, l’ordre
des fecrétions ont un rapport ma ni relie ; &L certes
il eft plus clair que le jour , que les forces épigaftri-
ques font fort employées dans les différentes fecrétions.
Cet article éfi de M. F0UQ.UET , dotteur enl'uni-
ver filé de Médecine de Montpellier, 6* médecin dans la
même ville.
SECRETTE, f. f. {Gram.) oraifon que le prêtre
dit à la meffe, après l ’offerte ; elle eft appeliée fe-
\rette ou de ce que le prêtre la dit tout bas, ou de ce
qu’anciennement les cathécumenes 8c les penitens
fe retiroient alors ; dans ce fécond cas, la dénomination
de fecrette viendroit de fecretus, participe du
verbe fecerntre. .
SECS1VA , {Géog. mod.) montagne d’Afrique au
royaume de Maroc. C’eft une montagne très-haute ,
très-froide, dont le fommet eft toujours couvert de
neige , &C qui préfente partout des rochers efearpés
Ceux qui l’habitent avec leurs troupeaux n’ont ni
lois, ni juges, ni eiüte. Ils vivent l'ainement 8c long-
tems. (D. J.)
SECTAIRE, f. ni. (Gram.) celui qui eft attaché à
quelque feâe. Il fe prend prefque toujours en mau-
vaife part : on dit fecUtcur d’une école de philofo-
phie ; un fettaire.de dogme religieux.
SECTE , f. f. (Gram. & Tkéol. ) terme colleélif
qui fe dit de ceux qui fuivent les opinions qu les
maximes de quelque dofteur ou maître particulier ,
l'oit théologien , foit philofophe.
C’eft en ce fens qu’on a diftingué dans l’ancienne
Grèce plufieurs Jettes de philofophes,comme les Pyr-
rhoniens , les Epicuriens, les Platoniciens ,les Stoïciens,
&c. 8c qu’on diftingué encore aujourd’hui les
Péripatéticiens, les Gaffendiftes, les Cartéfiens 8c
les Newtoniens.
Il y a aulTi en Théologie différens partis oppo-
fés, connus fous le nom de Thomijles, Augufliniens,
Molinifies & Congruifles. Voyt{ chacun deces noms fous
leur article particulitr.
Le nom latin fetta a la même fignification que le
nom grec hoerefis , quoiqu’il ne foit pas aulîi odieux*
Cependant on déftgne ordinairement les hérétiques
fous le nom de feclaires ; 8c les héréfies, fous le nom
Oc .- 4vL C 1
de /ff/c.f. Àinft l’on dit , \afette des Marcion.it es , des
Manichéens , des Mtontaniftes; la Jette de Luther, dé
Calvin , &c. 8c l’on employé plus fréquemment lé
mot école , en parlant des Théologiens de l’Eglife ro-,
ntaine , qui font divifés de fentiment; ainft l’on dit
mieux l école des Thomijles , que La fette des Thomijles.
L’on connoiffoit parmi les Juifs quatre fecles particulières
qui fe difiinguoient par la iingularité de
leurs pratiques ou de leurs fentimens, & qui demeu-
r.oient .unis de communion entre elles 8c avec lé
corps de la i îation. Ces Jettes font celles cles Pharifiens,
des S;iducéens , des Efleniens & 1des Hérodie;
ns ;, nous<ivons traité de. chacune en particuliërè
Ai 1 comme ne:ement clu Chriftianifme on vouloit faire
pa la Religion de J. C. pour une Jette du Ju d a ïfm e.
O:n circit qu<île Sfitti•.s. des Philofophes che;1 les Grecs
on,t don né naifiance à celles qu’on vit paroître chez
les; Jui fs vers le tems des Maccnabces;&c’c;ft à la me-'
; .nutation que dè:s les premiers tems dv1 Chriftiar.
ifme, quelques juifs ou payons convertis, voulant
rafiner fur les dogmes reçus dans l’Eglife, formèrent
toutes ces jettes de Gnoftiques & autres fi fréquentes
dans l’hiftoire des premiers fiecles.üpo
Nous avons donné dans cè Diûionnaireune idée'
de chaque J'ecle , des opinions ou des héréfies qui la
càraclérifent fous le nom de chacune ; le lecteur peut
y avoir recours pour s’en inftruire, s’il a befoin.
Secte , ( H i ß . P h ilo f. & P o lit. ) tant de fe c le s 8 c
d’opiniens faillies, qui fe font perpétuellement fuccé-
dées en matière de religion , loin de nous aigrir, doivent
nous apprendre à reconnoître l’imperfeêHon de
notre jugement, 81 fa foibleffe naturelle ; ce qui n’ eft
pas un leger apprentift'age.
Rien ne fit plus de tort à l’état politique du gouvernement
de Juftinien, que le projet qu’il conçut de
réduire tous les hommes à une même façon de pen-
fer fur les matières de religion, fur-tout dans des cir-
conftances qui rendoient fon zèle entièrement in-
difçre.t.
Comme les anciens Romains fortifièrent leur empire
, èn y laiffant toutes fortes de culte ; dans la fuite
on le réduifit à rien , en .coupant fucceflivement les
Jettes qui ne dominoient pas.
Ges fettes étoient des nations entières ; les unes ,
après avoir été conquifes par les Romains , confer-
voient leur ancienne religion, comme les famaritains
8c les juifs ; les autres s?étoient répandues dans un
pa ys, comme les fe&ateurs de Montan , dans la
Phrygie; les manichéens; lesfabatéens ,J.es ariens,
dans d’autres provinces ; outre qu’une grande partie
des gens de la campagne étoient encore idolâtres,
8c entêtés d’une religion groftiere comme eux-mêmes,.
Juftinien qui détmifit ces fecles par l'épée ou par
fes lois, 8c qui les obligeant à fe révolter, s’obligea
à les exterminer, rendit incultes plufieurs provinces;
il crut avoir augmenté le nombre des fideles, il
n’avoit fait que diminuer celui des hommes.
Procope nous apprend que par la deftruttion des
famaritains , la Paleftine devint deferte ; 8l ce qui
rend ce fait fingulier, c’eft qu’on affoïblit l’empire
par zèle pour la religion du côté par oli quelques
régnés après , les Arabes pénétrèrent pour la détruire.
Ce qu’il y a de defefpérant, c’eft que pendant que
l’empereur portoit fi loin l’intolérance , il ne conve-
noit pas lui-même avec l’impératrice fur les points
les plus effentiels ; il fuivoit le concile de Chalcédoi-
ne ; & l’impératrice favorifoit ceux qui y étoient op-
pofés, foit qu’ils fuffent de bonne fo i, dit Evagre,
l’oit qu’ils le fiffent à defl'ein.
L’exemple deftrufteur de Juftinien , ne fut que
trop imité dans la fuite , les hommes étant toujours
portés par eux-mêmes à l’efprit de domination 8c
d’intolérance. Ce n’étoit pas cependant celui de Pil-
•pay , qui a long-tems regne dans l’Inde ; on en jugera
par ce pafl'age tout ungulier de fes écrits, que
Pachimère traduifit au xiij. fiecle.
1 » J’ai vu toutes les fecles s’accufer réciproquement
» d’impoftures ; j’ai vu tous les mages difputer avec
» fureur du premier principe & de la derniere fin ;
» je les ai tous interrogés, & je n’ai vu dans tous
» ces chefs de faélion , qu’une opiniâtreté inflexible,
» un mépris fuperbe pour les autres, une haine im-
» placable. J’ai donc réfolu de n’en croire aucun.
» Ces do&eurs en cherchant la vérité , font comme
une femme qui veut faire entrer fon amant par
h une porte dérobée , & qui ne peut trouver la clé
»» de la porte. Les hommes par leurs vaines recher-
» ches, reffemblent à celui qui monte für un arbre,
» où il y a un peu de miel ; & à peine en a-t-il man-
» g é , que les dragons qui font autour de l’arbre le
» dévorent. Effai fur P hiß. univerf. ( D . J .)
■ S e c t e DE c e n t , (Hiß. moderne.) Foyei P article
C e n t .
SECTEUR, f. m. en Géométrie ; c’eft la partie d’un
cercle , comprife entre deux rayons & l’arc renfermé
entre ces• r a y o n s . C e r c l e & A r c .
Ainft le triangle mixte A CD, (PL. de Gèom.fig. / 3 .)
compris entre les rayons A C , C D , & l’arc A D eft
un fetteur de cercle.
. Les géomètres démontrent que le fetteur d’un cercle
, comme A C D , eft égal à un triangle , dont la
bafe eft l’arc A D , & la hauteur le rayon AC.
. Si du centre commun de deux cercles concentriques
on tire deux rayons à la circonférence du cercle
extérieur, les deux arcs renfermés entre les rayons
auront le même rapport que leurs qjrconférences, 8t
les deux fetteurs feront entr’eux comme les aires ou
les furfaces de leurs cercles.
. Pour trouver en nombre Taire d’un fetteur D C E ,
le rayon CD du cercle & l’arc D E étant donnés , il
faut d’abord trouver un nombre quatrième propof-
tionel à 100314, & au rayon A C : ce quatrième
proportionel exprimera la demi-circonférence à très-
peu près. Foyei C e r c l e & Q u a d r a t u r e . Que l’on
cherche alors un autre quatrième proportionel au
nombre 180 , à l’arc D E & à la demi-circonférence
que l’on vient de trouver; cet autre quatrième
proportionel donnera l’arc D E dans la même me-
iiire que le rayon AC eft donné : enfin, multipliez
l’arc D E par le demi-rayon, ce produit eft l’aire du
Jetteur.
Les Anglois donnent auffi le nom àt fetteur à ce
que l’on appelle en France , compas de proportion.
Voye^ C o m p a s d e p r o p o r t i o n . Chambers. (E)
S e c t e u r aßronomique, eft un inftrument inventé
par M. George Graham de la fociété royale de Londres
, qui fert à prendre avec beaucoup de facilité
les différences d’afcenfion droite & de déclinaifon
de deux aftres, qui feroient trop grandes pour être
obfervées avec un télefeope immobile.
Le micromètre eft généralement reconnu pour
l’inftrument le plus exaél, & le plus propre à déterminer
le lieu d’une planete ou d’une comete ; quand
elles font affez près d’une étoile connue; ce qui fe
fait en prenant les différences de leur afeenfion droite
, & de leur déclinaifon à celles de l ’étoile. Mais ■
ceci étant fouvent impraticable à caufe du grand
nombre d’efpaces du ciel., qui font entièrement vui-
des d’étoiles, dont les lieux foient connus ; on eft
obligé d’avoir recours à des feftans ou des quarts de
cercles mobiles armés de télefcopes, pour prendre
des diftances plus grandes que celles qu’on peut prendre
avec un micromètre. Or fans parler de ce qu’il
en coûte, ni de la difficulté d’avoir des inftrumens de
cette efpece ; il eft évident qu’il eft peu fur, 8c fort
TomeXlV, 1
difficile de s en fervir, furtout par l’embarras oiifont
les obfervateurs , pour faire correfpondre au meme
inftant leurs obfervations à chaque télefeope, tandis
que cet inftrument fuit le mouvement diurne des
cieux.
h t fetteur aßronomique remédie à tous ces incon-
veniens, & c’eft une obligation de plus que les astronomes
ont à M. Graham, qui leur a rendu de fi
grands fervices par les. excellens inftrumens qu’il a
inventes. Avant d’entrer dans le détail de fes parties,
nous en donnerons une idée générale, afin ou’-
on en conçoive mieux l’ufage & l’application.
Cet inftrument (fig. PL tPAflronom.) eft compofé
1 . d un axe H F l , mobile fur fes pivots H 8c 1, 8c
•fitué parallèlement à l’axe de la terre; z°. d’un’arc
de cercle A B contenant 10 ou i z degrés , ayant
pour rayon la plaque CD tellement fixée au milieu
de laxe H I , que le plan du fetteur eft toujours parallele
à cet ax e, qui étant lui-même parallele à l’axe
de la terre , détermine lé plan du fetteur à être tou-
jours^parallele à celui de quelque cercle horaire ; 8c
30. d un télefeope C E , dont la ligne de vue eft parallele
au plan du rayon CD , & q ui, en tournant la
vis G y fe meut autour du centre c de l’arc A B d’un
bout à l’autre de cet arc.
Pour obferver avec cet inftrument, on le tournera
tout entier autour de l’axe H I , jufqu’à ce que fon
çlan foit dirigé fucceflivement à l’une & à l’autre des
étoiles que l’on veut ôb'ferver. Enfuite on fera mou-
voir le^ jetteur autour du point F } de façon que l’arc
A B étant fixe, puiffe prendre les .deux étoiles dans
leur paffage par fon plan ; pourvû, comme il eft évi-
denr, que la différence de leurs déclinaifons ne fur-
paffe pas l’arc A B . Alors ayant fixé le plan du fec-
teur un peu à l’oueft des deux étoiles, on tournera le
telefcope c E , au moyen de la vis G , & on obferve-
ra avec une pendule le tems du paffage de chacune
des. étoiles par les fils tranfverfès, & les degrés 6c
les minutes marqués par l’index fur l’arc A B ,^ chaque
paffage. La différence des arcs fera là différence
des déclinaifons des deux étoiles , & cellë des tems
donnera la différence de leur afeenfion droite.
Defcription des principales parties de Pinßrumcnt.
Sur une des faces d’un axe de fer quarré H I F , fig]
8c près de fon extrémité fupérieure, eft attachée une
large plaque de laiton abc y circulaire & fort épaiffe.
Sur cette plaque eft adaptée une croix de laiton Ä L
MNy qui tourne au moyen d’une charnière, ou plutôt
d’un ajuftement dont nous parlerons plus bas, au-'
tour du centre F. Aux deux bouts de la branche M
N y s’élèvent deux barres perpendiculaires O 8c P
dont les extrémités s’attachent par le moyen des vis
de y au dos dp rayon C D y qui eft renforcé d’un bout
à 1 autre par une longue plaque de laiton, pofée
fur le champ comme on le voit dans la figure. Les
barres O 8c P n’ont d’autre longueur que celle qu’il
leur faut pour que le fetteur A B C tourne autour d’F
fans toucher à la plaque circulaire Q R t fixée à la’
bafe fupérieure du cylindre de cuivre I. L’axe de
fer H I F paffe par un trou quarré percé au milieu du
cylindre & de la plaque, & y eft attaché fermement.
S J ■> fiëure■ repréfente une longue bande de laiton
très-forte, & ayant deux petites plaques V X 8c Y
T y élevées perpendiculairement. La plaque S Tétant
fituée félon fa longueur parallèlement à l’axe de la
terre, & étant fixement arrêtée dans cette pofition
fur un piédeftal, ou de quelque autre- maniéré
tranfportez-y l’axe H I f & placez le trou conique en
H y fur la pointe d’une vis en T , & le cylindre / dans
l’entaille V Z X y dont les côtés paralleles FXVem-
braffent, tandis qu’il s’appuie fur les extrémités d’une
cavité angulaire, fituée au fond de l’entaille Z .
Par ce moy en tout l’inftrument tournera avec beaucoup
de preçifion autour d’une même ligne imagiçç
c c c . ; ; Ö '1
1