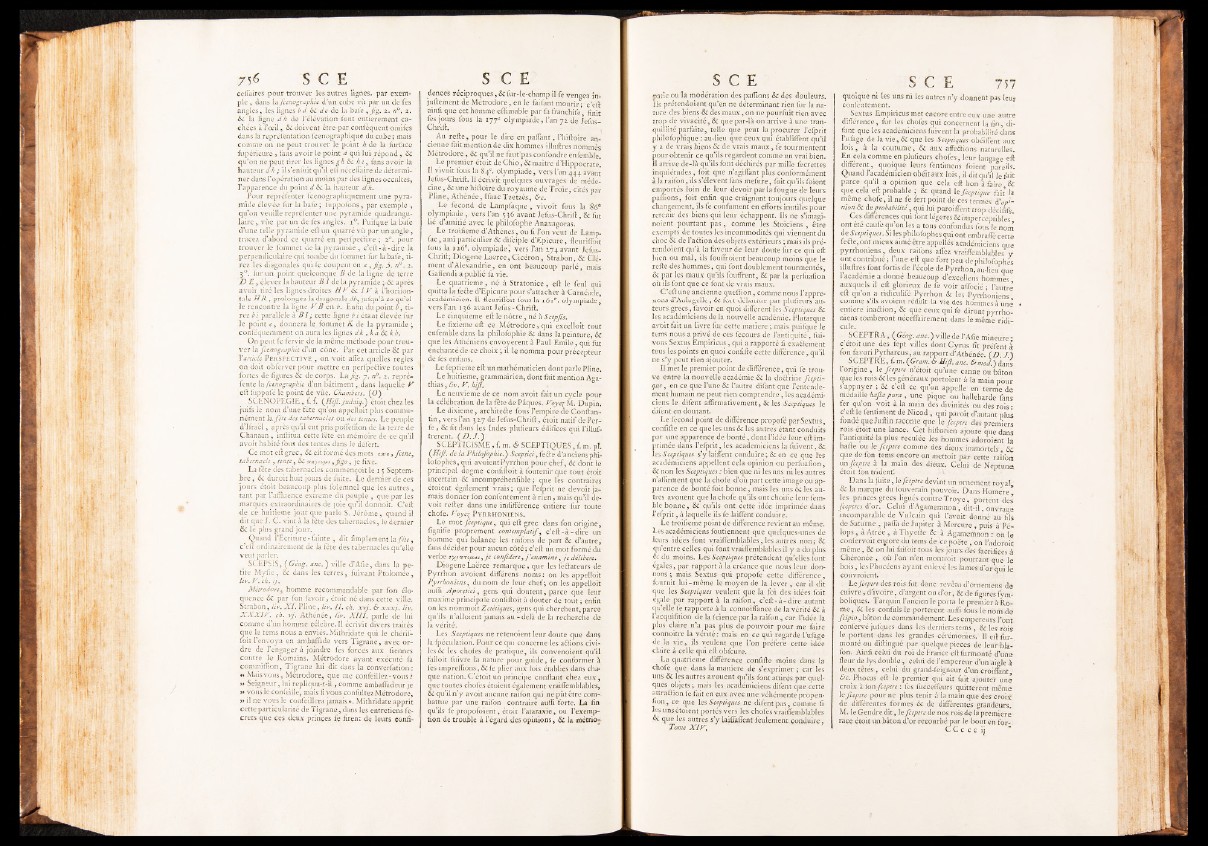
ceffaires pour trouver les autres lignes, par exemple
, dans la fcenographie d’un cube vîi par un de les
angles, les lignes b d &c d e de la baie , fig. z . n°. z .
& la ligne d k de l’élévation font entièrement cachées
à l’oeil, & doivent être1 par conléquent omifes
dans la repréfentation fcenographique ducube; mais
comme on ne peut trouver le point h de la furface
fupérieure, fans avoir le point d qui lui répond , &
qu’on ne peut tirer les lignes g h £c h e 9 fans avoir la
hauteur d h ; il s’enfuit qu’il ell néceffaire de déterminer
dans l’opération au moins par des lignes occultes,
l’apparence du point d & la hauteur dk.
Pour repréfenter feenographiquement une pyramide
élevée fur la bafe ; iuppofons, par exemple ,
qu’on veuille repréfenter une pyramide quadrangu-
laire , vue par un de les angles. i°. Puifque la baie
d’une telle pyramide ell un quarré vû par un angle,
tracez d’abord ce quarré en perfpeélive ; z °. pour
trouver le fommet de la pyramide , c’eft-à-dire la
perpendiculaire qui tombe du fommet fur labale, tirez
les diagonales qui fie coupent en e ,fig , 3. n ° . z .
3°. fur un point quelconque B de la ligne de terre
D E , élevez la hauteur B 1 de la pyramide ;•& après
avoir tiré les lignes droites H y &C 1 V à l’horifori-
tale H R , prolongez la diagonale db9 jufqu’à ce qu’elle
rencontre la ligne V B en b. Enfin du point b , tirez
b i parallèle à B I ; cette ligne b i étant élevée fur
le point e , donnera le fommet K de la pyramide ;
conféquemment on aura les lignes dk ,k a 6 c k b .
On peut fe fervir de la même méthode pour trouver
la feenographie d’un cône. Par cet article & par
Y article Perspective , on voit affez quelles réglés
on doit obferver pour mettre en perfpeélive toutes
fortes de figures & de corps. La fig. y . n°. z . repréfente
la feenographie d’un bâtiment ,,dans laquelle V
eft fuppofé le point de vûe. Chambers. (O)
SCENOPEGIE, f. f. {Hifi.judaïq.) étoit chez les
juifs le nom d’une fête qu’on appelloit plus communément
la fête des tabernacles ou des tentes. Le peuple
d’Ifraël, après qu’il eut pris poffeifion de la terre de
Chanaan, inftitua cette fête en mémoire de ce qu’il
avoit habité fous des tentes dans le défert.
Ce mot eft grec, & eft formé des mots kmh , feene,
tabernacle , tente, & •jrnyvvp.i yfig o , je fixe.
La fête des tabernacles commençoit le i 5 Septembre
, & duroit huit jours de fuite. Le dernier de ces
jours étoit beaucoup plus folemnel que les autres ,
tant par l’affluence extrême dit peuple , que par les
marques extraordinaires de joie qu’il donnoit. C’eft
de ce huitième jour que parle S. Jérôme, quand il
dit que J. C. vint à la fête des tabernacles, le dernier
& le plus grand jour.
Quand l’Ecriture-fainte , dit Amplement la f ê te ,
c’eft ordinairement de la fête des tabernacles qu’elle
veut parler.
SCEPS1S, ( Géog. anc. ) ville d’Afie, dans la petite
Myfie, & dans les terres. > fuivant Ptolomée,
liv. V . ch. ij.
Métrodore, homme recommandable par fon éloquence
& par fon favoir, étoit né dans cette ville.
Strabon, liv. X L Pline, liv. I I . ch. xv j. & x x x j . liv.
X X X I y . ch. vj. Athénée, liv. X I I I . parle de lui
comme d’un homme célébré. Il écrivit divers traités
que le tems nous a enviés. Mithridate qui le chérif-
foit l’envoya en ambaffade vers Tigrane, avec ordre
de l’engager à joindre fes forces aux fiennes
contre le Romains. Métrodore ayant exécuté fa
commiflion, Tigrane lui dit dans la converfation :
« Mais vous, Metrodore, que me confeillez-vousf
» Seigneur, lui repliqua-t-il, comme ambaffadeur je
» vous le confeille, mais fi vous confultez Métrodore,
» il ne vous le confeillera jamais». Mithridate apprit
cette particularité de Tigrane, dans les entretiens fe-
crets que ces deux princes fe firent de leurs confidences
réciproques, & fur-le-champ il fe vengea in-
jufteinent de Métrodore, en le faifant mourir • c’eft
ainfi que cet homme eftimable par fa franchife finit
fes jours fous la 177e olympiade, l’an 72 de Jefus-
Chrift.
Au refte, pour' le dire en paffant, l’hiftoite ancienne
fait mention de dix hommes illuftres nommés
Métrodore, & qu’il ne faut pas confondre enfemble.
Le premier étoit de Chio, & maître d’Hippocrate.
Il vivoit fous la 84e. olympiade, vers l’an 444 avant
Jefus-Chrift. Il écrivit quelques ouvrages de médecine,
& une hiftoire du royaume de Troie, cités pat-
Pline , Athénée, Ifaac Tzetzès, &c.
Le fécond de Lampfaque , vivoit fous la 86e
olympiade, vers l’an 536 avant Jefus-Chrift, & fin
lié d’amitié avec le philofophe Anaxagoras.
Le troifieme d’Athènes, ou fi l’on veut de Lamp-
fac, ami particulier & difciple d’Epicure, fleuriftoit
fous la 126e. olympiade^ vers l’an 274 avant Jefus-
Chrift; Diogene Laerce, Cicéron, Strabon, & Clément
d’Alexandrie, en ont beaucoup parlé, mais
Gaffendi a publié fa vie.
Le quatrième, né à Stratonice, eft le feul qui
quitta la fe£te d’Epicuré pour s’attacher à Carnéade,
académicien. Il fleuriftoit fous la 161e. olympiade,
vers l’an 136 avant Jefus-Chrift.
Le cinquième eft le nôtre, né à Sçcpfis.
Le fixieme eft ce Métrodore, qui excelloit tout
enfemble dans la philofophie & dans la peinture, &
que les Athéniens envoyèrent à Paul Emile, qui fut
enchanté de ce choix ; il le nomma pour précepteur
de fes enfans.
Le feptieme eft un mathématicien dont parle Pline.
Le huitième, grammairien, dont fait mention Aga-
thias, liv. y . hiß.
Le neuvième de ce nom avoit fait un cycle pour
la célébration de la fête de Pâques. Voyeç M. Dupin.
Le dixième, archite&e fous l’empire de Conftan-
tin, vers l’an 3 27 de Jefus-Chrift, étoit natif de Per-
fe, & fit dans les Indes plufieurs édifices qui l’illuf-
trerent. (Z)./.)
SCEPTICISME, f. m. & SCEPTIQUES, f. m. pi.
{H ifi. de la Philofophie.') Sc ep tic i, fe£le d’an ciens philosophes
, qui avoient Pyrrhon pour chef, & dont le
principal dogme confiftoit à foutenir que tout étoit
incertain & incompréhenfible ; que les contraires
étoient également vrais; que l’efprit ne devoit jamais
donner fon confentement à rien, mais qu’il devoit
refter dans une indifférence entière fur toute
chofe. Voyeç Pyrrhoniens,
Le mot feeptique, qui eft grec dans fon origine,
fignifie proprement contemplatif, c’eft-à-dire un
homme qui balance les raifons de part & d’autre,
fans décider pour aucun côté ; c’eft un mot formé du
verbe eyttsT c./xa.i9je confidere, j'examine je délibéré.
Diogene Laërce remarque, que les feftateurs de
Pyrrhon avoient différens noms : on les appelloit
Pyrrhoniens, du nom de leur chef; on les appelloit
auflî Xporetici, gens qui doutent, parce que leur
maxime principale confiftoit à douter de tout ; enfin
on les nommoit Zetétiques, gens qui cherchent, parce
qu’ils n’alloient jamais au - delà de la recherche de
la vérité.
Les Sceptiques ne retenoient leur doute que dans
la fpéculation. Pour ce qui concerne les aâions civiles
& les chofès de pratique, ils convenoient qu’il
falloit fuivre la nature pour guide, fe conformer à
fes impreflions, & fe plier aux lois établies dans chaque
nation. C’étoit un principe confiant chez eux,
que toutes chofes étoient également vraiflemblables,
& qu’il n’y avoit aucune raifon qui ne pût être combattue
par une raifon contraire auffi forte. La fin
qu’ils fe propofoient, étoit l’ataraxie, ou l’exemption
de trouble à l’égard des opinions, & la métrio^.
patie ou la modération des pallions & des douleurs.
Ils prétendoient qu’en ne déterminant rien fur la nature
des biens & des maux, on ne pourfuit rien avec
trop de vivacité, & que par-là on arrive à une tranquillité
parfaite, telle que peut la procurer l’efprit
philofophique : au-lieu que ceux qui établiffent qu’il
y a de vrais biens & de vrais maux, fe tourmentent
pour obtenir ce qu’ils regardent comme un vrai bien.
Il arrive de-là qu’ils font déchirés par mille fecrettes
inquiétudes , foit que n’agiffant plus conformément
à la raifon, ils s’élèvent fans mefure, foit qu’ils foient
emportés loin de leur devoir par la fougue de leurs
pallions, foit enfin que craignant toujours quelque
changement, ils fe confirment en efforts inutiles pour
retenir des biens qui leur échappent. Ils ne s’imagi-
noient pourtant pas, comme les Stoïciens , être
exempts de toutes les incommodités qui viennent du
choc & de l’aêtion des objets extérieurs ; mais ils prétendoient
qu’à la faveur de leur doute fur ce qui eft
bien ou mal, ils fouffroient beaucoup moins que le
refte des hommes, qui font doublement tourmentés,
& par les maux qu’ils fouffrent, & par la perfuafion
où ils font que ce font de vrais maux.
C eft une ancienne queftion, comme nous l’apprenons
d’Aulugelle, & fort débattue par plufieurs auteurs
grecs, favoir en quoi different les Sceptiques &
les académiciens de la nouvelle académie. Plutarque
avôit fait un livre fur cette matière ; mais puifque le
tems nous a privé de ces fecours de l’antiquité, fui-
vons Sextus Empiricus, qui a rapporté fi exactement
tous les points en quoi confifte cette différence,,qu’il
ne s’y peut rien ajouter.
Il met le premier point de différence, qui fe trouve
entre la nouvelle académie & la doftïine feeptique
, en ce que l’une & l’autre difant que l’entendement
humain ne peut rien comprendre, les académiciens
le difent affirmativement, & les Sceptiques le
difent en doutant.
Le fécond point de différence propofé parSextus,
confifte en ce que les uns & les autres étant conduits
par une apparence de bonté, dont l’idée leur eft imprimée
dans l’efprit, les académiciens la fuivent, &.
les Sceptiques s’y laiflent conduire ; & en ce que les
. académiciens appellent cela opinion ou perfuafion,
& non les Sceptiques : bien que ni les uns ni les autres
n’affirment que la chofe d’où part cette image ou apparence
de bonté foit bonne, mais les uns les autres
avouent que la chofe qu’ils ont choifie leur fem-
ble bonne, &' qu’ils ont cette idée imprimée dans
l’efprit, à laquelle ils fe laiflent conduire.
Le troifieme point de différence revient au même.
Les académiciens foutiennent que quelques-unes de
leurs idées font vraiflemblables, les autres non; &
qu’entre celles qui font vraiflemblables il y a du plus
& du moins. Les Sceptiques prétendent qu’elles font
égales, par rapport à la créance que nous leur donnons
; mais Sextus qui propofe cette différence
fournit lui-même le moyen de la lever car il dit
que les Sceptiques veulent que la foi des idées foit
égalé par rapport à la raifon, c’eft-à-dire autant
qu’elle fe rapporte à la connoiffance de la vérité & à
l’acquifition de la fcience par la raifon, car l’idée la
plus claire n’a pas plus de pouvoir pour me faire
connoitre la vérité : mais en ce qui regarde l’ufage
de la vie, ils veulent que l’on préféré cette idée
claire à celle qui eft obfcure.
La quatrième différence confifte moins dans la
chofe que dans la maniéré de s’exprimer ; car les
uns & les autres avouent qu’ils font attirés par quelques
objets; mais les académiciens difent que cette
attraâion fe fait en eux avec une véhémente propen-
fion, ce que les Sceptiques ne difent pas, comme fi
les uns étoient portés vers ,les chofes vraiffemblabies
& que les autres s’y laiffaffent feulement conduire,
Tome X I y .
quoique ni les uns ni les autres n’y donnent pas leur
confentement.
Sextus Empiricus met encore entre eux une autre
différence, fur les chofes qui concernent la fin, dri
fant que les académiciens fuivent la probabilité dans
l’ufage de la vie, & que les Sceptiques obéiffent aux
lois, à la coutume, & aux affe&ions naturelles.
En cela comme en plufieurs chofes, leur langage eft
différent, quoique leurs fentimens foient pareils.
Quand l’académicien obéit aux lois, il dit qu’il le fait
parce qu’il a opinion que cela eft bon à faire &
que cela eft probable ; & quand 1 et feeptique fait la
même chofe, il ne le fert point de ces termes d’opinion
& dtprobabilité, qui lui paroiflent trop décififs.
Ces différences qui font légères & imperceptibles *
ont été caufe qu’on les a tous confondus fous le nom
de Sceptiques. Si les philofophes qui ont embrafle cette
fefte,ont mieux aimé être appelles académiciens que
pyrrhoniens, deux raifons affez vraiffemblabies y
ont contribué ; l’une eft que fort peu de philofophes
illuftres font fortis <ie l’école de Pyrrhon, au-lieu que
l’académie a donné beaucoup d’excellens hommes
auxquels il eft glorieux de fe voir affocié ; l’autre
eft qu’on a ndiculifé Pyrrhon & les Pyrrhoniens
comme s ils avoient réduit la vie des hommes'â une
entière inaftion, & que ceux qui fe diront pyrrhoniens
tomberont néceffairement dans le même ridicule.
, SGEPTRAÿ |<*%iwzBc. ) ville de l’Aiîe minëui-e -
.clétoit uneJiStes :fept villes dont Gyrus & préfent à
io n favori l’ytiurtns, au rapport d’A th ê n e c . (JS. JA
SCEPTRE, f. m . ( G r a m . a n c . &niod.) dans
Porigine . k fic pm nîétôft: qü’uné cânÆ#ii%âton
que les sois Selesigénéraux portôient à la main pour
s’appuyer c’eft rappelle'-en’ terme de
médaille hafta piéac^une, pique-pu hallebarde fans
fër qu’on voit.à,la main des divinités oü des roisé
c’eftle fentiment dé Nicod , qui parbïid’aiitant plus
fondé que Juftin racontéque'.le^jre.aës premiers
rois étoit ,une lance, filât sfaiftorien -ajoute que dans
rantiqùitéla plus reculée les >hommes,adoroient la
halle, ou. le feeptre. éqmmê dHg dieux irtitndrîels', Sc
que de fon tems encore on :iie»o:t par cette' raifon
\m.fccptrtA la.main, des dieux. Celui dé Nêptunet
étoit.fon trident!
Dans la fuite, le feeptre devint un ornement royal- '
& la, marque du fouverain pouvoir. Dans Homere*
les princes grecs ligués contre Troye , portent des
feeptres d’or. Celui d’Agamemnon, dit-il, ouvrage
incomparable de Vulcain qui l’avoit donné au fils
de Saturne , paffa de Jupiter à Mercure , puîs à Pé-
lops, àArrée, àThyefte & à Agamemnon : oh le
confervoit encore du tems de ce poète , oh l’adôroit
même, & on lui fàifôit tous les jours des facrifiçes à
Çhéronée , ,où l’on n’en montroit pourtant que le
bois, les Phocéens ayant enlevé les lames d’or qui le
couvroient.
L e feeptre des fois fut donc revêtit d’ornenîens de
cuivre, d’ivoire, d’argent ou d’or, & de figures fÿm-
hôliques. Tarquin l’ancien le porta le premier à Rome,
& les confiais, le portèrent auffi fous len'orii de
feipio, bâton de commandement. Les empereurs l’ont
confervé jufques dans les derniers tems , & les rbis
le portent dans les grandes cérémonies,' Il eft fur-
monté ou diftingué par quelque pièces de leur bla-
fon. Ainfi celui du roi de France eft furmonté d’une
fleur de lys double, celui de l’empereur d’un aigle à
deux têtes , celui du grand-feigneur d’un.croiflànt 1
Oc. Phocas eft le premier qui ait fait ajouter une
croix à ion feeptre : fes fucceffeurs quittèrent même
le feeptre pour ne plus tenir à la main que des croi£
de différentes formes de différentes grandeurs.
M. le Gendre dit, le feeptre de nos rois de la première
race étoit un bâton d’or recourbé par le bout en for-.
C C c c c i j