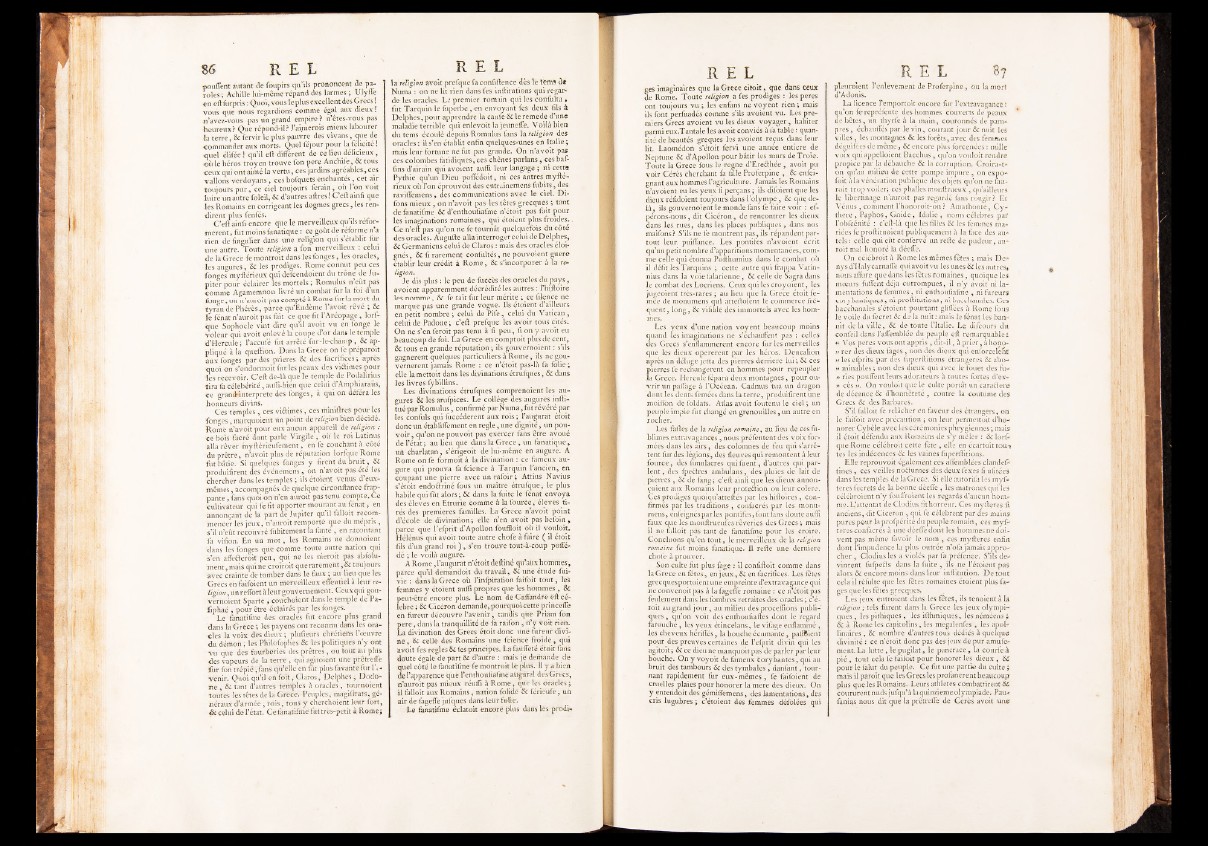
pouffent autant de foupirs qu’ils prononcent de paroles;
Achille lui-même répand des larmes ; Ulyffe
en eftfurpris : Quoi, vous le plus excellent des Grecs !
vous que nous regardions comme égal aux dieux !
n’avez-vous pas un grand empire ? n’êtes-vous pas
-heureux? Que répond-il? J’aimerois mieux labourer
•la terre, & fervir le plus pauvre des vivans, que de
commander aux morts. Quel féjour pour la félicite 1
-quel élifée l qu’il eft différent de ce lieu délicieux,
où le héros troyen trouve fon pere Anchife, & tous
ceux qui ont aimé la vertu, ces jardins agréables, ces
vallons verdoyans, ces bofquets enchantes, cet air
toujours pur, ce ciel toujours ferain, où 1 on voit
luire un autre foleil, & d’autres affres J C’eft ainfi que
les Romains en corrigeant les dogmes grecs, les rendirent
plus fenfés.
C ’eft ainfi encore que le merveilleux qu ils reformèrent,
fut moins fanatique : ce goût de réforme n’a
rien de fingulier dans une religion qui s’établit fur
une autre. Toute religion a fon merveilleux . celui
de la Grece fe montroit dans les fonges, les oracles,
les augures, & les prodiges. Rome connut peu ces
fonges myftérieux qui delcendoient du trône de Jupiter
pour éclairer les mortels ; Romulus n’eut pas
comme Agamemnon livré un combat fur la foi d’un
foncre ; on n ’auroit pas compte à Rome fur la mort du
tyran de Phérès, parce qu’Eudème l ’avoit reve ; &
le fénat n’auroit pas fait ce que fit l’Aréopage, lorf-
<que Sophocle vint dire qu’il avoit vu en fonge le
voleur qui avoit enlevé la coupe d’or dans le temple
d’Hercule; l’accufé fut arrêté fur-le-champ , & appliqué
à la queftion. Dans la G rece on fe préparait
aux fonges par des prières & des facrifices ; après
quoi on s’endormoit fur les peaux des vi&imes pour
les recevoir. C’eft de-là que le temple de Podalirius
tira fa célebérité, auffi-bien que celui d’Amphbraiis,
ce granèinterprete des fonges, à qui on déféra les
honneurs divins. ^
Ces temples , cës vi&imes, ces miniftres pour les
fongës, marquoient un point de religion bien décidé.
Romë n’a voit pour eux aucun appareil de religion :
ce bois facré dont parle Virgile , où lé roi Latinus
alla rêveir myftériëufement, en fe couchant à côte
du prêtre, n’avoit plus de réputation lorfque Rome
fut bâtie. Si quelques fonges y firent du bruit, &
produifirent des événemens , on n’avoit pas ete les
chercher dans les temples ; ils étoient venus d’eux-
mêmes , accompagnés de quelque circohftancë frappante
, fans quoi on n’en âuroit pas tenu compte. Ce
cultivateur qui fe fit apporter mourant au fenat, en
annonçant de la part dè Jupiter qu’il falloit recommencer
les jeux, ri’auroit remporte que du mépris,
s’il n’eut recouvré fubitement la fânte, eri racontant
fa vifion. En ùn mot, les Romains né donnoient
dans les fonges que comme toute autre nation qui
s’en âffëtteroit peu, qui ne les nierait pas absolument
, mais qui ne croirait que rarement, & toujours
avec crainte dè tomber dans le faux ; au lieu que les
Grecs eri faifoient un riîéfvéilleux effentiel à leur religion
, unreffort àlëur gouvernement. Ceux qui gou-
vernoient Sparte , côùchoient dans le temple de Pa-
fiphaé , pour être éclairés par les fonges.
Le fanatifme des o r a c le s fut encore plus grand
dans la Grece ; les payèns ont reconnu dans lés Oracles
la voix des dieux ; plufieurs chrétiens l’oeuvre
du démon ; les Philofophès & les politiques n’y ont
vu que des fourberies dés prêtres, ou tout Su pliiS
des vapeurs de la terre , qui agitaient Une prêtrëffë
fur fon trépié’ , fans: qri’ëlle en fut plus favaiitë fur T» -
venir. Quoi qü’il en toit, Glaros, Delphes , Dodo-
ne , & tant d’autres temples à oracles , tournoient
toutes les têtes delà Grèce.-Peuples, magiftrats, généraux
d’arméê • r o i s , tous y cherchoient leur fort,
Sc celui de l’état. Ce fanatifme fut très-petit à Rome ;
la religion avoit prefque fa confiftence dès ïè téms de
Numa : on ne lit rien dans fes inftitutions qui regarde
les oracles. Le premier romain qui les confulta ,
fut Tarquin le fuperbe, en envoyant fes deux fils à
Delphes, pour apprendre la caufe 6c le remede d’une
maladie terrible qui enlevoit la jeuneffe. Voilà bien
du tems écoulé depuis Romulus fans la religion des
oracles : il s’en établit enfin quelques-unes en Italie ;
mais leur fortune ne fut pas grande. On n’avoit pas
ces colombes fatidiques,ces chênes parlans, ces baf-
fins d’airain qui avoient aulîi leur langage ; ni cette
Pythie qu’un Dieu poffédoit, ni ces antres myftérieux
où l’on éprouvoit des entraînemens fubits , des
raviffemens , des communications avec le ciel. Di-
fons mieux , on n’avoit pas les têtes grecques ; tant
de fanatifme & d’enthoufiafme n’étoit pas fait pour
les imaginations romaines, qui étoient plus froides.,
Ce n’eft pas qu’on ne fe tournât quelquefois du côté
des oracles. Augufte alla interroger celui de Delphes,
& Germanicus celui de Claros : mais des oracles éloignés
, & fi rarement confultés, ne pouvoient guere
établir leur crédit à Rome, & s’incorporer à la religion.
Je dis plus : le peu de fuccès des oracles du p ays,
avoient apparemment décrédité les autres : l’hiftoire
les nomme, & fe tait fur leur mérite ; ce filence ne
marque pas une grande vogue. Ils étoient d’ailleurs
en petit nombre ; celui de Pife, celui du Vatican ,
celui de Padoue ; c’eft prefque les avoir tous cités.
On ne s’en feroit pas tenu à fi peu, fi on y avoit eu
beaucoup de foi. La Grece en comptoit plus de cent,
& tous en grande réputation ; ils gouvernoient : s’ils
gagnèrent quelques particuliers à Rome, ils ne gouvernèrent
jamais Rome : ce n’étoit pas-là fa folie ;
elle lamettoit dans les divinations étrufques, & dans
les livres fybillins.
Les divinations étrufques comprenoient les augures
& les arufpices. Le collège des augures infti-
tué par Romulus, confirmé par Numa, fut révéré par
les confuls qui fuccéderent aux rois; l’augurat étoit
donc un établiffement en réglé, une dignité, un pouvoir
, qu’on ne pouvoit pas exercer fans être avoué
de l’état; au lieu que dans la G rece, un fanatique,
un charlatan, s’érigeoit de lui-même en augure. A
Rome on fe formoit à la divination : ce fameux augure
qui prouva fafcience à Tarquin l’ancien, en
coupant une pierre avec un rafoir ; Attius Navius
s’étoit endoftriné fous un maître étrufque, le plus
habile qui fut alors ; & dans la fuite le feriat envoya
des éleves en Etrurie comme à la fource, éleves tirés
des premières familles. La Grece n’avoit point
d’école de divination; elle n’en avoit pas befoin ,
parce que l ’efprit d’Apollon fouffloit où il vouloit.
Hélénus qui avoit toute autre chofe à faire ( il étoit
fils d’un grand roi ) , s’en trouve tout-à-côup poffé-
dé ; le voilà augure.
A Rome, l’augurat n’étoit deftihé qli’alixhommes,
parce qu’il demandoit du travail, & urié étude fui-
vie : dans la Grece où l’infp’tfation fàifoit tou t, les
I femmes y étoient auffi propres que les hommes , &
peut-être encore plus. Le riOm dè Câffandrë eft ce-,
lebre ; & Cicéron demande* jjoUrqiloi cette princeffe
eri fureur découvre l’avënit, tandis qùè Pflani fon
pere, dans la tranquillité de fa raifori * ri’ÿ voit rien.
La divination des Grecs étoit donc Unë fufeur divine
, & celle des Romains une fcieiifcè froide, qui
avoit fes réglés & les principes. La faüffeté étoit fans
doute égale de part & d’autre : mais je demande de
quel côté le fanatifme fe montroit le plus. Il y a bien
de l’apparence que l’ enthoitliafiné attgüral des Grées,
n’auroit pas mieux réufli à Rome, que lès ôfàcles ;
il falloit aux RomairiS, natiori fo'lidê & férièufe, uri
air de fageffe jufquës daris leur folie.
Le fanatifme éclatoit èricoré plus dans lés prodiges
imaginaires que la Grece cita it, que dans ceux
de Rome. Toute religion a fes prodiges : les peres
ont toujours vu ; les enfans ne voyent rien ; mais
ils font perfuadés comme s’ils avoient vu. Les premiers
Grecs avoient vu les dieux voyager, habiter
parmi eux.Tantale les avoit conviés à fa table : quantité
de beautés greques les avoient reçus dans leur
lit. Laomédon s’étoit fervi une anaée entière de
Neptune & d’Apollon pour bâtir les murs de Troie.
Toute la Grece fous le régné d’Ere&hée, avoit pu
voir Cérès cherchant fa fille Proferpine , ,& enfei-
gnant aux hommes l’agriculture. Jamais les Romains
n’avoient eu les yeux fi perçans ; ils difoient que les
dieux réfidoient toujours dans l ’olympe, & que delà
, ils gouvernoient le monde fans fe faire voir : ef-
perons-nous, dit Cicéron, de rencontrer les dieux
dans les rues, dans les places publiques, dans nos
maifons? S’ils ne fe montrent pas, ils répandent partout
leur, puiffance. Les pontifes n’avoient écrit
qu’un petit nombre d’apparitionsmomentanées, comme
celle qui étonna Pollhumius dans le combat où
il défit les Tarquins ; cette autre qui frappa Vatin-
nius dans la voie falarienne, & celle de Sagra dans
le combat des Locriens. Ceux qui les croyoient, les
jugeoient très-rares ; au lieu que la Grece ctoit fe-
mee de monumens qui atteftoient le commerce fréquent,
long, & vifiblé des immortels avec les hommes.
Les yeux d’une nation voyent beaucoup moins
quand les imaginations ne s’échauffent pas : celles
des Grecs s’enflammèrent encore fur les merveilles
que les dieux opererent par les héros. Deucalion
après un déluge jetta des piërres derriefe lui; & ces
pierres fe rechangerent en hommes pour repeupler
la Grece. Hercule fépara deux montagnes, pour ouvrir
un paffage à l’Océeari. Cadmus tua un dragon
dont les dents femées dans la terre, produifirent une
moiffon de foldats. Atlas avoit foutenu le ciel ; un
peuple impie fut changé en grenouilles, un autre en
rocher.
Les faftes de la religion romaine, au lieu de cesfit-
blimes extravagances , nous préfentent des voix formées
dans les airs, des colomnes de feu qui s’arrêtent
fur des légions, des fleuves qui remontent à leur
fource, des fimulacres qui fuent, d’autres qui parlent
, des fpeétres ambulans, des pluies de lait de
pierres , & de fang ; c’eft ainfi que les dieux annon-
çoient aux Romains leur prote&ion ou leur colere.
Ces prodiges quoiqu’atteftés par les hiftoires , confirmés
par les traditions , confacrés par les monumens,
enfeignésparles pontifes, font fans doute auffi
faux que les monftrueufes rêveries des Grecs ; mais
il ne falloit pas tant de fanatifme pour les croire.
Concluons qu’en tout, le merveilleux de la religion
romaine fut moins fanatique. Il refte une derniere
chofe à prouver.
Son culte fut plus fage : il confiftoit comme dans
la Grece en fêtes, en jeux, & en facrifices. Les fêtes
grecquesportoientune empreinte d’extravagance qui
ne convenoit pas à la fageffe romaine : ce n’étoit pas
feulement dans les fombres retraites des oracles ; c’é-
toit au grand jour, au milieu des proceffions publiques
, qu’on voit des enthoufiaftes dont le regard
farouche, les yeux étincelans, le vifage enflammé ,
les cheveux heriffés, la bouche écornante, paflBient
pour des preuves certaines de l’efprit divin qui les
agitait; & ce dieu ne manquoit pas de parler par leur
bouche. On y voyoit de fameux éorybantes, qui au
bruit des tambours & des tymbales , danfant, tournant
rapidement fur eux-mêmes , fe faifoierit de
cruelles plaies pour honorer la mere des dieux. On
y enteridoit des gémiffemens, des lamentations, des
cris lugubres ; c’étaient des femmes défolées qui
pleuraient renlevemeni de Proferpine , OU la mort
d’Adonis.
La licence l’empoftoit encore fur i’extfavagartèê \
qu’on fe repréfente des hommes couverts de peaux
de bêtes, un thyrfe à la main, couronnés de pampres
, échauffés par le v in, courant jour & nuit les
villes , les montagnes & les forêts, avec des femmes
déguifées de même, & encore plus forcenées : mille
voix qui appelaient Bacchus , qu’on vouloit rendre
propice par la débauche & la corruption. Croira-t*
on qu’au milieu de cette pompe impure, on expo-*
foit a la vénération publique des objets qu’on ne fau*
roit trop voiler; ces phalles monftfueuX , qu’ailleurs
le libertinage n’auroit pas regardé fans rougir ? Et
Vénus , comment l’honoroit-on ? Amathonte, C y -
there , Paphos, Gnide, Idalie, noms célébrés paf
l’obfcénité : c’eft-là que les filles & les femmes nia*
riées fe proftituoient publiquement à la face des au*
tels ; celle qui eût conferve un refte de pudeur, auroit
mal honoré la déeffe,
On célébroit à Rome les mêmes fêtes ; mais De»
nys d’Halycarnaffe qui avoit vu les unes & les autres,
nous affure que dans les fêtes romaines, quoique les
moeurs fuffent déjà corrompues, il n’y avoit ni lamentations
de femmes, ni erithoufiafme , ni fureurs
corybantiques, ni proftitutions, ni bacchanales. Ces
bacchanales s’étoient pourtant gliffées à Rome fous
le voile du fecret & de la nuit : mais le fénat les bannit
de la v ille , & de toute l’Italie. Le difeours du
confeil dans l’affemblée du peuple eft remarquable i
« Vos peres vous ont appris , dit-il, à prier, à hono-
» rer des dieux fages , non des dieux qui enforcelent
» les efprits par des fuperftitions étrangères & abo-
» minables ; non des cjieux qui avec le fouet des fu-
» ries pouffent leurs adorateurs à toutes fortes d’ex-
» cès ». On vouloit que le culte portât un cara&ere
de décence & d’honnêtete , contre la coutume des
Grecs & des Barbares.
S’il falloit fe relâcher en faveur des étrangers, ori
le faifoit avec précaution ; on leur permettait d’ho-
norer Çybèle avec les cérémonies phrygiennes ; mais
il étoit défendu aux Romains de s’y mêler : & lorfque
Rome célébroit cette fête , elle en écartait tou-}
tes les indécences & les vaines fuperftitions.
Elle reprouvoit également ces alfemblées clandel-
tines , ces veilles noêlurnes des deux fexes fi ufitées
dans les temples de la Grece. Si elle autorifa les myf-
teresfecrets de la bonne déeffe , les matrones qui ieS
célébroient n’y fouffroient les regards d’aucun homme.
L’attentat de Clodius fithorreur. Ces myfteres fi
anciens, dit Cicéron , qui fe célèbrent paf des mains
pures pour la profpérite du peuple romain, ces myf-
teres confacrés à une décile dont les hommes ne doivent
pas même favoir le nom, ces myfteres enfin
dont l’impudence la plus outrée n’ofa jamais approcher
, Clodius les a violés par fa préfence. S’ils devinrent
fufpeéls dans la fuite , ils ne l'étaient pas
alçrs & encore moins dans leur inftitution. De tout
cela il réfulte que les fêtes romaines étoient plus fa-
ges que les fêtes grecques. (
Les. jeux entroient dans les fêtes, ils terioierit à la
religion ; tels furent dans la Grece les jeux olympiques
, les pithiques, les ifthmiqiies, les néméens ;
& à Rome les capitolins, les megalenfes , les apol-
linaires , & nombre d’autres tous dédiés à quelques
divinité : ce n’étoit donc pas des jeux de pur amufe-
ment. La lutte , le pugilat, le pancrace, la courfe à
p.ié , tout cela fe failôit pour honorer les dieux , 6C
pour le falut du peuple. Ce fut une partie du culte ;
mais il paroît que les Grecsles profanèrent beaucoup
plus que les Romains. Leurs athlètes combattirent &£
coururent nuds jufqu’à la quinzième olympiade* Pau-
fanias nous dit que la prêtreffe de Cerès avoit un«!