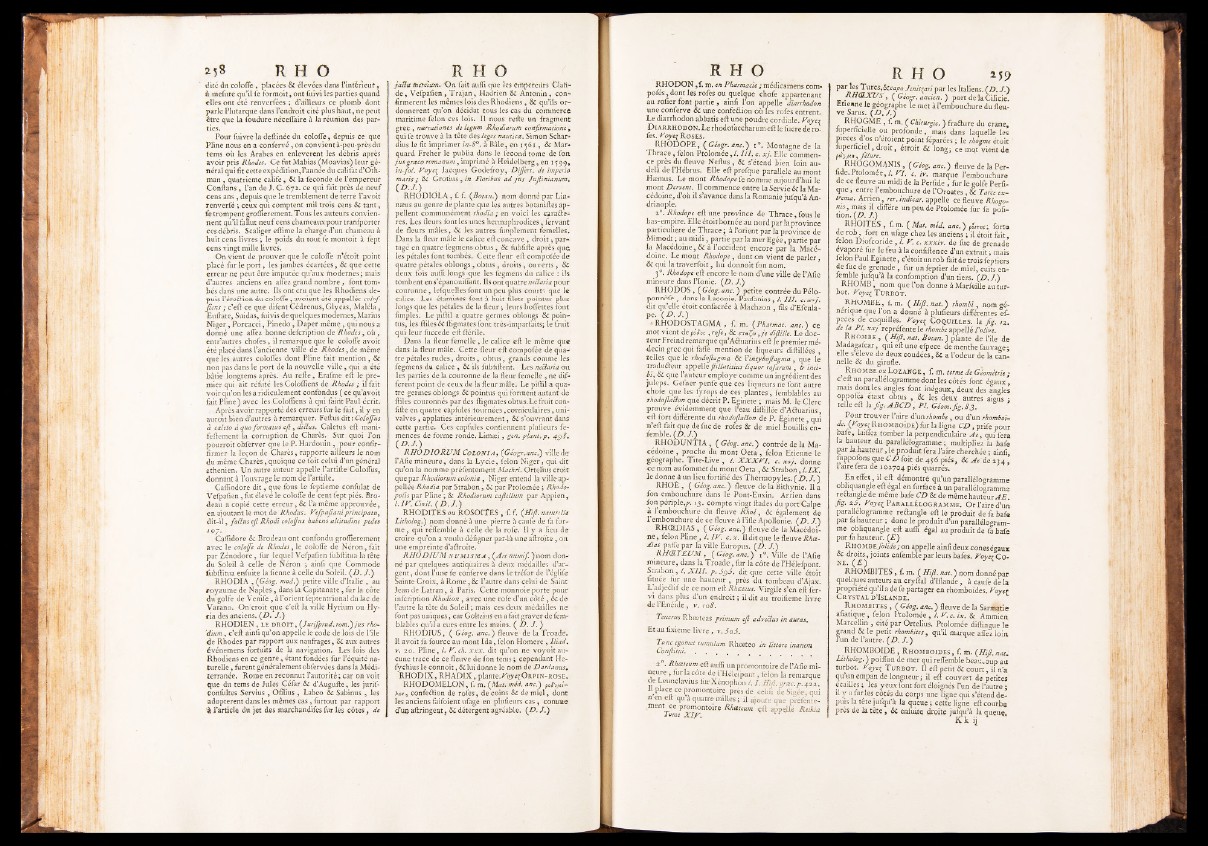
dite du coloffe , placées 8c élevées dans Pintérieuf -
à mefure qu’il fe formoit, ont fuivi les parties quand
elles ont été renverfées ; d’ailleurs ce plomb dont
parle Plutarque dans l’endroit cité plus haut, ne peut
ctre que la foudure néceffaire à la réunion des par*
ties.
Pour fuivre la deftinée du coloffe -, depuis Ce que
Pline nous en a confervé, on convient à-peu-près du
tems où les Arabes en enlevèrent les débris après
avoir pris Rhodes. Ce fiat Mabias fMoavias) leur général
qui fit cette expédition, l’annee du califat d’Oth-
man , quatrième calife, 8c la fécondé de l’empereuf
Conftans , l’an de J. C. 672. ce qui fait près de neuf
cens ans , depuis que le tremblement de terre l’avoit
renverfé ; ceux qui comptent mil trois cens 8c tant,
fe trompent groflierement.Tous les auteurs conviennent
qu’il fallut neuf cens chameaux pour tranfporter
ces débris. Scaliger eftime la charge d’un chameau à
huit cens livres ; le poids du tout fe montoit à fept
cens vingt mille livres.
On vient de prouver que le coloffe n’étoit point
placé fur le port, les jambes écartées, 8c que cette
erreur ne peut être imputée qu’aux modernes; mais
d’autres anciens en allez grand nombre , font tombés
dans une autre. Ils ont cru que les Rhodiens depuis
l’éreftion du coloffe , avoient été appellés coloffiens
; c’eft ce que difent Cédrenus, Glycas, Maléla,
Eu fiat e, Suidas, fuivis de quelques modernes, Marius
Niger, Porcacci, Pinedo, Daper même , qui nous a
donné une affez bonne defeription de Rhodes, où ,
entr’autres chofes, il remarque que le coloffe avok
été placé dans l’ancienne ville de Rhodes -, de même
que les autres coloffes dont Pline fait mention , 8c
non pas dans le port de la nouvelle ville , qui a été
bâtie longtems après. Au refte, Erafme eft le premier
qui ait réfuté les Coloffiens de Rhodes ; il fait
voir qu’on les a ridiculement confondus ( ce qu’avoit
fait Pline ), avec les Coloffiens à qui fairit Paul écrit.
Après avoir rapporté des erreurs fur le fait, il y en
auroit bien d’autres à remarquer. Feftùs dit : Coloffus
à caleto à quo formants e j l , diclus. Caletus eft mani-
feftement la corruption de Charès. Sur quoi l’on
pourroit obferver que le P. Hardouin, pour confir-
firmer la leçon de Charès, rapporte ailleurs le nom
du même Charès, quoique ce foit celui d’un général
athénien. Un autre auteur appelle l’a rtifte Coloffus,
donnant à l’ouvrage le nom de l’artifte.
Cafliodore dit, que fous le feptieiiie confulat de
Vefpafien, fi.it éleve le coloffe de cent fept piés. Bro-
deau a copié cette erreur, 8c l’a même approuvée,
en ajoutant le mot de Rhodus. Vefpafianiprincipatu,
dit-il, faclus efl Rhodi colofjus habens altitudine pedes
ioy. .
Caflidore 8c Brodeau ont confondu groflierement
avec le coloffe de Rhodes, le coloffe de Néron, fait
par Zénodore, fur lequel Vefpafien fubftitua la tête
du Soleil -à celle de Néron ; ainfi que Commode
fiibftitua enfuite la fienne à celle du Soleil. (D . J .)
RHODIA , (Géog. moi.') petite ville d’Italie , au
royaume de Naples, dans la Capitanate, fur la côte
du golfe de Venife , à l’orient feptentrional du lac de
Varano. On'croit que c’eft la ville Hyrium ou Hy-
ria des anciens. (D . J .)
RHOD1EN , LE DROIT, ( J urifprud.rom.) ju s rho-
’dium, c’eft ainfi qu’on appelle le code de lois de l’île
de Rhodes par rapport aux naufrages, 8c aux autres
événemens fortuits de la navigation. Les lois des
Rhodiens en ce genre, étant fondées fur l’équité naturelle
, furent généralement obfervées dans la Méditerranée.
Rome en reconnut l’autorité ; car on voit
que du tems de Jules Céfar 8c d’Augufte, les jurif-
çonfultes Servius , Ofilius , Labeo 8c Sabinus , les
adoptèrent dans les mêmes cas, furtoüt par rapport
à l’article du jet des marchandifes fur les côtes, de
jàclu mercïum. On fait aufli que les empereurs Glati**
de, Vefpafien, Trajan, Hadrien 8c AntOnin, confirmèrent
les mêmes lois des Rhodiens , Sc qu’ils ordonnèrent
qu’on décidât tous les cas du commerce
maritime félon ces lois» Il nous refte un fragment
grec , narrationes de legum Rhodiarurn confirmatione-9
qui fe trouve à la tête des leges nantie te. Simon Schâr-
dius le fit imprimer in-8°. à Bâle, en 15 61 , 8c Mar*
quard Freher le publia dans le fécond tome de fon
ju s grtzco romanum, imprimé à Heidelberg, en 1599*
in-fol. Voye^ Jacques Godefroy, Differt. de imperio
maris ; 8c Grotius, in Floribus a i jü s Ju/Hnianum-, GH GG RHODIOLA, f. f. (Botanÿ) nom donne par Lin*
næus au genre de plante que les autres bptaniftes appellent
communément thodia ; en voici les caratte*
res. Les fleurs font les unes hermaphrodites, fervant
de fleurs mâles, 8c les autres fimplement femelles.
Dans la fleur mâle le calice eft concave , droit * partagé
en quatre fegmens obtus , 8c fubfifte après que
les pétales font tombés. Cette fleur eft cdmpofée de
quatre pétales oblongs, obtus , droits, ouverts, 8c
deux fois aufli longs que les fegmens du calice : ils
tombent ens’épanouiffaht. Ils ont quatre metafia pour
couronne, lefquelles font un peu plus court':- que le
calice. Les étamines font à huit filets pointus plus
longs que les pétales de la fleur ; leurs boffettes font
fimples. Le piftil a quatre germes oblongs 8c pointus,
les ftiles 8c ftigmates font très-imparfaits; le fruit
qui leur fuccede eft ftérile»
Dans la fleur femelle, le calice eft le même que
dans la fleur mâle- Cette fleur eft compofée de quatre
pétales rudes, droits, obtus, grands comme les
fegmens du calice , 8c ils fubliftent. Les neclaria oit
les parties de la couronne de la fleur femelle , ne different
point de ceux de la fleur mâle. Le piftil a quatre
germes oblongs 8c pointus qui forment autant de
ftiles couronnés par des ftigmates obtus. Le fruit con-
fifte en quatre capfules .tournées, corniotilaires, uni-
valves , applaties intérieurement , & s’ouvrant dans
cette partie. Ces capfules contiennent plufieurs fe-
mences de forme ronde. Limæi, gen, plant, p. 408, GH . H H R H O D IO R U M Co l o n IA , (Géogr.artc,') ville de
l’Afie mineure, dans la Lycie, lelon Niger, qui dit
qu’on la homme préfentement Machri. Ortelius croit
que par Rhodiorum colonia , Niger entend la ville ap-
pellee Rhodia par Strabon, 8c par Ptolomée ; Rhodo*
polis par Pline ; & Rhodiorum cajlellum par Appien ,
l. I F . Civil. ( D . J . )
RHODITES ou ROSOITES , f. f. (Hifi. naturdlt
Litholog.) nom donné à une pierre à caufe de fa forme
, qui reffemble à celle de la rofe. Il y a lieu- de
Croire qu’on a voulu défxgner par-là une aftroïte, ou
une empreinte d’aftroïte.
R H O D IU M n u m i s m a , (Ar t numif. )nom donné
par quelques antiquaires à deux médailles d’argent
, dont l’une fe eonferve dans le tréfor de l’églife
Sainte Croix, à Rome, 8c l’autre dans celui de Saint
Jean de Latran, à Paris. Cette monnoie porte pour
infeription Rhodion , avec une rofe d’un côté , & de
l’autre la tête du Soleil ; mais ces deux médailles ne
font pas uniques, car Gokzius en a fait graver de fem-
blables qu’il a eues entre les mains. ( D . J . )
RHODIUS, ( Géog. anc. ) fleuve de la Troade.
Il avoit fa fource au mont Ida, félon Homere , Iliad.
v. 20. Pline, l. V. ch. x x x . dit qu’on ne voyoit aucune
trace de ce fleuve de fon tems ; cependant He-
fychius le connoît ,& lui donne le nom de Dardanus,
RHODIX, RHADIX, plante.^by^ORPiN-ROSE.
RHODOMELON, f. m. (Mat. méd. anc.) poêo/A-
\ov, confeétion de rofes, de coins 8c de miel, dont
les anciens faifoient ufage en plufieurs cas, comme
d’un aftr.ingent ? 8c détergent agréable. (D . J .)
RHODON ,f. m. en Pharmacie; médicamens com«
pofés, dont les rofes ou quelque chofe appartenant
au roller font partie , ainfi Ton appelle diarrhodon
une eonferve & une confeftion où les rofes entrent.
Le diarrhodon abbatis eft une poudre cordiale, foye^
D iarrhodon. Le rhodofaccnarum eft le fucre de rofes.
Poyei R oses.
RHODOPE, ( Gèogr.anc.) i°. Montagne de la
Thrace, felon Ptolomée, /. 111. c. x j . Elle commence
près du fleuve Neftus, 8c s’étend bien loin au-
delà de l’Hébrus. Elle eft prefque parallele au mont
Hæmus. Le mont Rhodope fe nomme aujourd’hui le
mont Dervent. Il commence entre la Servie 8c la Macédoine,
d’où il s’avance dans la Romanie julqu’à An-
drinople.
20. Rhodope eft une province de Thrace, fous le
bas-empire. Elle étoit bornée au nord par la province
particulière de Thrace; à l’orient par la province de
Mimodt ; au midi, partie par la mer Egée, partie par
la Macédoine, 8c à l’occident encore par la Macédoine.
Le mont Rhodope , dont on vient de parler,
8c qui la traverfoit, lui donnoit fon nom.
30. Rhodope eft encore le nom d’une ville de l’Afie
mineure dans l’Ionie. (D . J.)
RHODOS, (Géog. anc. ) petite contrée du Pélo-
ponnèfe , dans la Laconie. Paufanias, /. I I I . c. xv j.
dit qu’elle étoit confacrée à Machaon , fils d’Efcula-
pe. ( D . J . )
* RHODOSTAGMA , f. m. (Pharmac. a nc.) ce
mot vient de poS'os ,rofe,&C <rr*Ça> ,/c diftille. Le docteur
Freind remarque qu’Aûuarius eft le premier médecin
grec qui faffe mention de liqueurs diftillées ;
telles que le rhodofiagma 8c Vintybofiagma, que le
traducteur appelle ßillatitius liquor rofarum , & inti-
bi, 8c que l’auteur employe comme un ingrédient des
juleps. Gefner penfe que ces liqueurs ne font autre
choie que les fyrops de ces plantes, femblables au
rhodofiaclon que décrit P. Eginete ; mais M. le Clerc
prouve évidemment que Peau diftillée d’ACtuarius,
eft fort différente du rhodofiaclon de P. Eginete, qui
n’eft fait que de fuc de rofes & de miel bouillis en-
femble. (D . J .)
' RHODUNTIA, ( Géog. anc. ) contrée de la Macédoine
, proche du mont Oeta, felon Etienne le
géographe. Tite-Live , l. X X X P I . c. x v j. donne
ce nom au fommet du mont Oeta , 8c Strabon, /. IX .
le donne à un lieu fortifié des Thermopyles. ( D . J . )
RHOÉ , ( Géog. anc. ) fleuve de la Bithynie. Il a
fon embouchure dans le Pont-Euxin. Arrien dans
fon périple,/», /j. compte vingt ftades du porrGalpe
à l’embouchure du fleuve Rh oé, 8c également de
l’embouchure de ce fleuve à llfle Apollonie. (D . J .)
RHOEDIAS, ( Géog. anc.) fleuve de la Macédoine
, felon Pline , /. I K c. x . Il dit que le fleuve Rhce-
dias paffe par fa ville Europus. (D . J .)
R H OE T E U M , (Géog. anc.) 1 °. Ville de l’Afie
mineure, dans la Troade, fur la côte de l’Hélefpont.
Strabon, L. X I I I . p . 5$ 5 . dit que cette ville étoit
fituée fur une hauteur , près du tombeau d’Ajax.
L’adjeôif de ce nom eft Rhoeteus. Virgile s’en eft fer-
vi dans plus dun endroit; il dit au troifieme livre
de l’Enéide, v. 108.
Teucrus Rhoeteâs primum eß adveclus in auras.
Et au fixieme livre , v. 5 o5.
Tune egomet tumulum Rhoeteo in littore inanem,
Conßitui. . . . .
a . Rhotteum^ eft aufli un promontoire de l’Afie mineure
, fur la côte de l’Héleipont, felon la remarque
de Leunclavius fur Xénophon L. I . Hiß. grate, p. 422.
R place ce promontoire près de celui deSigée,qui
n en eft qu’à quatre milles ; il ajoute que préfente-
^ment ce promontoire RJuxteum eft appelle Retkla
Tome X I K r
par les TurCS,k.capo Jenitçari par les Italiens. (Z?. J .)
R H OE X U S , ( Géogr. ancien. ) port de laCilicie.
Etienne le géographe le met à l’embouchure du fleuve
Sarus. ( D . J .)
^•HOGME , f. m. ( Chirurgie. ) frafture du crâne,
fuperficielle ou profonde, mais dans laquelle les
pièces d’os n’étoient point féparées ; le rhogme étoit
fuperficiel, droit, étroit 8c long; ce mQt vient de
pcoyp», fêlure.
r ^O pCM ANIS , ( Géog. anc. ) fleuve de la Per-
lide. PtoIomee, K l. c. iv. marque l’embouchure
de ce fleuve au midi de la Perfide , fur le golfe Perfi-
que, • entre l’embouchure de l’Oroates , 8c Tarce ex -
trema. Arrien, rer. indicar. appelle ce fleuve Rhogo-
nis, mais il diffère un peu de Ptolomée fur fa pofi-
tion. (D . J .) r
RHOITES , f.m. (M a t. méd. a n c.) po/w, fort®
de rob, fort en ufage chez les anciens ; il étoit fait,
félon Diofcoride , l. V. c. x x x iv . de fuc de grenade
évaporé fur le feu à la confiftence d’un extrait ; mais
félon Paul Eginete, c’étoit un rob fait de trois feptiers
de fuc de grenade , fur un feptier de miel, cuits en-
femble jufqu’à la confomption d’un tiers. (D .J . )
RHO MB, nom que l’on donne à Marfeillc au turbot.
Kqye{ TU R BO T .
RHOMBE, f. m. ( Hiß, n a t.) rhombi, nom générique
que l’on a donne à plufieurs différentes ef>
peces de coquilles. Koye1 C oquille?, la fig. tz .
de la PI. x x j repréfente le rhombe appellé l'olive.
R hombe , ( H iß . nat. Boum. ) plante de l’île de
Madagafcar, qui eft une efpece de menthe fauvage-j
elle s’élève de deux coudées, 8c a l’odeur de la cannelle
8c du girofle.
5 R hombe ou Lo zan ge, f. m. terme de Géométrie;
c’ eft un parallélogramme dont les côtés font é«»aux
mais dont les angles font inégaux, deux des angles
oppofes étant obtus , 8c les deux autres aigus ;
telle eft la fig . A B C D , PI. Géom.fig. 8 3.
Pour trouver l’aire d’un rhombe , ou d’un rhombo'im
de. (V iy e i Rhomboïde) fur la ligne C D , prife pour
bafe, laiflez tomber la perpendiculaire A e , qui fera
la hauteur; du parallélogramme; multipliez la bafe
par la hauteur, le produit fera Paire cherchée ; ainfi,
fuppofons que C D foit de 456 piés, 8c A e de 234 ,
Paire fera de 102704 piés quarrés.
En effet, il eft démontré qu’un parallélogramme
obliquangle eft égal en furface à un parallélogramme
reftangle de même bafe C D 8c de même hauteur
fig. 2.5. Voyt{ Parallélogramme. Or Paire d’un
parallélogramme reftangl© eft le produit de fa bafe
par fa hauteur ; donc le produit d’un parallélogram-
me obliquangle eft auffi égal au produit de & bafe
par fa hauteur. (E )
R H o M B Efolide ; on appelle ainfi deux cônes égaux
8c droits, joints enfembie par leurs bafes. Foye^ Co*
RHOMBITES, f. m. ( Hiß . nat. ) nom donné par
quelques auteurs au cryftal d’Iflande, à caufe delà
propriété qu’il a de fe partager en rhomboïdes. Koyer
C rystal d’Islande.
Rhombites , ( Géog. anc. ) fleuve de la Sarniatie
afiatique , félon Ptolomée , l. K. c. ix . & Amniien
Marcellin , cité par Ortelius. Ptolomée diftingue le
grand 8c le petit rhombites, qu’il marque affez loin
l’un de l’autre. ( D . J . )
RHOMBOÏDE, Rhomboïdes, f. m. (H iß .nat.
Litholog.) poiffon de mer qui reffemble beaucoup au
turbot. Koye{ T urbot. Il eft petit 8c court, il n’a
qu’un empan de longueur ; il eft couvert de petites
écaillés ; les yeux font fort éloignés l’un de l’autre ;
il y a fur les côtés du corps une ligne qui s’étend depuis
la tete jufqu’à la queue ; cette ligne eft courbe
près de la tête, 8c enfuftç droite jufqu’à la queue,
K k i j